| Tri par titre
|
Tri par auteur
|
Tri par date
|
Page : <1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14 >
|
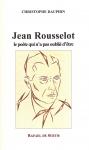
|
|
Critiques
"A l’occasion du centenaire de la naissance de ce grand poète que fut Jean Rousselot (1913-2004), Christophe Dauphin a dressé un portrait riche et touchant de cet homme aux multiples talents dont le parcours complexe est un exemple de foi en l’humanité et d’engagement pour la liberté.
A propos de son enterrement, quelques jours après son décès le 23 mai 2004, Christophe Dauphin confie : « Nous venions d’enterrer soixante-dix ans de poésie française. Jean était la poésie, une poésie sans cesse aux prises avec la vie, le fatum et l’Histoire ; un homme d’action, qui a durablement marqué les personnes qui l’ont approché. ».
Ce fut Louis Parrot, son mentor, qui l’initia à la poésie contemporaine. Ils se rencontrent en 1929. Cette initiation dépasse le cadre de la poésie, il est question aussi de philosophie, de psychologie, de politique et de religion. Il fut, dit Jean Rousselot de Louis Parrot, « mes universités ». C’est à Poitiers, ses nuits, ses cafés, le quartier ouvrier où vit Rousselot, les campagnes environnantes, que le poète se forge, que le génie se fraie un passage dans une forêt hostile faite de préjugés, de combats intérieurs, d’un isolement, peut-être salutaire, mais seulement apparent : « Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais Un. Je me tourmente pour des douleurs qui tiennent éveillée, la nuit entière, la vieille repasseuse qui m’a nourri ; pour la soif qui calcine un soldat au ventre ouvert… La douleur, l’angoisse, l’exil et le danger, voilà mes chemins de communication, voilà mes adhérences au placenta du monde… »
Proche des Jeunesses socialistes, puis en 1934 de la Ligue communiste, anticolonialiste, ses combats politiques sont, à l’époque, proches de ceux des surréalistes. Mais son combat politique reste distinct de sa poésie. En 1932, il participe à l’aventure de la revue bordelaise Jeunesse à la recherche d’un « renouvellement », d’un « rafraîchissement » de la poésie. C’est à partir de la publication en 1936 d’un recueil, intitulé Le Goût du pain, que Jean Rousselot est considéré comme un acteur essentiel de ce renouveau de la poésie.
Quand la guerre arrive, Jean Rousselot se sert de sa fonction de Commissaire de Police pour aider la Résistance et les poètes en danger. Sa poésie devient une poésie de combat, notamment dans cette « école » qui rassembla René Guy Cadou, Jean Bouhier, Michel Manoll, Marcel Béalu et d’autres. Une école, une manifestation de l’amitié.
Poète et homme d’action André Marissel parlera à propos de Jean Rousselot de « surréalisme en action ». Jean Rousselot gardera un grand respect pour le surréalisme qui l’aura éveillé, lui comme ses compagnons, et revendique une continuité entre les surréalistes et lui, tout particulièrement par une collaboration avec l’inconscient.
Après la deuxième guerre mondiale, Jean Rousselot tourne le dos à une vie sociale et poétique facile construite sur la reconnaissance de son action exemplaire pendant le conflit. Il renonce à son métier et veut vivre de sa plume ce qui se révèle évidemment aléatoire. En 1996, tout en affirmant ne pas regretter son choix, il confie à Christophe Dauphin : « Ne lâche jamais ton métier, tu m’entends ! Jamais ! Ne fais pas cette connerie ! Tu pourras ainsi écrire quand tu veux et surtout, ce que tu veux. ».
Jean Rousselot écrira de nombreux articles pour la presse. Le premier est consacré au désastre de Hiroshima qu’il qualifie de génocide, ce qui le brouille avec Aragon. Il va désormais écrire beaucoup, une trentaine de plaquettes et livres jusqu’en 1973, une vingtaine de pièces pour la radio, des romans, mais découvrir aussi et faire découvrir de nombreux poètes talentueux. Tombé amoureux de la Hongrie, il dénoncera le drame de Budapest en 1956, condamnant violemment la contre-révolution russe, et traduira beaucoup de grands poètes hongrois en français comme Attila József, Sándor Petőfi, Endre Ady…
De 1997 à sa disparition, Jean Rousselot continue d’écrire et de publier une « poésie de terrain », au plus proche de la vie, du peuple, des rêves de liberté de tous ceux qui sont contraints. Une écriture de plus en plus dépouillée, directe, grave, sans mensonge, sans artifice, sans effet.
Jean Rousselot, au bout de 137 volumes, continue d’œuvrer. « Les mots de Rousselot restent debout et marchent à nos côtés. Le poète rend la vie possible. C’est pour cela qu’il ne meurt pas tout à fait. » dit avec justesse Christophe Dauphin."
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 19 janvier 2014).
"Jean Rousselot aurait eu 100 ans le 27 octobre 2013. C’est l’occasion choisie par son ami, Christophe Dauphin, pour faire paraître cet essai qui nous dit ce qu’est et ce que doit être un poète : celui qui évoque le quotidien, homme parmi les hommes, travailleur parmi les travailleurs, qui, pour eux, fait le don de soi au sens le plus fraternel du mot.
« Ecolier » de Rochefort, proche de Cadou, Manoll ou Bérimont, admirateur fervent de Roger Toulouse, Jean Rousselot laisse une œuvre ample et diverse : l’œuvre d’un romancier, d’un historien, d’un critique aussi, amoureux de la parole, de l’écriture, et de l’émotion que l’une et l’autre procurent, et qui s’appelle poésie. « Le poème est pour moi l’inouïe prise de conscience des pouvoirs du poète sur le temps, qu’il arrête, sur la mémoire, qu’il ressuscite, sur les sentiments, qu’il élève au Sublime, sur le réel, qu’il perce et transmue pour en retrouver l’essence et a pérennité. »
Abel MOITTIE (in roger-toulouse.com, janvier 2014).
"Les analyses de Dauphin, comme d'habitude chez lui, cernent mieux qu'un portrait le personnage réputé impossible, mais il le transforme délibérément. Par exemple, ce qui n'était pas toujours mentionné dans les biographies, le rôle du poète dans la police et dans la résistance à l'occupant nazi est mis en evidence. Lorsqu'il eut quarante ans, Jean Rousselot parla du surréalisme en souriant de se croire un peu "plus surréaliste que les surréalistes eux-mêmes". Sa décision en 1946 de démissionner de tout et de vivre de sa plume fut capitale. Il devient alors grand voyageur et se produit et publie dans le monde entier. Il n'hésite pas non plus à prendre des positions fermes contre les injustices, comme pour Abdellatif Laâbi en 1972. Pour la forme de ses poèmes, il aura adopté tout. Avec force. Il s'insurge encore contre les inutiles: "Pour beaucoup de mes confrères, l'activité poétique consiste à fabriquer des objets de langage avec un langage sans objet... La poésie jetable gagne du terrain." Que n'aurait-il pas dit aujourd'hui ?"
Paul VAN MELLE (in Inédit Nouveau n°267, La Hulpe, Belgique, mars 2014).
"Jean Rousselot aurait eu cent ans en 2013. Et Christophe Dauphin a eu la bonne idée de faire à la fois sa biographie et un essai sur ce poète hors pair. Il divise son livre par chapitre chronologiques, et avec Jean Rousselot, c'est tout le vingtième siècle qu'on revisite... Christophe Dauphin insiste sur le fait que pour le poète, la poésie est surtout une manière d'être. L'homme est derrière son regard - Comme derrière une vitrine - Lavée à grande eau par le jour. Jean Rousselot prône une poésie de terrain et non de laboratoire ajoute l'auteur de la monographie. Je n'ai fait ici que survoler ce livre bien documenté. Ce qui étonne et retient chez Jean Rousselot, c'est la fidélité à ses idées et la rectitude de ses principes et de son action. Cela a toujours conféré à sa poésie une considérable autorité."
Jacques MORIN (in Décharge n°161, mars 2014).
"Le pari de Dauphin – restituer l’une des figures les plus emblématiques de la poésie francophone des années 30/80, à l’occasion du centenaire de sa naissance – est magnifiquement tenu par un autre passeur de poésie, rompu à l’exercice d’analyse et d’admiration d’un aîné qui a compté, qu’il a connu, avec lequel il a pu s’entretenir, avec lequel il a échangé nombre de correspondances.
Et le réseau se poursuit fidèlement : Jean Rousselot, qui a toujours revendiqué ses dettes envers Reverdy, Max Jacob, qui a toujours fait de l’amitié une vertu humaniste et littéraire, passe ainsi le relais à son cadet de l’Académie Mallarmé pour qu’il chante (le mot n’est pas outré) un parcours poétique, celui d’un homme droit, qui s’est toujours voulu, comme il l’a énoncé dans ce beau poème (repris en fin de volume) homme au sens le plus dense du terme: « Je parle droit, je parle net, je suis un homme. » Il est, certes, difficile de rappeler sans tomber dans les poncifs de la biographie et dans ceux de la vénération poétique. Christophe Dauphin, se basant sur une documentation de premier ordre, des témoignages de première main, des entretiens, de nombreuses lectures, une connaissance intime de la foison d’œuvres nées entre 1935 et 2002, rameute les grandes étapes de la formation d’un esprit, d’une conscience littéraire. L’occasion d’un tournage pour la télévision, sous l’impulsion du poète-maire Roland Nadaus, souda le poète des « Moyens d’existence » et son jeune biographe. Le centenaire fêté à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2013.
"Le 23 mai 2014, il y aura dix ans que l’écrivain Rousselot nous a quittés.
Le petit livre de Dauphin, qu’on lit d’une traite tant il respire le respect et le travail en profondeur pour nous faire mieux sentir une voix vraie, agrémenté de photographies (portraits de Rousselot et des groupes d’amis poètes) et d’une belle huile en 4e de couverture due à l’ami peintre Roger Toulouse, offre, en quatre sections chronologiques, une étude précise de soixante-dix ans dévolus à la poésie. Les origines ouvrières, le sens aigu du social et du juste, la lutte contre la tuberculose, les rencontres fondamentales des poètes Fombeure et Parrot, l’ancrage de Poitiers (la province enfin !) et l’effervescence intellectuelle de cette cité natale, une première revue créée (Le Dernier carré), la reconnaissance dès 1936 (avec « Le goût du pain »), le commissaire Rousselot résistant de la première heure (que de tâches et de faux papiers à prévoir !), l’intense expérience de Rochefort-sur-Loire (dont Rousselot est redevable, mais dont la seule mention finira un jour par l’agacer comme si c’était son seul ancrage), les travaux « alimentaires » dès qu’il cesse ses activités de commissaire pour se consacrer uniquement à la littérature…les matières sont multiples et le travail de Dauphin donne poids, relief, consistance à tous les trajets accomplis par le poète entre sens incisif d’une poésie à hauteur d’homme et conscience aussi précise de son devoir d’homme, de poète, d’écrivain solidaire, syndicaliste et engagé dans les mille et une tâches d’écriture poétique, critique, romanesque et de traduction.
Les solidarités littéraires s’inscrivent en grand dans cette perspective : les aînés salués (Reverdy, Jacob, Jouve en tête), les cadets mis à l’honneur (Cadou), les actions multiples dans les journaux et revues (jusqu’à Oran) pour défendre la poésie. Rousselot (que je comparerais volontiers à l’infatigable Armand Guibert, que Christophe ne cite pas) n’a jamais oublié d’être, en dépit de ses cent quarante volumes, en dépit des reconnaissances ; il méritait cette approche soignée.
Que retenir de plus frappant ? Tant de faits, tant de poèmes, tant de gestes ! Allez, sélectionnons : ses coups de gueule au moment où tout le monde se taisait lors des événements de Budapest (ah ! ses amis hongrois, Joszef, Gara, Illyés…) ; sa défense d’Abdellatif Laâbi des geôles hassaniennes ; sa défense d’une poésie de terrain (non de laboratoire)…. Mais, surtout, l’écriture d’une conscience. Et la fidélité souveraine à ses origines : « Et je suis seul à voir pendre derrière moi, - Comme des reines arrachées, -
Les rues de mon enfance pauvre », (« Pour Flora et Gyula Illyés », Jean Rousselot).
Un très bel essai de Christophe Dauphin !"
Philippe LEUCKX (in recoursaupoeme.fr, 11 juin 2014).
"Un remarquable essai de Christophe Dauphin, qui nous fait découvrir le parcours atypique de ce grand poète que fut Jean Rousselot. Ce grand admirateur de Victor Hugo, dont les premiers poèmes portent l'indéniable empreinte du maître, trace un chemin qui nous mène là où il écrit : Malgré moi j'ai pitié des cours profondes et visqueuses - sans oiseaux, sans feuilles tourbillonnantes - Et du pétrin invisible qui geint en bas - Jour et nuit comme un forçat enterré. Ce livre retrace l'itinéraire fondateur d'un poète portant la marque de l'inconscient et l'esprit libertaire, qui ne triche pas avec lui-même, et sur lequel bien d'entre nous feraient bien de méditer: descends vers les gouffres, dit-il, perds ta couleur, tes yeux et le dernier écho, là-haut, de ta présence..."
Bruno GENESTE (in revue Spered Gouez n°20, octobre 2014).
|
|

|
|
Lectures critiques
"Une demeure de sécurité et de confort certains. Mais inadaptée pour répondre aux besoins du futur poète. Dans un poème du livre évoquant sa jeunesse, André Prodhomme trace ce que représente L’impasse des absolus. Ce titre même laisse entendre que la nécessité d’une quête vers un ailleurs, certes indéfini, est une préoccupation permanente.
Comme si je lisais pour la première fois un recueil de poésie, j’aborde ce livre en chaussant mes lunettes amnésiantes. Dans la main, je tiens 45 poèmes, d’une sincérité émouvante, presque des confessions. Et vite frappe la récurrence fréquente de certains mots, notamment, par ordre décroissant : vie, enfant, mort, poème, triste, fantôme, vieux, beau. Ces mots, arrachés à leur dispersion et rassemblés ensuite, nous tracent les contours du poète et de ses préoccupations. De plus, la musique, surtout le jazz, et le cinéma ont une place importante dans la vie du poète.
Le poète se présente comme un enfant souffrant conscient de n’être pas plus intelligent que ses lecteurs. Souvent triste, il aime la vie et s’évertue, libre et fraternel, à faire son boulot de Terrien. En dosant sa fureur de vivre, il veut être bienveillant, et pense pouvoir estimer devant la fin avoir été un bon apprenti. Il s’attend en retour, avec un clin d’œil, à pouvoir vieillir dans un luxe infini et d’avoir du temps devant lui.
La tristesse est un fil rouge tout au long des pages, apparaissant dans dix poèmes. Le poète est en effet Habillé du sentiment profond qu’on nous a ordonné - De refuser le bonheur. Il s’agit d’une tristesse qu’on devine inconsolable. Certes, mais il est vrai aussi que Je m’accroche aux raisons d’être triste - Depuis quelque temps - Elles sont faciles à trouver. Mais nuançons, car Je suis triste en étant fait pour une autre humeur. En effet, La tristesse seule - Il y a longtemps que je l’ai laissée tomber de sorte que L’abonnement au malheur d’être - Se retire - Notre amour installe - Sa fierté. Bonne nuit tristesse, dit le poète, saluant d’un clin d’œil Françoise Sagan.
Inévitablement la mort appelle l’attention, et une découverte intrigue le poète. Estimant avoir perdu du temps en caressant la mort, qui se révèle surprenante, il peut constater que La mort a de bonnes joues - Les yeux clairs - Elle ne connaît pas la traitrise - On ne l’imagine pas - On l’envisage - Dans sa simplicité.
Aussi, celui qui dit être un condamné à mort plein de vie clame que la froidure de l’hiver ne saura pas faire mourir le feu qui est en lui. Et à ceux qui lui survivront, il dit Pensez que j’étais triste - Mais pas tout le temps.
Car le poète, Mordu par la vie jusqu’au sang, mais qui ne fait aucun effort particulier pour vivre, est un amoureux de la vie. Il affirme néanmoins qu’il est étonnant de vivre, que la vie est tout un poème.
Dans cette vie de rencontres improbables de matériaux rares et de clous rouillés, où des conflits de loyauté pourrissent la vie au quotidien, André Prodhomme s’assigne d’être bienveillant, avec la bonne dose de fureur de vivre. Le conseil d’un ainé n’y est peut-être pas pour rien : crache dans ta main petit père, tu verras la vie est belle. Et il découvre que soudain il nous faut à nouveau décider de vivre.
Le poète aime les enfants, étant fait pour entendre les rires d’enfant, et il est ému par l’enfant qui demeure encore dans ses entrailles. Il lui consacre un poème entier. Car Cet enfant qui souffre en moi - Ne prend pas de gants - Il boxe les anges à mains nues. De plus, lorsqu’il traverse des quartiers de Paris moins bien fréquentés, il devient ce gamin - Aperçu par Rabelais distingué par Hugo. Mais ici l’enfant, c’est aussi le déguisement l’espoir Avec son minois de sale gosse qui a fait sa toilette de chat - En faisant couler l’eau du robinet - Pour tromper la parentèle.
André signale que vieillir n’est pas se déshabiller de l’enfance et que Le vieil homme qu’on devient - Reprend la main de l’enfant - Qu’on est encore, ému par Ce sourire qu’un enfant m’adressa ce matin - Dans son chariot de victuailles à la caisse du magasin. Il est alors inévitable que même Les jeux de vieux amants - Sont mêlés de fatigue et d’enfance. Avoir Ce sourire d’ancien de l’homme vieillissant, être à l’aise dans tous les âges de la vie, lui permet de dire J’ai la prétention de vieillir dans un luxe infini /…/ en ayant le temps devant moi. André aime parler du Poème, l’évoque fréquemment dans ses textes, comme pour souligner qu’une vie sans poésie serait inconcevable. L’affirmation que la vie c’est tout un poème en témoigne. D’ailleurs, dans le poème qui précisé que la connaissance du poème laisse nu, l’auteur fait comprendre qu’il préfère nommer poème ce qui semble en fait être le déroulement de la vie. Le territoire de l’auteur est parsemé de mots décolorés, des mots qui ne se roulent pas dans la farine. La loi qu’il voit présente derrière la langue peut en être la raison. Bien conscient qu’ils ont une dette, le poète donne aux mots la liberté, afin qu’ils soient meilleurs que lui.
Le piano du salon est Entouré de fantômes. On apprend que : aux heures singulières de la vie apparaissent des fantômes bienveillants. Invisibles, souvent bienveillants, ils veillent sur les objets et Œuvrent à faire les présentations. Action utile, puisqu’il apparaît que Eclairés des rires de nos gentils fantômes - Nous vivons sans nous contempler. De plus, ceux-ci ont l’élégance de ne rien inscrire sur des tables de loi et ils savent consoler, Art gentil fantôme - Tu bois mes larmes.
Suspendu entre enfance et vieillesse, André livre à notre regard quelques visions d’un monde parallèle, perceptible par le poète seul. Dans ce monde, où Chaque matin le poème entreprend - De repenser l’horizon, les mots qu’on murmure sont les enfants d’autres mots, rares, ayant la fièvre. A l’intérieur d’un temps amical qui travaille et trie, une voix intérieure s’emploie à dessiner une langue de lumière. Or, malgré la présence de fantômes bienveillants, le poète sent qu’Une valse brille sur l’étang glacé de mes peurs et ce même si, comme on l’a vu, parfois la mort a de bonnes joues.
Un poème conclura ces lignes sur L’impasse des absolus. L’humaniste ami de l’Homme et de la Terre y traduit délicatement la possible existence sereine de l’homme ordinaire dans la nature et donne une noblesse poétique aux choses qu’on prend rarement la peine de remarquer."
Un vent de force trois - Traverse le champ - L’herbe est tranquille - On dirait qu’elle se fait masser
Les feuilles jaunes et dorées - Déposées au sol - Dans une symétrie particulière - Apportent au regard - Une attention créatrice
Hier c’était différent - Des parfums se levaient de terre - Comme un baiser - Sorti prendre l’air
Parfois les sons imposent - Leur assonance ou leurs dissonances
Le moment clef - C’est quand tu apparais - Avec un de ces petits outils de jardin - Dont j’ignore le nom et la fonction
Parfois nous nous disons quelques mots
Parfois nous signons la journée - D’un silence.
Svante SVAHNSTRÖM (in revue Les Hommes sans Epaules n°44, octobre 2017).
*
" André Prodhomme est cet explorateur respectueux de l’humanité qui scrute avec lucidité et bienveillance les expressions sombres ou clarifiantes de l’être humain. Ses poèmes apparaissent comme un chapelet musical d’empathies dans un temps où la destruction de l’empathie est orchestrée méthodiquement. L’autre, surtout l’autre en sa vulnérabilité, peut être détruit. Tel est le message premier de notre temps. André Prodhomme livre les antidotes à cette guerre sociétale, célébrations de l’autre et de la vie même dans ses soubresauts mortifères. Il rend aussi à l’écriture ses fonctions libératrices que le commerce du livre veut enfouir sous les décombres de la finance.
André Prodhomme sait être au plus près de la meute comme au plus près de l’individu, pour capter la matière émotionnelle qu’il sculpte avec les mots.
L’altération doit être prise en compte, telle qu’elle, pour qu’une libre restauration révoltée soit rendue possible.
Le poète l’a dit
Le chemin proposé à l’homme est une asymptote
Pour tenir debout et garder une allure sportive
Il se muscle au quotidien avec tous les engins
disponibles
Gardant l’oeil vers cette courbe aveuglante
Surinformé et ne sachant rien de nouveau
Sur ce monde insensé
Beau terrible jouissif ignoble
Je pose la question de l’ouverture du bal
…
Extrait de Le chemin
Rémy BOYER (in incoherism.worpress.com, mai 2018).
|
|

|
|
Lectures critiques :
Odile Cohen-Abbas nous entraîne une fois de plus dans un monde alternatif qui, au fil des mots, se fait de plus en plus réel, en approchant de l’imaginal d’où découlent nos réalités les plus quotidiennes, déformations denses des idées archétypales. C’est un retour à la source qu’elle inscrit dans la poésie, une élévation à la fois guerrière et tranquille :
Il y a vingt ans qu’il a éteint la lumière
une minute après, il y a cent ans
On pourrait croire qu’il a le pouvoir
de faire vieillir la lumière
Ce n’est pas cela
Il y a – les chiffres mentent –
cent ans et quelques années
qu’il a éteint la lumière
Mais la durée se décale sur l’ampoule noire
comme sur les draps
S’il se tient immobile il pourra faire le signe
aux serviteurs du langage d’apporter
le dire sur le temps et la luminosité
Il y a plusieurs fois cent ans qu’il a éteint la lumière
Plusieurs fois cent ans pour acquérir le pressentiment
de son lit aux draps auréolés.
Cette quête initiatique décalée, parfois à contre-sens pour mieux retrouver le sens de l’ascension, a pour véhicule le langage qui structure ou sert des visions, autant de tableaux qui ne se dessinent pas mais jaillissent soudainement dans un rythme apparemment chaotique. Comme en toute voie initiatique, c’est dans l’intervalle que nous pouvons nous extraire du chaos et se saisir de l’axe de l’être.
Les textes d’Odile Cohen-Abbas, particulièrement le superbe Cantique du Gilles, engloutiront sans regret quiconque manque de vigilance de l’esprit. Comme souvent, elle sait que la chair et l’esprit ne sont qu’un, dès lors le sexe devient art ascensionnel. Le geste est ainsi central, car nul ne peut tricher avec lui-même par le geste. Celui-ci est ajusté ou non, au monde comme à soi-même. Le geste « juste », au moment « juste », dans le lieu « juste », un précepte martial appliqué à l’écriture. La trace est comme le tranchant du sabre :
L’Evanith
– à chaque respiration son nom pénètre et reflue hors d’elle – pendule, lance sa nasse d’exhortations voisées sur la berge.
Du trigle, elle a la peau très rouge, des amoures, une jambe palmilobée qui s’arrête au genou.
Son placenta fut l’agent du néant.
Sa face et sa colonne épineuse exulcérées vers l’En-haut.
Elle veut extraire le Gilles de l’in-pace
et des vésanies médaillées de l’eau.
Elle lui réclame le nombre juste de ses organes,
la désinence de son membre et les plans de construction
nécessaire
pour fonder une tribu avec lui.
Nous ne pouvons qu’inviter à plonger dans la gaste forêt des mots d’Odile Cohen-Abbas. Il n’y a aucune garantie que vous en sortiez indemne, ou même que vous en sortiez tout simplement. C’est au centre, au cœur que se trouve l’unique sortie, verticale.
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 16 septembre 2021).
*
Quand La chair ruisselle. Magicienne du silence des tréfonds de la psyché, Odile Cohen-Abbas crée un mixage de qui nous sommes : “des êtres hybrides” aux « distorsions angéliques, diaboliques ».
Le tout dans un jeu de miroir, de focale et d’angles selon des prises autant de vues que de mots.
S’instruit tout un jeu amoureux et une lutte là où les êtres eux-mêmes se dédoublent en divers Gilles et Pierrot par une mise à feu de la vie dans les pans des peintures abstraites d’Alain Breton.
D’où cette « geste » et sa chanson habitée et inspirée. Elle est nourrie d’un savoir ancestral mais tout autant moderne. Les mots semblent assurer l’existence à cette histoire somme toute de sexe, en dépit des courants mystiques.
La chair ruisselle en un cantique des cantiques avant que la créatrice retourne son encre comme Godard retour¬nait sa caméra dans un de ses livres les plus célèbres.
Odile Cohen-Abbas joue d’une perversion secrète dans une transmutation des lieux et des êtres entre trivialité et spiritualité. Être embrigadé dans le terrestre charnel ne suffit pas à s’enkyster en ce qui est.
La poésie devient une source naturelle qui permet aux êtres, non de plonger en des abîmes, mais de monter au ciel là où s’inscrit une condition « ciné » qua non de reprise de vie.
Les mots de la tribu la recréent.
Jean-Paul GAVARD-PERRET (in www.lelitteraire.com, octobre 2021).
|
|

|
|
Sur Remue.net
"De temps en temps, dans la trop lointaine galaxie du surréalisme, une étoile filante apparaît ; alors, il faut vite saisir le sillage qu’elle laisse dans l’ombre ou la suie ambiante. Robert Rius, né le 25 février 1914, est mort le 21 juillet 1944, fusillé par les nazis pour faits de résistance : il vécut ainsi seulement trente ans, d’une guerre à l’autre. Il demeure l’inventeur en 1937, avec Benjamin Péret et André Breton, du jeu « le dessin communiqué ». Pour la préparation de l’Anthologie de l’humour noir (publiée en 1939, réimprimée en 1947, édition définitive en 1966 par Jean-Jacques Pauvert), il aida André Breton à sélectionner quelques-uns des écrivains qui y figurent de belle manière. Robert Rius aimait la littérature, la peinture, la photographie. Il lança la revue La Main à la plume en 1941, écrivit notamment l’Essai d’un dictionnaire exact de la langue française en 1943 (Editions Les Cahiers de Poésie) et un Picasso en janvier 1944 (Pages libres de La Main à la plume, édition clandestine). On peut lire, sur le site que vient d’ouvrir l’Association qui se consacre à la mémoire de Robert Rius, un tract adressé à Léon-Paul Fargue le 28 mars 1943 - impeccable traité du style en abrégé."
Dominique Hasselmann (Remue.net, 24 octobre 2006).
|
|
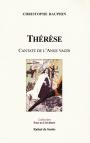
|
|
Critique
Une préface rappelle l’histoire de Thérèse Martin entrée au carmel de Lisieux à 15 ans et morte à 24 ans de la tuberculose dans des circonstances qui relèvent de la non-assistance à personne en danger. Le diable veut que ce soit le dernier grand mythe catholique. Elle fut canonisée en 1925, 28 ans après sa mort. Sa mort, elle la désirait pour devenir la fiancée du Christ. Son père était ce que l’on appellerait aujourd’hui un catholique intégriste. L’auteur rappelle que le docteur Mabille, ami d’André Breton, s’était intéressé au cas de cette jeune femme, victime de la religion. Dans le poème qui suit cette préface éclairante, Christophe Dauphin va invoquer tous ceux que la Normandie a inspirés dans le domaine de la joie de vivre, de la fête, de la paillardise et du libertinage pour libérer Thérèse, la désenvouter en somme. Il accuse : Ils ont rongé tes ongles – Etouffé tes cris – Ils ont muré ta démence dans un cierge – Broyé l’amour comme le sable de ton corps – Toutes les respirations – Comme on jette une femme sur un obus. L’idée que la religion est la clé des malheurs fait son chemin ici : Dieu est mort à Lisieux au carmel – En Pologne dans un camp – Dieu est un charnier qui ne finit pas – Dieu est vide comme une armoire d’hôtel. Cela entre dans la panoplie des mensonges du pouvoir : Eux – qui se signent dans le bénitier du CAC 40 – Eux – qui derrière leurs comptoirs – célèbrent le profit la mort – et l’âme chewing-gum – la meilleure vente – du bazar de l’Hôtel de Ville. Non contents de vous réduire à la misère ces puissants de la banque et de l’église vous confisquent votre corps. D’où : Je vous salue Marie pleine de grâce – Votre pistache est le bilboquet de nos rêves. Et ce refrain : Je ne veux pas que l’on encarmélise cette fille.
Alain Wexler (Verso n°132, mars 2008).
|
|

|
|
Critiques
"Un recueil surprenant, dense et varié. Marie-Christine Brière a l'art d'écrire des poèmes cadrés. En une page, on découvre un portrait, souvent de quelqu'un, nommé parfois en titre, ou bien un paysage d'un lieu de même titré. Et l'on embarque pour ces photos comme dans un album, chaque texte guidant une visite aux confins des êtres ou du monde... le mot bonheur qui répandu placerait son bandeau - lisse sur les yeux d'enfants perdus. Amour, amitié, voyage. Empathie avec les gens et la nature. La seconde observation que l'on retient se trouve être dans la forme; les mots passent les vers, enjambant facilement, et enchaînant les phrases, ce qui provoque fluidité et vitesse: l'eau passe à peine sur le dos des pierres. Son écriture si particulière ne se prive pas de raconter, tout en chevauchant l'image si l'occasion se présente. Rien n'est prémédité, la poésie se matérialise au fur et à mesure que l'encre sèche sur le cahier. Un nuage a égaré sa guimbarde. On pense surréalisme bien sûr, dans une version baroque, et pourquoi n'en serais-ce pas ? mais je crois qu'il y a surtout le regard de Marie-Christine Brière à focalisations variées, et qui bouge instantanément, macro, plan large ou panoramique... le lecteur change de plan à chaque vers: Un train dans son roulement d'oreille - révèle une route lointaine, oubliée."
Jacques Morin (in Décharge ,n°160, décembre 2013).
"Le titre du recueil de Marie-Christine Brière sonne comme une invitation à embarquer aux côtés du poète, à nous laisser emporter au gré des lignes noircies de mots. Ainsi le parcours proposé au lecteur est-il jalonné par les titres de parties qui annoncent les étapes du voyage : « Amarrages », « A bord penchés tremblants », « Attaches », « Embarqués », « Humour rameur », « Et sur l’arche, un pépiement de création ». Comment ne pas deviner ici qu’il s’agit d’une liste des étapes progressives qui mènent à l’accomplissement du parcours poétique, ainsi qu’une manière d’énumération du périple auquel est invité le lecteur enserré à l’énoncé dans les pluriels employés par l’auteur ?
Alors qu’est-ce à dire ? Avant même la lecture des textes nous voyons se déployer le champ lexical de la navigation, métaphore de la traversée du réel portée par l’énonciation poétique dans sa puissance à décaler les rouages du signe. Un trajet au-delà des apparences données à voir à travers un quotidien dont le poète s’imprègne et dont elle énonce les détours sans apitoiement mais avec toujours un regard à l’Humanité. Le paysage habituel n’est plus insignifiant, il n’est plus tableau d’habitudes égrainées jour à jour. Grâce aux mises en œuvres paradigmatiques, dans le choix du lexique, et à une syntaxe qui permet les glissements sémantiques, il se dévoile à travers des dispositifs ainsi dévolus à la parole poétique.
En plongée dans les attentes
A la table du café
Les paroles contenues
Disent le dehors des femmes
Talons fins, robes noires
Un planeur descend des yeux
Le repas, heure légale
Assène son cliquetis
Par un trou de porte ouverte
Barreau de fer midi coupe
L’ombre en loques des auvents
Vêtus de bleu unanime
Les passants cherchent le soir
Dans sa forme, une poésie au vers et à la rime libres de toute contrainte, et des titres qui précèdent chaque texte. Pas de ponctuation ou rarement employée, et une syntaxe qui rythme la structure du vers. Une disposition à la page qui fait sens tant la gestion de l’espace typographique est signifiante : strophes en retrait, groupes de vers détachés, la forme soutient le paradigme dévolu à un lexique servi par des mots appartenant au registre courant, afin d’étayer la totalité des envolées du signe.
Alors il n’est pas étonnant lorsque nous suivons ce parcours poétique de constater que cette prégnance du réel au discours en propose une lecture herméneutique. Les étapes du quotidien énoncées par Marie-Christine Brière ne sont qu’occasions d’ouvrir à une dimension qui en transcende les apparences. Et la parole poétique emporte alors au-delà des contours. Ainsi ce titre oxymore, telle la poésie du recueil qui dit les apparences et leurs revers, Flocons noirs :
De là-bas et si haut tout est oie
Mais tout n’est pas cygne
Les nuages tombèrent en suie
Un jour où nous avions gobé l’œuf
Entrées dans une maison à terre
Les mésanges de l’enfance
Ne pouvaient en sortir
Sans curiosité de nous
De là-bas en bas des gloires
Portaient bonheur pas de nuage
Sans frange d’argent dit le proverbe
Mais les humains occupés donnent
Miettes à celui-là le crucifié
Etonnés de trouver l’homme-dieu
Dément, torturé même à l’offert
Sur la table d’une brocante
A partir d’une lecture sensible du réel, Marie-Christine Brière mène le lecteur au seuil d’un univers poétique qui en dévoile les arcanes grâce à la puissance des images évoquées. Et cette ambition herméneutique des textes de Cœur passager ne se limite pas seulement à une percée métaphorique de la vie ordinaire. Elle se propose aussi d’énoncer une réflexion sur le langage, qui sous-tend certains textes du recueil. Cette écriture spéculaire invite donc le lecteur à s’interroger sur le signe, à l’envisager comme trace inaboutie mais capable dans sa dimension poétique de mener à une vision transcendante du quotidien :
L’Oiseau c’est trop
………
L’accent sur le mot ciel par mégarde
N’a même pas glissé au parapet où l’oiseau
-toujours sans nom-sifflote entre
deux silences. Comment faire sans livre
pour nommer, dessiner sur la paroi leurs
mécaniques de plumes vertes ? bleues ?
bleuvertes ? Le noir n’est que du gris
la mouette et son œil bouton
deviendra plus tard une bottine
Comment approcher du jeune né qui se
Cogne sur la pierre, l’ouvrier l’imitera
Sur son théâtre de planches
….
Comment rendre compte de cette perception accrue et sans concession des évidences, telle est la question que pose ici l’auteur. Comment énoncer une réalité si souvent violente, ancrer la poésie au réel mais ne pas l’y perdre.
Lire Cœur passager c’est se laisser embarquer dans l’univers de Marie-Christine Brière. La prégnance du quotidien ne fait en rien de cette poésie une poésie du réel. Bien au contraire, qu’il s’agisse de l’appareil paratextuel ou du choix d’une mise en œuvre syntaxique et paradigmatique qui permet les envolées sémantiques du signe, tout est prétexte à porter une réflexion sur la nature du langage poétique ainsi que sur l’ordinaire de l’existence dont l’auteur propose une lecture sensible. Les épigraphes sont à cet égard éloquentes : pour épigraphe d’œuvre, choisir une citation d’Anne Teyssiéras qui précède immédiatement une phrase de Philippe Jaccottet tirée de L’Ignorant, placée au début du premier chapitre, n’est pas neutre : ici s’énonce la volonté de se placer dans le sillage de ces auteurs et dit l’ambition de faire de la parole poétique un outil qui ouvre à une perception herméneutique du monde, et qui mène à son exégèse. Et Bernard Noël convoqué au chapitre trois sous le titre « Embarqués » soutient ces présences liminaires. La poésie est carte et boussole, outil et objet, nécessaires assemblages des signes qui peuvent rendre compte de ce regard prégnant, spéculaire, révélateur. Mais n’est-ce pas là, dans les déflagrations du signe, que se trouve l’accomplissement, que s’énonce la liberté ?
La Pédagogie
Mâchez la poésie
Mâchez le poème
Elèves inouïs
Sortis des bois à peine
Sauvages nez à nez
Avec ceux qui les ont écrits
vous êtes de ce monde
Ou alors naviguez
C’est le bon moment
Prenez le large
Dans le débris du bruit aigu
Des carreaux cassés
Dans les fuites des décharges
Dans vos minuscules incendies
Vos nuées oranges
Et jeux de cailloux
Carole Mesrobian (in recoursaupoème.fr, sommaire n°112, septembre 2014).
|
|
|