| Tri par titre
|
Tri par auteur
|
Tri par date
|
Page : <1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
|

|
|
Critiques
"Je voudrais pointer deux poètes qui incarnent un mouvement nouveau de la poésie française actuelle : l’un, Matthieu Baumier, avec Le silence des pierres (Le Nouvel Athanor), porteur d’une révolte blanche, froide et implacable ; l’autre, Christophe Dauphin, avec L'ombre que les loups emportent, poèmes 1985-2000 (Les Hommes sans Epaules éditions), porteur d’une révolte noire, fraternelle et conquérante. Les deux arpentent les terres de la poésie d’un pas ferme et avec une écoute chasseur expérimenté. Que leur prend-il alors de se dresser soudain ? Pourquoi veulent-ils en découdre, alors que leur culture devrait les attirer vers une poésie sagement communautaire ? Il y a chez l’un et l’autre la conviction que le « Recours au poème » agirait comme une arme salvifique sur le monde d’aujourd’hui ou que le poète est aujourd’hui le dernier « porteur de feu » nécessaire pour produire un lendemain. Fini donc le temps des recherches formelles, des plaintes délicates et lointaines ! Aujourd’hui – soudain – une gravité (Baumier) une urgence (les deux), une ivresse (Dauphin) mobilisent le poète au-delà de lui-même, le forcent (Baumier) ou l’exaltent (Dauphin) à sortir la poésie de sa dimension littéraire (synonyme d’échangeable, discutable, comparable…), pour revenir à sa dimension première qui est le débordement, l’impatience, l’inévitable, l’obligation d’une lutte à bras-le-corps contre le destin, qu’on pourrait définir en mots actuels comme une aspiration incontrôlable et séculaire à se défaire de l’idée de l’homme. Comme rappelée à sa vocation, leur poésie se condense, se fait muscle, arme et entraîne vers les horizons de « l’après fin du monde » (où nous sommes)… Il est aussi significatif de noter que l’un et l’autre animent collectivement des communautés de poètes à travers le site poétique de « Recours au poème » pour Matthieu Baumier et la revue « Les Hommes sans Epaules » pour Christophe Dauphin…
La poésie de Christophe Dauphin, comme l’introduit Jean Breton dans sa préface à L’ombre que les loups emportent, est un « feu » et « un coup de poing ». L’autre élément immédiatement pointé dans la préface et que je rejoins plutôt deux fois qu’une, c’est celui de guide lyrique qu’incarne Christophe Dauphin. Un guide sûr, généreux, solaire, riche d’une confiance jamais entamée. Un guide pour un combat toujours à mener : « Battons-nous jusqu’au jaillissement de l’homme », un soleil qui se fait noir par son besoin de justice et sa volonté de tenir l’homme libre. Plonger dans cette anthologie de près de cinq cents pages, c’est prendre l’océan d’assaut, retrouver l’appétit du large, des grands espaces et des rencontres. Essayons d’ordonner les impressions et sentiments que la lecture de ces poèmes souleva au long de cette traversée.
La première est la joie de retrouver si vivante la grande veine du surréalisme ; ainsi donc sa vitalité, son immédiateté ne sont pas mortes. Des poètes la portent fièrement et usent de ses moyens splendides. Exemples : « il est minuit / vos doigts ne servent à rien », ou « ton nom est la lame de mon couteau », ou « après la lune au regard d’ange, l’ouragan marche sur des planches ».
La deuxième est le plaisir, si rare, de trouver un grand poète français, c’est-à-dire, qui connaît le pulpe de notre langue et retrouver ces accents classiques qui donnent envie d’apprendre par cœur ses vers pour les réciter. Exemple : « Je suis l’enfant du grenier / où rien ne bouge » ou « Paris le bleu des vagues et l’ombre des réverbères ».
La troisième est la satisfaction d’un poète qui ose tout : le journalisme, le manifeste, le pamphlet, l’aphorisme, la prose, la vitesse, le collage, le parti-pris, le croc-en jambe. Le poète est un animal dangereux quand il traverse la rue. Exemple : « Je parle droit je parle net / je ne ravale pas mon crachat », ou « Mon adolescence fut banlieusarde /Une nuit noire à pied de biche / cigarette en main ».
La quatrième est la gravité d’approcher des confidences d’un cœur doué pour la rencontre, attentif, à l’écoute, qui accepte de se perdre dans l’échange. Exemple qui me touche particulièrement : « Le jour commençant / me dit Elodia Turki / ne dicte rien et nous devance », ou encore son attachement à une fraternité, sa reconnaissance et sa fidélité à une communauté de poètes et d’amis : « Dans la nuit mes amis / je retrouve vos visages ».
La cinquième est la complicité secrète à son anarchie qui mélange un communisme social et une protestation lapidaire proche de la Beat Generation (pensez au « Blind poet » de Ferlinghetti) ; « « le consommateur est un citoyen raté ». Ou « Choisissez vos armes : la Colère, la révolte ou l’Amour » (je suppose que Dauphin n’a pas choisi et a pris les trois). Ou « Un poète est un coup de poing dans la gueule du réel ». A lire intégralement, son poème « cela ne se discute même pas », dont je ne résiste pas au plaisir de vous donner quelques vers : « plutôt Maïakovski que le parti (..) / plutôt ma femme que la tienne ( ..) / plutôt mon enfance que mon adolescence ( ?..) / plutôt le nœud que le papillon (..) / plutôt le cri que le silence / plutôt la boucle que l’oreille (..) / plutôt oui que non (..) » La sixième est une adhésion profonde à l’ambition humaniste de sa poésie, fût-elle empreinte d’une volonté d’effacer Dieu de tout horizon (« Plutôt l’homme que Dieu »), car on ne peut trouver Dieu qu’en cherchant l’homme. Et c’est pourquoi, bien souvent, la poésie des poètes communistes, dont Dauphin est le fils spirituel, par leur simplicité et leur élan me semble porteuse d’une foi plus vivante (et plus riche) que bien des poètes chrétiens. Exemple : « Je est un pluriel de paupières / le poème est une rencontre humaine », ou « Mon usine / c’est l’amour que le poète construit / pour les autres – presque tous les autres ».
On ne peut que regretter le manque d’intérêt des grands critiques pour ce qui se passe en poésie. Pourquoi condamner au silence la vie et le dynamisme qu’on y trouve ? Pourquoi retirer cette pièce maîtresse de la création ? J’avoue ne pas comprendre. "
Pierrick de CHERMONT (in revue Nunc n°31, octobre 2013).
"J’ai eu la chance, enfin, de lire Christophe Dauphin il y a quelques années seulement. Que de temps perdu jusque là ! Et depuis sa parole, si proche, si justement essentielle, ne m’a pas quitté. Comme une voix d’ami dans les joies et dans les peines. Puis, lors d’un Printemps des Poètes, j’ai eu cette fois l’heur de passer deux jours avec lui, dans l’Eure justement, son département aimé. Nous étions un peu comme Laurel (moi) et Hardy (lui). Mais j’ai compris que cet homme intègre, vrai, serait effectivement un ami désormais quoi qu’il advienne : sa voix et lui ne faisaient qu’un. Et si j’ose parler d’amitié, de cette valeur suprême qui nous est commune, c’est que nous habitons tous deux sur une même île ouverte à tous les vents, tenus par la même conviction inébranlable quant à l’urgence du rêve et de la poésie. Comme moi, entre l’amour et la révolte, il choisit l’amour et la révolte ! Et je reçois aujourd’hui L’ombre que les loups emportent comme la confirmation de ce qui nous unit.
À voir l’ouvrage, on pense tenir là un pavé romanesque. Ou alors une de ces anthologies dont l’auteur a le secret : 461 pages ! Un ouvrage à la taille de ce colosse qui impose par sa stature avant d’en imposer par sa parole. Quelle audace ! Aucun poète n’ose aujourd’hui publier de tels volumes. On trouve dans L’ombre que les loups emportent les poèmes publiés par Christophe Dauphin de 1985 à 2000. À 32 ans, il avait déjà une œuvre derrière lui. Et quelle œuvre !
Dès ses premiers textes en 1985 (comme un Rimbaud, il n’a alors, et peut-être à jamais, que 17 ans) ce chantre de l’émotivisme écrit que « l’amour est à réinventer » et cet aphorisme augure, et ce de façon magistrale, de l’œuvre qui suivra. Dès ce moment, la poésie de Christophe claque, cogne et caresse comme une évidence et avec une sûreté extraordinaire qui n’est agie par nulle certitude mais par la vraie rébellion, par le plus brûlant amour. Christophe Dauphin nous fait croire plus que jamais à cette aventure fabuleuse des mots de sang qui est l’honneur des hommes.
Avec lui, la poésie est belle et rebelle. Belle parce que rebelle quand « La révolte et l’amour logent dans l’étoile de nos pas ». Belle aussi contre tous ceux qui voudraient enterrer le mot « beauté ». Nous avons là une écriture quasi incendiaire (le feu y est aussi présent que le cri), une poésie du sens multiplié bien au delà de cette polysémie absconse des petits maîtres qui trop souvent confine à l’insignifiance.
Il a trouvé le juste accord, la tonalité exacte de l’image surréaliste à hauteur d’homme. Une image d’une extraordinaire sensualité : « tes jambes prennent leur source dans mes mains » ; « ce sont les femmes qui m’inventent » ; « c’est une femme / Enroulée comme une bague autour de moi »… L’envie me prend de tout citer.
Dauphin, un grand poète ? Au diable ces qualificatifs éculés ; la poésie n’a pas à être grande mais à être vraie. J’ose dire ici simplement que Christophe Dauphin est peut-être le plus vrai poète français de ce temps."
Guy ALLIX (in Mediapart, le 1er décembre 2012).
"Les textes. L’acte créateur et vivificateur de donner, de se donner. De compromettre l’instance de repli, de retrait, pour l’amour d’une attente, d’une exigence, d’un simple relais dans le geste salvateur, instrumental du livre, dans le geste de penser, de dire, de transcrire : l’ensemble des recueils de Christophe Dauphin, s’étendant sur plusieurs années, pourrait s’entendre comme vingt-quatre heures de la vie d’un corps. D’un corps assurément né en poésie, à vocation précoce, fertilisant jusqu’à l’extrême de par ses forces et ses intentions, de par ses rigueurs oblatives, le mouvement même de la vie, et en lequel les fastes de tous les désirs sans faille ni dichotomie, à parts égales, dans une vigueur unitive, au plus profond s’inscrivent. Un corps d’un réservoir infini, une grille, une arche poétique, perpétuellement en alerte, un de ces « qui-vive », captant toutes les espèces d’étincelles, des plus fondamentales, des plus matérielles aux plus oniriques, et qui n’en aurait jamais fini de se tendre, d’éprouver, de se confronter. Vingt-quatre heures de la vie d’un corps qui naît sans discontinuer de sa quête, ses prismes intrinsèques, aussi de sa présence aux événements du monde, y apportant son « commentaire », au plus vrai, son commentaire concret et substantiel, au sens de se rendre au mystère, au sens de vivre et d’aimer, agissant pragmatiquement par le biais des écrits, érigeant sa beauté inté-rieure en vindicte, versant l’action des lettres dans l’indigence et l’immobilisme. Il y a, dans cet homme qui consigne, un chirurgien averti qui traite, avec les instruments de la parole et des signes, les plaies et les ulcères de son temps. Il y a un homme qui opère avec justesse et précision, les yeux ouverts sur l’infection, et s’achemine de guerre en guerre, de passion en passion, vers l’ouvert et la transparence. Car jamais les mains du poète ne se déprennent du matériau vivant, jamais elles ne battent pour leur propre compte ; je le répète, il y a dans sa cure d’écriture, une morsure guérissant tous les maux du dégoût de l’injustice et de la solitude. Christophe Dauphin est un meneur de rêves, de rêves solides, coriaces, de rêves d’élite qu’il lance dans le feu de toutes les batailles. Dressé, toujours nouveau dans son armement sensuel de mots - chez lui le verbe a un sexe -, dans une poétique efficiente du partage et de l’engagement. Car le comble de Christophe Dauphin est cette générosité de l’intelligence. Pour preuve, je cite l’ensemble de l’oeuvre et l’ensemble du corps, d’un seul tenant, prêt à défier, au seuil d’un poème d’avenir, tous les carcans de la désespérance."
Odile COHEN-ABBAS (in Les Hommes sans Epaules n°35, 2013).
"Christophe Dauphin est un poète majeur du monde contemporain, un poète qui assume pleinement la fonction d’éveilleur, fonction traditionnelle du poète. C’est dans le choix de l’alternative nomade que Christophe Dauphin transmet, avec une grande originalité, non une connaissance, mais un art de se relier librement au réel. Il maintient en alerte, une double alerte, l’une pour la personne afin qu’elle ne se laisse pas engluer par la bêtise envahissante, l’autre à la l’individu, la part indivisible, afin qu’elle préserve les chemins sinueux qui conduisent à l’être. Poèmes de queste, profondément initiatiques, voyages au centre de soi-même, ses textes sont sans concession au monde des apparences. C’est le réel qu’il veut, et rien d’autre, ce réel qui pointe dans le temps du rêve où les mots se défont pour s’assembler dans une langue inconnue qui résonne comme la cloche du monastère qui annonce l’heure du silence, tout prêt du sommet de la montagne. Réenchantement des mondes, les poèmes de Christophe Dauphin libèrent les espaces des carcans de préjugés des mondes normés afin que l’esprit se déploie. Après Totems aux yeux de rasoir, poèmes 2001-2008, ce nouveau recueil rassemble les poèmes de la période 1985-2000 dans un volume de près de 500 pages. Essayiste et critique littéraire, Christophe Dauphin, inscrit consciemment dans le poème continu de la vie, laisse une trace subtile avec l’encre des émotions."
Rémi BOYER (in incoherism.owni.fr, le 1er décembre 2012).
"Imprégné par les avancées du Surréalisme, Christophe Dauphin s’en est dégagé autant par son inspiration que par son écriture. Son livre est par excellence la somme qui le prouve. Elle permet aussi de voir un pan du chemin de celui qui caresse l’utopie comme il ouvre parfois à des chants moins sereins. Adepte des voyages sous toutes ses formes, « par la rivière Kwai » comme sur « les pas de Baudelaire dans les voiles », de la nuit mexicaine aux touffeurs de Samarkand, à travers un tableau de Monet, de Madeleine Novarina ou de Frida Khalo le poète est toujours au plus près de la vie : le monde est là. L’idéalisme du poète ne l’expurge pas de ses miasmes. De même sa propension à l’absolu ne prive pas le lecteur de toute une sensualité. Dauphin crée une œuvre qui se dérobe à l’ombre même s’il se dit « un crépuscule aux mains coupées ». Et si la poésie ne sauve pas elle cicatrise un peu. Certes la peau est souvent prête à éclater à nouveau, le sang pulse mais il n’empêche que l’écriture métamorphose tout – jusqu'au « collier de Buick et de Lada » sur l’île de Cuba.
Il existe dans une telle œuvre des sortes de narrations plastiques poétiques qui forcent l'espoir en luttant contre la réalité lorsque nécessaire. L’écriture est donc la source de la résistance à la vérité instrumentalisée comme à l’amour déçu. La femme y est d’ailleurs présente de manière paradoxale, hors champ. Et le poème devient parfois par-delà la douleur le lieu sourd de rêves provoqués par les attentes que la femme comme les lieux provoquent. Dans ces derniers réside toujours quelque chose d’intime qui joue de l’entre deux : l’ici et le là-bas, l’avant et l’après.
Le visible et l’énoncé suggèrent de l’invisible et du tu, du nous, du liant et du lien – c’est d’ailleurs une idée mère chez Dauphin. Un tel livre permet de traverser les couches sédimentaires d’une œuvre et d’une existence. Certes son contenu ne se confond pas avec le signifié. Dauphin élabore des énoncés qui n’ont rien de « médico-légaux». Ils expriment un état particulier de la visibilité du monde et de la profondeur des émotions et leur charge d'ineffable que l’artiste engendre et nourrit. Chaque texte révèle le cri de vie, d'amour, d'exigence intérieure. C’est pourquoi il se conçoit comme un espace à relire et relire pour découvrir ce qu’il en est - par-delà le poète - de l’être et de ce qui le met en question et l’affecte dans sa relation au monde. "
Jean-Paul GAVARD-PERRET (in incertainregard.hautetfort.com, 7 octobre 2012).
"Ce n'est pas la première fois que Christophe Dauphin rassemble dans un gros livre ses poèmes de longues périodes de son passé, soit une production incroyablement imposante. Ce fut d'abord Totems aux yeux de rasoir, poèmes 2011-2008 (lire Inédit Nouveau n°248) et maintenant L'ombre que les loups emportent, qui rassemble les poèmes publiés et/ou inédits, de la période allant de 1985 et 2000. Par conséquent cette fois, des poèmes de jeunesse. On y retrouve d'ailleurs les préfaces, très instructives, de Jean Breton, Henri Rode et Alain Breton. Le temps écoulé indique que le poète a changé, et cela aussi aide à mieux comprendre les différences. car Dauphin ne cesse de modifier son approche de la poésie. Il a même lancé le terme d'"émotivisme". Pas pour se séparer de son surréalisme d'origine, auquel il reste absolument fidèle, mais pour marquer sa place dans l'histoire littéraire... Dauphin n'hésite pas à présenter ses successives admirations, sinon ses révoltes, comme cela est le cas, à travers l'assassinat de Malik Oussekine en 1986, mais aussi ses réflexions, qui le construisent aux yeux du lecteur. Quelques exemples: "L'amitié, je la porte comme une écharpe qui réchauffe", ou: "Un ami est quelqu'un avec qui on peut se taire sans s'ennuyer." Un peu plus loin, c'est la poésie qui prend le relais: "Il n'y a que la poésie qui soit vie, tout le reste n'est que boniments." Plus loin encore, Rode le signale: "Christophe Dauphin sait exalter les grands humiliés du temporel par le sentiment", et lui-même refuse "le mètre classique." D'un voyage au Mexique, il a rapporté Frida Kahlo et toute la civilisation aztèque. Décidément, Dauphin est un poète du monde entier ! "
Paul VAN MELLE (in Inédit Nouveau n°260, janvier 2013, La Hulpe, Belgique).
"Avec L'ombre que les loups emportent, Christophe Dauphin rassemble ses poèmes de 1985 à 2000. A ceux qui croient que le surréalisme est mort comme à ceux qui espèrent qu'il est (vraiment) toujours vivant, je conseille cet ouvrage constellé de comètes verbales et d'aphorismes pyrotechniques: "Le printemps est un révolver d'herbes claires". "Il est minuit - Vos doigts ne servent à rien". "La nuit est une gare aux pas invisibles". Oui, le surréalisme - mais humaniste et pas dictatorial à la Breton - est bien vivant. Christophe Dauphin l'actualise sous le nom d'émotivisme."
Roland NADAUS (in Le Petit Quentin n°283, mars 2013).
CE POETE SE NOURRIT DE LA VIE.
" Seule la poésie est vie, tout le reste n'est que boniment ou subsistance", entend démontrer le poète Christophe Dauphin, dans L’ombre que les loups emportent. Christophe Dauphin signe un recueil de poèmes en prise directe avec le monde. Reconnu par le milieu littéarire, l'artiste est originaire de Nonancourt (Eure) où il naît en 1968, dans une demeure de famille acquise depuis plusieurs générations. Il y vit avec ses grands-parents jusqu’à l’âge de 3 ans avant de rejoindre ses parents à Colombes (Hauts-de-Seine). Leur logement surplombe un bidonville où survivent des immigrés de tous bords politiques. L’enfant n’a pas pleinement conscience de cette situation potentiellement explosive mais il observe et s’imprègne de ces images. Pendant les vacances, il retourne dans l’Eure. Son grand-père lui transmet son esprit d’« ouverture culturelle, sa fibre littéraire et sa passion de l’Histoire ». A 9 ans, Christophe découvre Napoléon, Flaubert et Maupassant. Il lit, dessine, s’interroge à propos de la Société et écrit des poèmes. Cette enfance, suivie d’une adolescence tourmentée, constitueront la « matière vivante » de son art poétique. « On naît et on est poète », dit-il. Christophe rencontre des hommes illustres (Léopold Senghor), des écrivains, des poètes (Jean et Alain Breton, Henri Rode). Il se reconnaît dans le surréalisme (une influence qui correspond à l’intrusion du rêve dans la réalité) et dans un courant de la poésie contemporaine dénommé La Poésie pour vivre qui se veut non-élitiste, « émotiviste »* et en lien avec le monde. Jean Breton le définit comme « le poète-phare de sa génération ». A 45 ans, l'Eurois a derrière lui une œuvre constituée d’une trentaine de recueils, essais, anthologies, critiques littéraires. Il est aussi Directeur de l’une des plus prestigieuses et ancienne revue Les Hommes sans Epaules.
* La poésie émotiviste par l’exemple : « Le cœur en papillote - Je tremble d’amour - Dans le calme d’une rue peinte par Giorgio de Chirico » : devant une œuvre plastique du peintre italien Chirico, « chef de file de la peinture métaphysique », le poète ressent une émotion intense proche du sentiment d’amour. « Si le mot oiseau ne vole pas - l’idée me donne des ailes » : l’auteur fait appel à un souvenir. Son ami poète Jean Rousselot lui avait dit que « le mot oiseau comportait toutes les voyelles et que c’était ce qui lui donnait des ailes ». Ici, le poète utilise le pouvoir des mots pour signifier que le mot oiseau vole. « Ne lâche jamais la vie - elle te lâchera elle-même - toujours assez tôt » : en faisant sienne la pensée « Je cherche l’or du temps » d’André Breton, fondateur du surréalisme, l’auteur signifie qu’il faut savoir saisir les doux moments de la vie.
Marie-France Escofier (in Paris Normandie, 25 mars 2013).
"Si vous vous interrogez sur ce qu'est devenu le dadaïsme, le surréalisme, le communisme, la beat generation, ces courants que la flamme poétique embrasa, lui donnant son excès, sa révolte, sa vitesse, son immédiate simplicité, et que vous regardez notre siècle comme une plage à marée basse où le sable, à peine mouillé, si peu scintille et la mer, si loin, trop se confond avec un ciel irréel, ouvrez, ouvrez cette anthologie des poèmes de Christophe Dauphin. Tout est là, généreux, ouvert, fraternel. Aucune nostalgie, mais "la même innocence essentielle" comme l'écrivit Henri Rode. La discussion à peine interrompue, reprend. La parole retrouve ses habits du grand libre. Tout redevient force, envie, combat, rêve, camaraderie. La poésie, à nouveau prolixe, arrose tout ce qu'elle touche, ravive, rafraîchit, reprend le combat au nom de la conscience universelle, se laisse pénétrer par le monde; mourra - nous le savons - sera "l'ombre que les loups emportent", mais les chants qu'elle nous offre, nous feront frères et soeurs des étoiles, des fleuves, des rêves des hauts fonds qui nous rendent plus grands que nos larmes. Dites avec lui, au moins une fois: Je parle de l'homme libre - L'homme aux paupières de fleurs électriques - Que j'étais - Je suis - Je serai."
Pierrick de Chermont (in revue Nunc n°30, juin 2013).
"Selon moi, Christophe Dauphin écrit à main armée. Puisqu’ici c’est le poète qui est évoqué, il est inimaginable - comme pour Michel Voiturier - de concevoir son travail de création annexe ou parallèle à celui du critique, du biographe, de l’animateur des Hommes sans Épaules, agitateur de mémoires sans nostalgie et sentinelle insomniaque sur la ligne de front de la création contemporaine. Il propose dans ses poèmes une lecture boulimique de l’existence, de l’être pris au piège des désirs les plus inutiles de l’humain, ce qui revient à dire : vivre. Christophe Dauphin propose de vivre. Contre la pédanterie, parfois contre soi. Même. N’aurait pas manqué d’ajouter Rrose Sélavy. Christophe Dauphin n’est pas un poète de Poësie, mais de l’intelligence au service d’un quotidien. Il évoque Malik Oussekine. Son poème ne prend pas de coups : il saigne. Christophe Dauphin est l’instant même. Il est toujours possible de dévier avec les fausses toiles « sur le motif » des Impressionnistes d’aujourd’hui. Toute modernité qui se prévaut d’elle est mondaine. Christophe Dauphin comme Michel Voiturier sont aujourd’hui et n’ont pas besoin de se prétendre poètes pour donner ce qu’aucune autre forme de langage n’aborde. Rentrer ici dans les diverses conceptions de la poésie - chacune jamais partagée que par celui-là même qui a développé la sienne - est futile. Lorsque je lis ou entends des poèmes de ces deux-là, unis par l’amitié qui me lie à chacun d’eux, j’espère fermement que c’est bien de cela qu’il s’agit : s’entretenir.
Éric SÉNÉCAL (in Les Hommes sans Epaules n°37, 2014).
*
"Poésie de l'émotion qui s'insurge contre les maux du siècle."
Electre, Livres Hebdo, 2013.
*
Je n’imaginais pas écrire une lettre ouverte aujourd’hui. Mais Jean-Pierre Thuillat me rappelle amicalement que je n’en ai pas écrit depuis longtemps pour la revue. Et comme je viens de consacrer une émission RCF (« Dieu écoute les poètes ») à Christophe Dauphin, j’ai pensé que je pourrais la prolonger ici, dans ce numéro 118 de Friches.
Justement, commençons : Christophe Dauphin s’auto-proclames athée, parfois à grand renfort d’imageries surréaliste : il a écrit, par exemple, une charge violente contre et pour (« Thérèse, Cantate de l’Ange vagin », éditions Rafael de Surtis, 2006) celle que j’appelle « ma copine » : Thérèse Martin, plus connue sous le nom de sainte Thérèse de Lisieux et à laquelle j’ai, alors maire de Guyancourt, consacré une voie publique… parce qu’elle était aussi poète… Il est vrai que cette grande petite sainte est, comme Dauphin, Normande et que ce dernier porte en lui profondément ce que Léopold Sédar Senghor, dont il fut l’ami et par certains côtés le disciple, appela sa « normandité ». L’œuvre poétique de Christophe Dauphin y fait très souvent référence avec bonheur et il a même consacré une belle anthologie aux poètes en Normandie du XIe siècle à nos jours : « Riverains des falaises » (éditions clarisse, 2012).
A propos de l’anthologie, Dauphin, qui est un boulimique de la lecture et de l’écriture, a également publié « Les riverains du feu » (Le Nouvel Athanor, 2009), un ouvrage anthologique dédié aux poètes qu’il rassemble sous le vocable émotivisme ». Ce concept, qu’il développe et qu’il illustre de cinq cents pages et qui reprend des extraits de recueils de plus de deux cents poètes (!), est au cœur de sa pensée et son écriture.
Car si Christophe Dauphin s’insère dans une filiation surréaliste, ce n’est pas pour singer un mouvement disparu, mais au contraire pour en poursuivre l’esprit – dont il juge qu’il est toujours extrêmement vivant. Et il est vrai que ses poèmes brillent souvent d’un éclat surprenant grâce aux images dont il a le secret et qui laissent le lecteur pantois et admiratif devant leur inventivité et leur puissance. Dans son recueil, « Le gant perdu de l’imaginaire » (Le Nouvel Athanor, 2006), qui est un choix de poèmes écrits entre 1985 et 2006, on en trouve à toutes les pages, ainsi à la première :
« La lune a mis ses bretelles sur l’idée de beauté
Un train déraille dans la bouteille de la nuit
Il est temps de décapiter la pluie
D’égorger l’orage… »
Mais si j’ouvre ce beau recueil à n’importe quelle autre page, je reconnais le poète prince de l’image, roi de la métaphore :
« Le sourire d’une femme est la lame de fond du regard
Debout entre trois océans »
Il faudrait aussi parler de son livre « Totems aux yeux de rasoirs » (éditions Librairie-Galerie Racine, 2010), préfacé par son ami Sarane Alexandrian, qui fut le très proche collaborateur d’André Breton et le directeur de la revue « Supérieur Inconnu », à laquelle Dauphin collabora. Ou bien encore parler de ce gros ouvrage recueillant des poèmes, des notes, des aphorismes : « L’ombre que les loups emportent (Les Hommes sans Epaules éditions, 2012). Henri Rode surnomme Christophe Dauphin « l’ultime enfant du siècle et la fête promise ». C’est que, très tôt, dauphin a senti bouillonné en lui la poésie, indissociable de la révolte et de l’amour.
L’amour n’est d’ailleurs pour Dauphin pas loin de l’amitié à laquelle il sacrifie fidèlement notamment à travers la revue qu’il dirige : « Les Hommes sans Epaules », qui a d’ailleurs consacré une anthologie à ses collaborateurs de 1953 à 2013 sous le titre « Appel aux riverains » (Les Hommes sans Epaules éditions, 2013). A ce propos, il faudrait aussi évoquer son œuvre considérable de critique littéraire et de critique d’art. Dauphin a décidément une capacité de travail et de création qui, au sens propre, m’époustouflent !
Et comme il est encore jeune, bien que dans l’âge mûr, je lui souhaite de continuer ainsi avec la même vigueur et la même ferveur. Maintenant qu’il est devenu secrétaire général de l’Académie Mallarmé, il n’en aura que plus de force pour défendre et illustrer la poésie contemporaine, et pour soutenir ses créateurs.
Fraternellement en notre diversité,
Roland NADAUS (cf. « Lettre ouverte à Christophe Dauphin », in revue Friches n°118, mai 2015).
|
|

|
|
Critiques
"En février 1953, Jean Breton et Hubert Bouziges lançaient, sous le titre Les Hommes sans Epaules, ce qui allait devenir un mouvement, une collection et une revue, toujours vivante et rayonnante. Rares sont les revues qui, dans le domaine des idées et de la création, savent se renouveler pendant plusieurs décennies. En proposant une anthologie très complète de cette aventure, Appel aux riverains, Les Hommes sans Epaules Anthologie 1953-2013, (Les Hommes sans Epaules éditions, 2013), Christophe Dauphin permet au lecteur d’appréhender l’histoire et les mutations d’un mouvement et d’une revue de poésie qui se caractérisent par la richesse, la diversité et une exigence constante. En cinq cents pages, Christophe Dauphin nous offre une vision globale de cette aventure poétique sans gommer ses particularités, ses aspérités, ce qui la singularise dans le monde complexe de la création. La première partie de l’ouvrage rassemble des manifestes, des textes théoriques qui laissent apparaître une cohérence de pensée et une cohérence éditoriale fortes. La seconde partie rassemble une large sélection de poèmes de deux cents auteurs différents.
L’orientation de la revue est saisissable dans les manifestes et dans certains écrits de Jean Breton : « Seul à jouer au meccano du monde, à l’amour, le poète exaspère ses limites. Nous rêvons que son ambitieuse quête, que sa fouille minutieuse de la langue ne soient pas perverties par une futile autant que dérisoire volonté de prise de pouvoir sociale ! (…) L’important, en tout cas ici, est de signaler, de souligner l’émergence ou la permanence de nombre d’auteurs de qualité, ainsi que « les bonds en avant » de certaines œuvres. Par des textes de présence et de diversité, où l’ironie sera compagne de l’angoisse, où la poésie tentera de « préparer souterrainement un homme meilleur qu’elle ». Que nos auteurs d’avance soient remerciés pour ce don qu’ils ont de nous enchanter si tant est qu’ils ne sont que des hommes et des femmes « sans épaules », c’est-à-dire sans poids dans la société mais aussi fragiles porteurs d’antennes attentives à capter ce qui reste de la parole originelle. Et à promouvoir ce qui peut venir de la parole future. Bonjour, poèmes ! »
« La poésie n’est pas grand-chose dans le panorama des machines et des chiffres. Encore faut-il le cerner, ce pas grand-chose – au meilleur de sa forme ! Nous disons tous la même chose : mais les mots du poème, selon notre écoute comblée, sont toujours neufs. Ils déclenchent une nouvelle genèse, le monde recommence à partir d’eux. La banalité est le matériau de base, mais sculptée par un œil, une main et un cœur originaux. Une définition de la poésie parmi d’autres ? Ce serait un combat entre les sens et l’héritage culturel et linguistique, le tout fouetté par l’émotion. (…) A quoi sert le poème ? A pas grand-chose. Mais pour certains ce pas grand-chose est tout. Le poème neuf ajoute des vitamines à nos élans, c’est la grâce du style. Il resserre nos thèmes en nous. Il nous éclaire sur nos ombres. Il résume sans doute pour l’historien de demain – comme en télégrammes – un état de la sensibilité, de la perception sensorielle, du progrès linguistique, il devient un condensé du contexte historique et social de notre époque en même temps qu’un fragment imprévu, toujours un peu en avance, de l’universel. »
Evoquant Charles Fourier, qui invite à l’accomplissement de nos singularités, mais aussi Stanislas Rodanski et sa révolte sans fin, Christophe Dauphin rappelle que « La révolte a un langage : la poésie. ». Mais, ajoute Christophe Dauphin, le poète n’est pas seulement celui qui lance un cri de colère et d’indignation, il est aussi le guérisseur, au sens antique sans doute du terme, celui qui réconcilie avec soi-même, les autres et les mondes. Il nous parle de redressement, de surgissement, de liberté. Il est une quête poétique qui ne supporte aucune concession à l’arbitraire afin de laisser libre la place pour l’être, y compris en ses contradictions. Ce volume, plongée sans retenue, dans l’univers poétique d’un mouvement créateur, qui veut « préparer les hommes », est aussi, contre l’aphasie, la démission, la distorsion, une invitation à la vie et à l’amour. Maurice Toesca exhorte ainsi un jeune homme : « Passionne-toi, croyant ou non-croyant. Livre-toi tout entier au plaisir d’être. Où que tu sois, il y a un chemin qui va vers ton plaisir. Sache le reconnaître. Et tu verras que la vie est un passage grandiose. »."
Rémi Boyer (in incoherism.wordpress.com, 21 octobre 2013).
"Appel aux riverains, Les Hommes sans épaules, anthologie 1953-2013. C’est une longue histoire que nous donne à parcourir ce fort volume : fondée en 1953 par Jean Breton et Hubert Bouziges, Les Hommes sans Epaules peut s’enorgueillir d’une extraordinaire longévité – même si des aléas l’ont pendant un temps suspendue. Longévité marquée par « une grande cohérence éditoriale, mais aussi une vraie richesse, une ouverture et une diversité assez étonnante » souligne Christophe Dauphin qui dirige aujourd’hui la revue. La preuve en 206 poètes : chacun présenté par une notice bio-bibliographique très détaillée et par le choix d’une œuvre. Des textes théoriques, manifestes et critiques (J.Breton, H.Rode, Pierre Chabert, Sarane Alexandrian, Christophe Dauphin) ouvrent le volume, toute revue étant qu’elle le clame ou non l’expression d’une esthétique, d’un combat, d’une affirmation, d’une communauté. Se succèdent ensuite les figures des poètes qui font leur apparition au rythme de l’alphabet. De Max Alhau à Saadi Youssef qu’on juge de la diversité par quelques noms : Jacques Baron, Georges Bataille, Michel Butor, Tristan Cabral, Aimé Césaire, Mahmoud Darwich, André Frédérique, Lorand Gaspar, Ginsberg, Kadaré, H. Miller, Paz, Vesaas. Ces derniers cités pour suggérer que la poésie d’ailleurs a toujours eu une place de choix dans les HSE, pas moins que celle – et ce n’est pas si fréquent – des femmes : Gabrielle Althen, M.C Bancquart, Lise Deharme, Béatrice Douvre, Vera Feyder…Mais toutes ces signatures fameuses ne doivent pas faire oublier que la revue – et l’anthologie y fait justice – a toujours su, et aujourd’hui encore, accueillir de jeunes auteurs ou des œuvres méconnues. Histoire exemplaire d’une revue qui a su « comprimer » dans ses pages et par-là même exprimer les mondes poétiques de son temps, ceux pour lesquels le poète, guetteur et explorateur, s’aventure dans les « arcanes de la vie intérieure »."
La Revue des Revues (entrevues.org, le site des revues culturelles, octobre 2013).
"Le soixantenaire de la revue Les Hommes sans Epaules a servi de prétexte à Christophe Dauphin pour composer ce pavé anthologique qui se lit agréablement car le responsable a su mettre tous les atouts de son côté. La première partie du livre, couvrant 88 pages, s’attarde à présenter manifestes et critiques autour de l’aventure de cette singulière revue qui a su perdurer à travers trois séries. En rassemblant 204 auteurs publiés dans les HSE, Dauphin a choisi de les disposer dans un ordre alphabétique avec, pour chacun d’eux, une notice bio-bibliographique suivie d’un écrit représentatif. L’originalité de cette initiative entraîne pour le lecteur un regain de curiosité qui va le pousser au gré de son humeur à passer d’un poète à l’autre, et là, il va aller de surprise en découverte et de confirmation en révélation. Si l’on y croise des poètes « classiques » tels qu’André Breton, Jean Cocteau, Aimé Césaire ou Michel Butor, on y croise des auteurs rares comme Alain Borne, Lucien Becker, Jean Malrieu ou Ilarie Voronca. Une part importante est accordée aux poètes étrangers parmi lesquels Octavio Paz, Eugenio Montale ou le Prix Nobel 2011 Tomas Tranströmer, sans compter avec des dizaines de débutants. Menée de main de maître, « au scalpel de l’émotion », cette anthologie est une réussite et le témoignage parfait de ce que peut donner une passion dévorante alliée à une grande connaissance de la poésie vivante."
Georges Cathalo (Lecture flash in revue-texture.fr, 4 novembre 2013).
"La revue Les Hommes sans Epaules fête ses 60 ans d'existence. Noces de diamant célébrant le mariage en 1953 entre la poésie et un outil de rassemblement et de diffusion que les fondateurs nommèrent Les Hommes sans Epaules. Deux jeunes poètes, Jean Breton et Hubert Bouziges, sont à l'initiative de cette revue de fond. Fond par le sens, fond par la durée car il faut du souffle pour ne jamais s'épuiser en 60 ans d'existence. La durée des Hommes sans Epaules est d'ailleurs le signe de la grande vitalité qui anime l'humain désireux de ne pas lâcher la ligne de crête faisant de lui un homme de parole. Cette anthologie, rassemblant dans une première partie les textes et manifestes qui émaillèrent depuis sa création cette superbe revue, est la preuve que le poème habite l'homme, et qu'il est en lui, malgré les désastres sociaux et politiques, une ligne rouge constitutive de la personne humaine.
Christophe Dauphin, l'actuel directeur des Hommes sans Epaules, orchestre cette anthologie, racontant, dans une introduction de conviction, la riche histoire de cette revue. S'ensuivent des textes de Jean Breton, de Sarane Alexandrian, d'Alain Breton, de Pierre Chabert, d'Henry Miller, de Paul Sanda, de Guy Chambelland, de Christophe Dauphin, de Paul Farellier, d'Abdellatif Laâbi, d'Henri Rode et de Maurice Toesca.
Cette anthologie se nomme Appel aux riverains, en filiation avec le premier manifeste signé par la rédaction des Hommes sans Epaules de 1953, dans lequel les initiateurs affirmaient : "N'étant pas des esthètes, n'exigeant jamais une seule forme du poème, nous savons aussi que la poésie se cache dans l'équivoque, se déploie dans l'éloquence, se dénonce dans le silence. (...) La poésie prépare souterrainement un homme meilleur qu'elle. (...) Notre revue est un lieu de rencontres. Nous ouvrirons les portes, les laissant battantes, nous inviterons nos amis à s'expliquer sur ce qui leur paraît essentiel dans leur comportement d'être humain et de poète. (...) Nous désirons redéfinir notre condition de poète et de vivant."
Voilà qui fait un sérieux point commun entre la démarche des Hommes sans Epaules et celle de Recours au Poème, l'une revendiquant l'émotivisme, l'autre la profondeur, à travers un rassemblement poétique savamment dilapidé par la modernité technologique qui est l'ennemi même du Poème.
60 ans d'Hommes sans Epaules, c'est l'occasion, non pas de publier une anthologie anniversaire, mais d'affirmer la continuité du poème contemporain. Car après la série des textes et manifestes posant le combat du poème sur une soixantaine de pages, s'ouvre l'anthologie de poèmes proprement dite, soient 400 pages constituant une belle et sérieuse anthologie poétique de ces soixante dernières années.
Noces de diamant, disions-nous. C'est ainsi à la résistance du poème que se découpe la vitre sans tain de la Surface, sur laquelle l'image de la superficialité est peinte et rénovée en permanence afin de créer l'illusion que la réalité est toute contenue dans ce décorum.
Illusion. Simulacre. Superficialité. Imposture. C'est cela que le poème déjoue. C'est cette vitre, cette séparation, accentuée par la première modernité mortifère, que le poème traverse.
1953 : c'est l'année du début de l'équilibre de la terreur, les USA annonçant qu'ils détiennent la bombe H. C'est le choix, par Eisenhower, du conservatisme progressiste, qui renoue avec le libéralisme économique total. Ce sont les prémisses du totalitarisme d'affaire. 1953 : c'est la description de l'ADN, c'est le prix Nobel de la Paix attribué à Georges Marshall, c'est la mort de Staline, c'est la première retransmission internationale d'un événement en direct par la télévision, le couronnement d'Elizabeth II.
Dans ce contexte de redéfinition du monde d'après-guerre, avec la peur de l'atome, le choix du libéralisme et l'outil propagandiste de la télévision, naît la revue Les Hommes sans Epaules. C'est dans ce contexte d'essais nucléaires, d'explosions dans le ventre mère de la terre, de manipulation des esprits par le projet de divertissement de la télévision, c'est à dire, étymologiquement parlant, de faire diversion, qu'apparaissent les Hommes sans Epaules, ces "hommes et ces femmes sans poids dans la société mais aussi porteurs d'antennes attentives à capter ce qui reste de la parole originelle" comme l'écrit Alain Breton dans son essai "Ralentir, Poèmes".
Aucun poids dans la société, et n'en revendiquant aucun, "poètes engagés, nos frères dans la passion, pourquoi ignorer que la politique militante du poète, c'est tout simplement le ton généreux de son poème ?" écrit Jean Breton, conscient qu'être poète, c'est refuser la reconnaissance et la stature sociale, mais agir et dans le silence de son action, qui signifie amour, composer des poèmes car la vie l'intime absolument.
Plus loin, Christophe Dauphin déclare : "Le combat intime du poète est le combat de tout être avec les forces de la mort, l'oppression, les murs aveugles et sombres des systèmes sociaux. La poésie est inséparable de l'essence de l'homme dont elle est la plus impalpable, mais la plus profonde substance ; il la porte en lui avec sa solitude et son amour. La poésie préside partout où il va par le seul pouvoir des yeux".
Oui ! Qu'un poète soit "engagé", qu'il écrive des poèmes "dénonciateurs", qu'il arme sa parole pour répondre à l'injustice démultipliée, qu'il soit révolté, la fonction du poète est d'appartenir à la Paix et d'y travailler cordialement. Fraternellement.
Le Poème relève fondamentalement de la Paix et de son désir.
Plus loin, Dauphin précise : "La poésie est un besoin et une faculté, une nécessité de la condition de l'homme - l'une des plus déterminantes de son destin. Elle est une propriété de sentir et un mode de penser".
C'est dire qu'ici, il est davantage question de vision que de démonstration argumentée. Le poète réfléchit le monde et l'existence, il réfléchit sur le monde et l'existence. Et son mode de pensée n'a rien à voir avec les discours et les raisonnements. Il sait discourir. Il sait raisonner. Son mode de pensée transcende cela. Car il sait, le poète, quel fléau les émules du cartésianisme a pu introduire dans l'être, dans l'individu et dans l'ensemble humain avec la rationalisation n'ayant pour seul horizon qu'elle même. C'est d'ailleurs l'une des explications qui permettent de comprendre pourquoi l'intelligence du poète et la puissance du Poème sont aujourd'hui reléguées aux oubliettes et méthodiquement dépréciées. La rationalité ne voit plus que son propre visage pour objectif, fascinée par le jour et la clarté. La vision du poète, comme le langage du peintre, savent danser avec l'ombre et s'appuyer sur le vide pour prendre leur appui et converser avec la présence. Le Discours et la Méthode ont conquis le monde, contre la vision, complexe mais pas compliquée, subtile mais pas obscure, du poète. Le Discours et la Méthode travaillent à la ruine de l'homme, ils œuvrent à l'appauvrissement écologique de l'humain sur la terre. Mais la vision appartient à tout homme d'esprit. Et la Nature saura reprendre image dans le corps humain. Car son élan n'est pas de disparaître. Suivons Dauphin : "ce qui est, ce n'est pas ce corps obscur, timide et méprisé, que vous heurtez distraitement sur le trottoir - celui-là passera comme le reste - mais ces poèmes, en dehors de la forme du livre, ces cristaux déposés après l'effervescent contact de l'esprit avec la réalité. Autrement dit, le rêve entre en contact avec la réalité, c'est à dire le concret, le sensible, le monde des apparences qui suffit au commun des mortels. De cet effervescent contact résultera la poésie, c'est à dire "le réel absolu" pour Reverdy".
Lisez cette anthologie. Elle branche le cœur sur le vivant. Elle raccorde l'esprit au sang. Elle fait bouillir l'hémoglobine dans les veines. Vous y rencontrerez le meilleur de la poésie contemporaine à travers quelque 200 poètes. Et même s'il ne fut pas possible d'intégrer dans ce vaste travail l'ensemble des poètes publiés dans Les Hommes sans Epaules, ceux qui y sont vous donneront déjà une idée substantielle de ce que peut le poème pour l'homme."
Christophe Morlay (in recoursaupoème.fr, décembre 2013).
"L'anthologie 1953-2013, Appel aux riverains, rassemble des textes théoriques et des manifestes dans sa première partie, des poèmes dans la seconde. Cette émotion appelée poésie, disait Pierre Reverdy; émotivisme, nous dit Christophe Dauphin, qui rappelle que la révolte à un langage: la poésie. Il ajoute ailleurs, le poète n'est pas seulement celui qui lance un cri de colère et d'indignation, il est aussi le guérisseur, au sens antique sans doute du terme, celui qui réconcilie avec soi-même, les autres et les mondes. Il nous parle de redressement, de surgissement, de liberté. Il est une quête poétique qui ne supporte aucune concession à l'arbitraire afin de laisser libre la place pour l'être, y compris en ces contradictions. Jean Breton en citant Michel Serres ne disait pas autre chose: Etymologiquement, émotion veut dire: ce qui fait bouger. ce n'est pas avec des concepts ni des courbes que l'on fait bouger les choses, c'est avec de l'émotion. Dans cette superbe anthologie, plus de 204 poètes mêlent leurs voix afin de proposer une lecture globale des Hommes sans Epaules."
Gérard Cathala (in Arpo n°78, hiver 2014).
"Les Hommes sans Epaules, c'est une aventure hors-pair qui a débuté en 1953, à l'initiative de deux jeunes poètes Jean Breton et Hubert Bouziges... Soixante ans après leur fondation, Les Hommes sans Epaules est une copieuse revue semestrielle de 285 pages, aux sommaires riches et variés. Elle revendique l'héritage de la Poésie pour vivre, mais aussi la filiation du surréalisme et de quelques grandes voix solitaires comme celles de Guy Chambelland et d'Yves Martin et veut en faire la synthèse par le recours à ce que Christophe Dauphin nomme l'émotivisme, et présente non pas comme une nouvelle école esthétique, mais comme la recherche d'un art vivant vécu comme une nécessité....
Les Hommes sans Epaules éditent aussi des ouvrages sous son propre nom ou en tant que collection des éditions Librairie-Galerie Racine. Parmi les auteurs, Yves Mazagre, André Prodhomme, Alain Breton, Paul Farellier, Eric Sénécal, Pierrick de Chermont ou récemment Odile Cohen-Abbas. Parmi les ouvrages publiés à l'enseigne des HSE, je retiens l'impressionnante anthologie personnelle de Christophe Dauphin, L'Ombre que les loups emportent, regroupant son oeuvre poétique de 1985 à 2000, révélant une poésie sensible et fougueuse, authentiquement accordée à l'humain. Christophe Dauphin est également le maître d'oeuvre de la copieuse anthologie Appel aux riverains, choix de 206 auteurs publiés dans la revue de 1953 à 2013, qui prend pour titre celui du premier manifeste du groupe. Rien qu'en parcourant l'ouvrage, on réalise que le projet est bien plus qu'un simple retour sur l'itinéraire d'une revue à la longévité exceptionnelle. On est d'emblée surpris d'y trouver l'essentiel de la péosie contemporaine de ces dernières décennies, dégagée de tout parti-pris esthétique. Christophe Dauphin délaissant la chronologie a opté avec raison pour l'odre alphabétique des auteurs. Apparaît alors un large et saisissant panorama des auteurs qui marqueront durablement la poésie quand notre époque aura oublié les amusuers interchangeables qui nous divertissent gentiment par leurs exercices de langage. La poésie a bel et bien survécu à ses fossoyeurs zélés. Les textes fondateurs et les manifestes, rassemblés en première partie, sont plus que jamais d'actualité. Ils rappellent que la poésie est fondamentalement liée aux sens et à l'émotion et que son éthique exigeante ne peut se résumer à des questions esthétiques.
Sans nul doute, cette anthologie jouera un rôle de référence équivalent à celui en son temps de La nouvelle poésie française de Bernard Delvaille (Seghers, 1974) qui fut une révélation pour ma génération. En outre, Appel aux riverains concerne une période plus étendue mêlant plusieurs générations d'auteurs et fait preuve d'une plus grande diversité. Il s'agit bien d'un ouvrage indispensable à la découverte du mouvement de fond qui traverse la poésie vivante de notre époque."
Marie-Josée Christien (in revue Interventions à Haute Voix n°52, mars 2014).
"Être sans amis, ce n'est pas le cas des 204 poètes regroupés dans Appel aux riverains, l'anthologie 1953-2013 des Hommes sans Epaules, de Christophe Dauphin. La revue Les Hommes sans Epaules a été créée en 1953 par Jean Breton et Hubert Bouziges. En 60 ans d'activité, ça en fait des poètes publiés. Chacun d'eux a droit à une présentation fouillée de Christophe Dauphin (quel boulot ! chapeau !) et à un poème. Les poètes sont rangés par ordre alphabétique, mais si l'on veut on peut lire cette anthologie dans l'ordre chronologique. Une manière de suivre l'évolution esthétique de l'écriture des poèmes ? Les Hommes sans Epaules donnent une nouvelle fois la preuve que la poésie est aussi une oeuvre collective. Que les noms connus (il y en a des dizaines) charrient avec eux les inconnus. Ex: Gaston Couton: "Je te salue avec dédain, autorité, arme de tous les faibles, privilège des misérables... Qui peut te désirer à part le vaniteux... Ta semence n'engendre que semence fétide..." (publié en 1953). L'anthologie est précédée d'une série de textes théoriques. Une somme, mais aussi une malle aux trésors. on se penche dedans, on fouille, on pêche. bravo."
Christian Degoutte (in revue Verso n°156, mars 2014).
"Comment résumer soxiante ans d'une activité intense, d'une recherche sans cesse enrichie par une constellation de poètes qui se sont succédés au sein de cette revue de haut vol qu'est Les Hommes sans Epaules ? L'anthologie Appel aux riverains, sobrement paginée, renferme, pas moins de deux cent quatre poètes. Difficile de restituer une telle richesse et d'en faire l'inventaire. L'histoire commence par l'édition d'une plaquette réunissant deux voix, celles des fondateurs, Jean Breton et Hubert Bouziges, et intitulée: A même la terre. Une aventure commence et ce qui va suivre attestera, au fil des numéros, uen exigence poétique des plus aiguës. Les Hommes sans Epaules naissent donc en 1953 et cette excellente revue donnera lieu à la création d'uen collection de poésie contemporaine, elle-même d'une grande exigence. Cette anthologie Appel aux riverains, s'ouvre sur des textes théoriques (1953-2013) et notamment, par celui remarquable, du poète et essayiste Christophe Dauphin, actuel directeur des HSE, intitulé La Révolte a un langage: La Poésie! Ce texte souligne une insurrection nécessaire à l'instar de Charles Fourier, homme en quête d'harmonie universelle, inventeur de la théorie de "l'attraction passionnée" et dont les réflexions visionnaires du type: A quoi bon l'abondance, si elle n'augmente pas le bonheur de personne ?, sont plus que jamais d'actualité. La deuxième partie s'ouvre et s'achève sur les voix, et pas des moindres, de Jacques Baron, Tristan Cabral, Edouard Glissant, André Breton, José Millas-Martin, Henry Miller, Roberto Juarroz, Alain Jouffroy, Lorand Gaspar, Francis Giauqe, etc.3
Bruno Geneste (in Sémaphore n°2, mai 2014).
*
"A l'occasion des 60 ans de la revue poétique les "Hommes sans épaules", cette anthologie propose une sélection de poèmes accompagnés d'une présentation de chacun des 206 principaux contributeurs : Sarane Alexandrian, Georges Bataille, Jacques Bertin, Michel Butor, Aimé Césaire..."
Electre, Livres Hebdo, 2013.
*
C’est une forêt. Une forêt avec ses allées cavalières, ses clairières, ses taillis, ses mousses et lichens, ses futaies, ses broussailles, sa faune et sa flore. Sous le beau titre d’Appel aux riverains, Christophe Dauphin a rassemblé manifestes et poèmes publiés dans Les Hommes sans épaules. Fondée à Avignon en 1953, cette revue toujours en activité incarne une fidélité à une certaine conception de la poésie proche de Reverdy et des surréalistes.
La première série, de 1953 à 1956, avait été dirigée par Jean Breton. La publication a ensuite été relancée par le fils de Jean Breton, de 1991 à 1994, puis, avec la force et l’énergie de Christophe Dauphin à partir de 1997. L’anthologie propose de « dresser un inventaire de soixante ans de poésie, au scalpel de l’émotion » (p. 7). Christophe Dauphin revendique la filiation et la cohérence de cette aventure éditoriale singulière.
La première partie du livre offre un choix de critiques et de manifestes où l’on trouvera « l’appel aux riverains » lancé en 1953 – appel vibrant à « réveiller le poète derrière sa poésie ». Un texte d’Henry Miller sur Avignon voisine avec une lettre de Maurice Toesca, un texte de Sarane Alexandrian ou les manifestes émotivistes de Christophe Dauphin. On lira aussi avec intérêt « la voix des Arabes libres », texte écrit par Abdellatif Lâabi lors des révolutions arabes de 2008.
La plus grande place reste, naturellement, aux poèmes. L’anthologie rassemble plus de deux cents poètes publiés dans les pages des Hommes sans épaules. Chaque texte choisi est précédé d’une biographie et d’une bibliographie indicative. Si ces notices bien informées sont utiles, elles auraient sans doute gagné à être plus concises. On cherche trop souvent l’information au milieu de commentaires et de jugements qui, dans bien des cas, n’apportent rien d’essentiel ni de nouveau. On le regrette d’autant plus que l’ouvrage a cette grande qualité d’apporter des renseignements bio-bibliographiques sur des poètes méconnus. C’est en effet la richesse de la revue d’avoir ouvert largement ses portes. On trouvera dans ses pages des poètes célèbres comme André Breton, Mahmoud Darwich, Allen Ginsberg, Roberto Juarroz, Jacques Réda ou Pierre Reverdy – d’autres, connus mais un peu oubliés, comme Lise Deharme, Jean-Pierre Duprey, Jean Malrieu, Joyce Mansour – et des voix qui reviennent comme celles de Stanislas Rodanski, Jean Sénac ou Tarjei Vesaas. Dans cet écosystème, passent aussi des poètes contemporains comme Pierrick de Chermont, Henri Droguet ou Vénus Khoury-Gata. Et puis, cette généreuse et égalitaire anthologie donne toute sa place aux poètes du demi-jour, aux irréguliers inconnus comme Albert Fleury, Jules Mougin ou Jean Rousselot. Ce n’est que justice, et l’anthologie remplit bien sa fonction en rappelant le rôle de ces auteurs « mineurs » qui contribuèrent cependant à l’air du temps poétique du second vingtième siècle français.
Outil nécessaire pour se faire une idée de la richesse de la production poétique des soixante dernières années, L’Appel aux riverains est ainsi une belle invitation au voyage et à l’égarement hors des sentiers balisés
François Bordes (in La Revue des revues n°51, 2014).
|
|
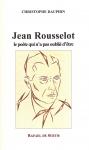
|
|
Critiques
"A l’occasion du centenaire de la naissance de ce grand poète que fut Jean Rousselot (1913-2004), Christophe Dauphin a dressé un portrait riche et touchant de cet homme aux multiples talents dont le parcours complexe est un exemple de foi en l’humanité et d’engagement pour la liberté.
A propos de son enterrement, quelques jours après son décès le 23 mai 2004, Christophe Dauphin confie : « Nous venions d’enterrer soixante-dix ans de poésie française. Jean était la poésie, une poésie sans cesse aux prises avec la vie, le fatum et l’Histoire ; un homme d’action, qui a durablement marqué les personnes qui l’ont approché. ».
Ce fut Louis Parrot, son mentor, qui l’initia à la poésie contemporaine. Ils se rencontrent en 1929. Cette initiation dépasse le cadre de la poésie, il est question aussi de philosophie, de psychologie, de politique et de religion. Il fut, dit Jean Rousselot de Louis Parrot, « mes universités ». C’est à Poitiers, ses nuits, ses cafés, le quartier ouvrier où vit Rousselot, les campagnes environnantes, que le poète se forge, que le génie se fraie un passage dans une forêt hostile faite de préjugés, de combats intérieurs, d’un isolement, peut-être salutaire, mais seulement apparent : « Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais Un. Je me tourmente pour des douleurs qui tiennent éveillée, la nuit entière, la vieille repasseuse qui m’a nourri ; pour la soif qui calcine un soldat au ventre ouvert… La douleur, l’angoisse, l’exil et le danger, voilà mes chemins de communication, voilà mes adhérences au placenta du monde… »
Proche des Jeunesses socialistes, puis en 1934 de la Ligue communiste, anticolonialiste, ses combats politiques sont, à l’époque, proches de ceux des surréalistes. Mais son combat politique reste distinct de sa poésie. En 1932, il participe à l’aventure de la revue bordelaise Jeunesse à la recherche d’un « renouvellement », d’un « rafraîchissement » de la poésie. C’est à partir de la publication en 1936 d’un recueil, intitulé Le Goût du pain, que Jean Rousselot est considéré comme un acteur essentiel de ce renouveau de la poésie.
Quand la guerre arrive, Jean Rousselot se sert de sa fonction de Commissaire de Police pour aider la Résistance et les poètes en danger. Sa poésie devient une poésie de combat, notamment dans cette « école » qui rassembla René Guy Cadou, Jean Bouhier, Michel Manoll, Marcel Béalu et d’autres. Une école, une manifestation de l’amitié.
Poète et homme d’action André Marissel parlera à propos de Jean Rousselot de « surréalisme en action ». Jean Rousselot gardera un grand respect pour le surréalisme qui l’aura éveillé, lui comme ses compagnons, et revendique une continuité entre les surréalistes et lui, tout particulièrement par une collaboration avec l’inconscient.
Après la deuxième guerre mondiale, Jean Rousselot tourne le dos à une vie sociale et poétique facile construite sur la reconnaissance de son action exemplaire pendant le conflit. Il renonce à son métier et veut vivre de sa plume ce qui se révèle évidemment aléatoire. En 1996, tout en affirmant ne pas regretter son choix, il confie à Christophe Dauphin : « Ne lâche jamais ton métier, tu m’entends ! Jamais ! Ne fais pas cette connerie ! Tu pourras ainsi écrire quand tu veux et surtout, ce que tu veux. ».
Jean Rousselot écrira de nombreux articles pour la presse. Le premier est consacré au désastre de Hiroshima qu’il qualifie de génocide, ce qui le brouille avec Aragon. Il va désormais écrire beaucoup, une trentaine de plaquettes et livres jusqu’en 1973, une vingtaine de pièces pour la radio, des romans, mais découvrir aussi et faire découvrir de nombreux poètes talentueux. Tombé amoureux de la Hongrie, il dénoncera le drame de Budapest en 1956, condamnant violemment la contre-révolution russe, et traduira beaucoup de grands poètes hongrois en français comme Attila József, Sándor Petőfi, Endre Ady…
De 1997 à sa disparition, Jean Rousselot continue d’écrire et de publier une « poésie de terrain », au plus proche de la vie, du peuple, des rêves de liberté de tous ceux qui sont contraints. Une écriture de plus en plus dépouillée, directe, grave, sans mensonge, sans artifice, sans effet.
Jean Rousselot, au bout de 137 volumes, continue d’œuvrer. « Les mots de Rousselot restent debout et marchent à nos côtés. Le poète rend la vie possible. C’est pour cela qu’il ne meurt pas tout à fait. » dit avec justesse Christophe Dauphin."
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 19 janvier 2014).
"Jean Rousselot aurait eu 100 ans le 27 octobre 2013. C’est l’occasion choisie par son ami, Christophe Dauphin, pour faire paraître cet essai qui nous dit ce qu’est et ce que doit être un poète : celui qui évoque le quotidien, homme parmi les hommes, travailleur parmi les travailleurs, qui, pour eux, fait le don de soi au sens le plus fraternel du mot.
« Ecolier » de Rochefort, proche de Cadou, Manoll ou Bérimont, admirateur fervent de Roger Toulouse, Jean Rousselot laisse une œuvre ample et diverse : l’œuvre d’un romancier, d’un historien, d’un critique aussi, amoureux de la parole, de l’écriture, et de l’émotion que l’une et l’autre procurent, et qui s’appelle poésie. « Le poème est pour moi l’inouïe prise de conscience des pouvoirs du poète sur le temps, qu’il arrête, sur la mémoire, qu’il ressuscite, sur les sentiments, qu’il élève au Sublime, sur le réel, qu’il perce et transmue pour en retrouver l’essence et a pérennité. »
Abel MOITTIE (in roger-toulouse.com, janvier 2014).
"Les analyses de Dauphin, comme d'habitude chez lui, cernent mieux qu'un portrait le personnage réputé impossible, mais il le transforme délibérément. Par exemple, ce qui n'était pas toujours mentionné dans les biographies, le rôle du poète dans la police et dans la résistance à l'occupant nazi est mis en evidence. Lorsqu'il eut quarante ans, Jean Rousselot parla du surréalisme en souriant de se croire un peu "plus surréaliste que les surréalistes eux-mêmes". Sa décision en 1946 de démissionner de tout et de vivre de sa plume fut capitale. Il devient alors grand voyageur et se produit et publie dans le monde entier. Il n'hésite pas non plus à prendre des positions fermes contre les injustices, comme pour Abdellatif Laâbi en 1972. Pour la forme de ses poèmes, il aura adopté tout. Avec force. Il s'insurge encore contre les inutiles: "Pour beaucoup de mes confrères, l'activité poétique consiste à fabriquer des objets de langage avec un langage sans objet... La poésie jetable gagne du terrain." Que n'aurait-il pas dit aujourd'hui ?"
Paul VAN MELLE (in Inédit Nouveau n°267, La Hulpe, Belgique, mars 2014).
"Jean Rousselot aurait eu cent ans en 2013. Et Christophe Dauphin a eu la bonne idée de faire à la fois sa biographie et un essai sur ce poète hors pair. Il divise son livre par chapitre chronologiques, et avec Jean Rousselot, c'est tout le vingtième siècle qu'on revisite... Christophe Dauphin insiste sur le fait que pour le poète, la poésie est surtout une manière d'être. L'homme est derrière son regard - Comme derrière une vitrine - Lavée à grande eau par le jour. Jean Rousselot prône une poésie de terrain et non de laboratoire ajoute l'auteur de la monographie. Je n'ai fait ici que survoler ce livre bien documenté. Ce qui étonne et retient chez Jean Rousselot, c'est la fidélité à ses idées et la rectitude de ses principes et de son action. Cela a toujours conféré à sa poésie une considérable autorité."
Jacques MORIN (in Décharge n°161, mars 2014).
"Le pari de Dauphin – restituer l’une des figures les plus emblématiques de la poésie francophone des années 30/80, à l’occasion du centenaire de sa naissance – est magnifiquement tenu par un autre passeur de poésie, rompu à l’exercice d’analyse et d’admiration d’un aîné qui a compté, qu’il a connu, avec lequel il a pu s’entretenir, avec lequel il a échangé nombre de correspondances.
Et le réseau se poursuit fidèlement : Jean Rousselot, qui a toujours revendiqué ses dettes envers Reverdy, Max Jacob, qui a toujours fait de l’amitié une vertu humaniste et littéraire, passe ainsi le relais à son cadet de l’Académie Mallarmé pour qu’il chante (le mot n’est pas outré) un parcours poétique, celui d’un homme droit, qui s’est toujours voulu, comme il l’a énoncé dans ce beau poème (repris en fin de volume) homme au sens le plus dense du terme: « Je parle droit, je parle net, je suis un homme. » Il est, certes, difficile de rappeler sans tomber dans les poncifs de la biographie et dans ceux de la vénération poétique. Christophe Dauphin, se basant sur une documentation de premier ordre, des témoignages de première main, des entretiens, de nombreuses lectures, une connaissance intime de la foison d’œuvres nées entre 1935 et 2002, rameute les grandes étapes de la formation d’un esprit, d’une conscience littéraire. L’occasion d’un tournage pour la télévision, sous l’impulsion du poète-maire Roland Nadaus, souda le poète des « Moyens d’existence » et son jeune biographe. Le centenaire fêté à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2013.
"Le 23 mai 2014, il y aura dix ans que l’écrivain Rousselot nous a quittés.
Le petit livre de Dauphin, qu’on lit d’une traite tant il respire le respect et le travail en profondeur pour nous faire mieux sentir une voix vraie, agrémenté de photographies (portraits de Rousselot et des groupes d’amis poètes) et d’une belle huile en 4e de couverture due à l’ami peintre Roger Toulouse, offre, en quatre sections chronologiques, une étude précise de soixante-dix ans dévolus à la poésie. Les origines ouvrières, le sens aigu du social et du juste, la lutte contre la tuberculose, les rencontres fondamentales des poètes Fombeure et Parrot, l’ancrage de Poitiers (la province enfin !) et l’effervescence intellectuelle de cette cité natale, une première revue créée (Le Dernier carré), la reconnaissance dès 1936 (avec « Le goût du pain »), le commissaire Rousselot résistant de la première heure (que de tâches et de faux papiers à prévoir !), l’intense expérience de Rochefort-sur-Loire (dont Rousselot est redevable, mais dont la seule mention finira un jour par l’agacer comme si c’était son seul ancrage), les travaux « alimentaires » dès qu’il cesse ses activités de commissaire pour se consacrer uniquement à la littérature…les matières sont multiples et le travail de Dauphin donne poids, relief, consistance à tous les trajets accomplis par le poète entre sens incisif d’une poésie à hauteur d’homme et conscience aussi précise de son devoir d’homme, de poète, d’écrivain solidaire, syndicaliste et engagé dans les mille et une tâches d’écriture poétique, critique, romanesque et de traduction.
Les solidarités littéraires s’inscrivent en grand dans cette perspective : les aînés salués (Reverdy, Jacob, Jouve en tête), les cadets mis à l’honneur (Cadou), les actions multiples dans les journaux et revues (jusqu’à Oran) pour défendre la poésie. Rousselot (que je comparerais volontiers à l’infatigable Armand Guibert, que Christophe ne cite pas) n’a jamais oublié d’être, en dépit de ses cent quarante volumes, en dépit des reconnaissances ; il méritait cette approche soignée.
Que retenir de plus frappant ? Tant de faits, tant de poèmes, tant de gestes ! Allez, sélectionnons : ses coups de gueule au moment où tout le monde se taisait lors des événements de Budapest (ah ! ses amis hongrois, Joszef, Gara, Illyés…) ; sa défense d’Abdellatif Laâbi des geôles hassaniennes ; sa défense d’une poésie de terrain (non de laboratoire)…. Mais, surtout, l’écriture d’une conscience. Et la fidélité souveraine à ses origines : « Et je suis seul à voir pendre derrière moi, - Comme des reines arrachées, -
Les rues de mon enfance pauvre », (« Pour Flora et Gyula Illyés », Jean Rousselot).
Un très bel essai de Christophe Dauphin !"
Philippe LEUCKX (in recoursaupoeme.fr, 11 juin 2014).
"Un remarquable essai de Christophe Dauphin, qui nous fait découvrir le parcours atypique de ce grand poète que fut Jean Rousselot. Ce grand admirateur de Victor Hugo, dont les premiers poèmes portent l'indéniable empreinte du maître, trace un chemin qui nous mène là où il écrit : Malgré moi j'ai pitié des cours profondes et visqueuses - sans oiseaux, sans feuilles tourbillonnantes - Et du pétrin invisible qui geint en bas - Jour et nuit comme un forçat enterré. Ce livre retrace l'itinéraire fondateur d'un poète portant la marque de l'inconscient et l'esprit libertaire, qui ne triche pas avec lui-même, et sur lequel bien d'entre nous feraient bien de méditer: descends vers les gouffres, dit-il, perds ta couleur, tes yeux et le dernier écho, là-haut, de ta présence..."
Bruno GENESTE (in revue Spered Gouez n°20, octobre 2014).
|
|

|
|
Lectures
« Chez Christophe Dauphin, il y a une flamme inhabituelle de nos jours, qui contient une passion, dans son poème « Les oracles de l'ouzo », pour la Grèce, que l’on appelle : expression spontanée des sentiments. Nous n'avons rien entendu de pareil depuis Apollinaire et Jarry.
Christophe Dauphin est un poète qui glorifie la « bouteille » comme la met en valeur Rabelais à la fin de son Cinquième livre :« La dive bouteille vous y envoye, soyez vous memes interpretes de votre entreprinse. »
Sur un ton exalté se présente une nouvelle perspective pour la Grèce déchirée par les coups féroces des élites économiques européennes. Christophe Dauphin nous tend la main comme le firent Victor Hugo, Eugène Delacroix et bien d'autres philhellènes français, vers la Grèce révolté.
Ce poème, « Les oracles de l'ouzo », est dédié à la Grèce de nouveau assujettie aux liens inextricables du cynisme économique. »
Nanos VALAORITIS (in revue Eneken, Thessalonique, Grèce, août 2017).
*
" Ce « fanal », ensemble de poèmes très écrits, est bien l’éloge de ce que le vin, son entourage peuvent donner de plus beau. Le livre offre au lecteur, bien vivant, de très longs poèmes, chaque fois ancrés humainement et géographiquement. Ainsi, les nombreux dédicataires des textes ont un lien privilégié avec le poète voyageur, amateur de crus, qui, avec lyrisme et ferveur, à l’aide de métaphores parfois solennelles à l’adresse des lieux et des gens, au fil des rencontres dont il tire parti, sème de belles descriptions à l’usage des amateurs des régions de France et d’ailleurs, de leurs vins, et ce, par une traversée des vignobles, des divers cépages (« Cahors/ des tanins longs et concentrés ») et de l’histoire. Un peu comme l’eussent fait autrefois Cendrars et Thiry ou Goffin, pour insérer le banal, l’anecdote, le moderne, l’usage nouveau dans le poème. Ici, « la poésie roule plein gaz sur l’autoroute ».
Oui, il faut vivre et se donner le goût d’apprécier « la langue » qui « se nourrit de ce qu’elle absorbe », de moderne, passé, anecdotique etc.
L’exotisme, ainsi, n’est pas absent : « Le téquila se boit dans une ville-monde / au manteau de bidonvilles/ dont les trottoirs se recouvrent de paupières »
Rien de paradoxal pourtant à voir, dans cette célébration de la vie et de la vigne, quelques « tombeaux » à l’adresse des poètes, d’anonymes.
Célébration mais avant tout du vin, que Dauphin décline selon des variations en « cette Côte-Rôtie de belle terre et de pluie » ou en « c’est le pays de Saint-Chinian/ des fruits noirs et des parfums de garrigue/ qui fusent sur les réglisses comme tram sur la mer ».
Mais avant tout, dire, la mer, le soleil sur Londres, l’amitié des gens, des lieux, de tous les proches (A. Breton).
« Un fanal », c’est de la poésie qui a de la chair, de l’étoffe, de la matière. Quelque chose de grenu : on sent le poète plus versé pour décrire le monde qu’à densifier ses élans. Ses poèmes, donc, prennent le temps, s’arrogent la féconde langue des métaphores et la pâte heureuse des beaux termes poétiques.
Le lecteur sans cesse est sollicité : les invites, les apostrophes, les conseils sont nombreux (« Buvons ce vin aux tanins frais/ pas de trêve pour la soif »).
Comme dans plusieurs recueils antérieurs, Dauphin use des mots-métaphores avec trait d’union, tels que « épée-rasoir »…
Nourri de culture, de références littéraires et autres (terroir, tradition), le livre sait aller du côté du « pays de Joë Bousquet », l’ermite contraint de Carcassonne, dont le « vin » cathare « a la robe intense.
Tout le livre propose de belles trouvailles de rythme (ce que facilitent les anaphores et la longueur de nombre de poèmes) et des blasons :
Dans « Vau de vire des falaises », par exemple :
« Paupières d’ardoise et d’écume
Dieppe fait rouler ses falaises
Dans le fond de tes poches trouées »
Un très long texte, trois pages, au titre « Poète assis au bord du Danube », déroule thèmes de soi et hommage aux autres poètes, tel cet Attila Josef, dont la « nuque » fut traversée de balles.
Aussi, le livre est-il fécond pour faire sentir la fraternité et le vin s’offrir en partage.
« Ce vin dont le ciel est l’enclume » m’a fait tout de suite penser (effet intertextuel ou de connivence) à Bousquet et son « le fruit dont l’ombre est la saveur ».
Les bonheurs d’écrire abondent : « Lausanne s’enivre de chasselas/ et de solitude ».
Je suis sûr que Pirotte eût aimé ce catalogue de vers(verres) / à boire.
Bon vin, Dauphin, dirai-je tout simplement. "
Philippe LEUCKX (cf. "Critiques" in www.recoursaupoeme.fr, décembre 2016).
*
« Un fanal pour le vivant, poèmes décantés de Christophe Dauphin, Editions Les Hommes sans Epaules. Christophe Dauphin est une personnalité majeure du monde de la poésie. Essayiste, critique, éditeur, directeur de revue, il est avant tout un véritable poète c’est-à-dire un homme total. Le poète est celui qui porte sur le monde ce regard intransigeant qui fouille les entrailles de l’émotion comme du songe.
La poésie décantée de Christophe Dauphin est engagée. Elle s’engage et engage le lecteur très profondément dans les replis sombres ou lumineux de la psyché. C’est une poésie de la révolte. Le passant ordinaire devient corsaire de la liberté pour voguer sur une intimité ensanglantée. C’est le vent des mots qui sauve du vulgaire. Beaucoup de ces poèmes sont des cris.
Voici une poésie éveillante faite d’abordages et d’attaques intempestives. Des vivres pour ravitailler les habitants de l’Île des poètes, l’une des Îles des immortels bannis.
Christophe Dauphin, d’un continent à l’autre, voyageur des corps et des âmes déchirés, explore le continuum de la douleur. Il refuse de dormir. Il refuse de supporter l’insupportable. Vivant, il s’adresse aux vivants même quand il est trop tard.
Il ne s’agit pas de s’en laver les mains. Je dis et je retourne au banal. Non, l’amitié se construit, combattante ou distante du monde, elle est faite d’ivresse et de poésie. Face à l’impossibilité de ce monde-là, face à l’imposture permanente, il y a la posture rabelaisienne, le savoir et la joie. Le rire à en mourir. A plus haut sens. »
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 4 mars 2015).
*
"Un fanal pour le vivant est le nouveau recueil de l'étonnant secrétaire général de l'Académie Mallarmé, et directeur de la revue désormais mythique, Les Hommes sans Epaules: Christophe Dauphin. J'oserais presque parler de poésie-essai, car j'y trouve des rappels de nouveaux classiques comme Ilarie Voronca, Marc Patin, Sarane Alexandrian ou André Breton, sinon d'autres que le poète analyse sans concessions mais avec la pure passion qui ne l'abandonne jamais, de quoi qu'il écrive ou parle. Un fanal pour le vivant, décanté comme le vin du Vau de Vire ou le Cognac de Camus, est plus qu'un recueil, presque un manifeste de toutes les tentatives de ce poète hors-norme et prêt à toutes les aventures des mots les plus signés, dans une oeuvre foisonnante et surtout vivante, jamais endormie, émotiviste selon lui."
Paul VAN MELLE (in Inédit Nouveau n°274, Belgique, mai/juin 2015).
*
"Un fanal pour le vivant, c'est du Christophe Dauphin tout craché. Il faut lire "la ballade du salé", poème poignant et affectueux consacré à Alain Simon. Un livre où l'alcool roule grand train."
Jean-Pierre LESIEUR (in Comme en poésie n°62, juin 2015).
*
"Je n’imaginais pas écrire une lettre ouverte aujourd’hui. Mais Jean-Pierre Thuillat me rappelle amicalement que je n’en ai pas écrit depuis longtemps pour la revue. Et comme je viens de consacrer une émission radio sur RCF (« Dieu écoute les poètes ») à Christophe Dauphin, j’ai pensé que je pourrais la prolonger ici, dans ce numéro 118 de "Friches".
Justement, commençons : Christophe Dauphin s’auto-proclames athée, parfois à grand renfort d’imageries surréaliste : il a écrit, par exemple, une charge violente contre et pour (« Thérèse, Cantate de l’Ange vagin », éditions Rafael de Surtis, 2006) celle que j’appelle « ma copine » : Thérèse Martin, plus connue sous le nom de sainte Thérèse de Lisieux et à laquelle j’ai, alors maire de Guyancourt, consacré une voie publique… parce qu’elle était aussi poète… Il est vrai que cette grande petite sainte est, comme Dauphin, Normande et que ce dernier porte en lui profondément ce que Léopold Sédar Senghor, dont il fut l’ami et par certains côtés le disciple, appela sa « normandité ». L’œuvre poétique de Christophe Dauphin y fait très souvent référence avec bonheur et il a même consacré une belle anthologie aux poètes en Normandie du XIe siècle à nos jours : « Riverains des falaises » (éditions clarisse, 2012).
A propos de l’anthologie, Dauphin, qui est un boulimique de la lecture et de l’écriture, a également publié « Les riverains du feu » (Le Nouvel Athanor, 2009), un ouvrage anthologique dédié aux poètes qu’il rassemble sous le vocable émotivisme ». Ce concept, qu’il développe et qu’il illustre de cinq cents pages et qui reprend des extraits de recueils de plus de deux cents poètes (!), est au cœur de sa pensée et son écriture.
Car si Christophe Dauphin s’insère dans une filiation surréaliste, ce n’est pas pour singer un mouvement disparu, mais au contraire pour en poursuivre l’esprit – dont il juge qu’il est toujours extrêmement vivant. Et il est vrai que ses poèmes brillent souvent d’un éclat surprenant grâce aux images dont il a le secret et qui laissent le lecteur pantois et admiratif devant leur inventivité et leur puissance. Dans son recueil, « Le gant perdu de l’imaginaire » (Le Nouvel Athanor, 2006), qui est un choix de poèmes écrits entre 1985 et 2006, on en trouve à toutes les pages, ainsi à la première :
« La lune a mis ses bretelles sur l’idée de beauté
Un train déraille dans la bouteille de la nuit
Il est temps de décapiter la pluie
D’égorger l’orage… »
Mais si j’ouvre ce beau recueil à n’importe quelle autre page, je reconnais le poète prince de l’image, roi de la métaphore :
« Le sourire d’une femme est la lame de fond du regard
Debout entre trois océans »
Il faudrait aussi parler de son livre « Totems aux yeux de rasoirs » (éditions Librairie-Galerie Racine, 2010), préfacé par son ami Sarane Alexandrian, qui fut le très proche collaborateur d’André Breton et le directeur de la revue « Supérieur Inconnu », à laquelle dauphin collabora. Ou bien encore parler de ce gros ouvrage recueillant des poèmes, des notes, des aphorismes : « L’ombre que les loups emportent (Les Hommes sans Epaules éditions, 2012). Henri Rode surnomme Christophe Dauphin « l’ultime enfant du siècle et la fête promise ». C’est que, très tôt, dauphin a senti bouillonné en lui la poésie, indissociable de la révolte et de l’amour.
L’amour n’est d’ailleurs pour Dauphin pas loin de l’amitié à laquelle il sacrifie fidèlement notamment à travers la revue qu’il dirige : « Les Hommes sans Epaules », qui a d’ailleurs consacré une anthologie à ses collaborateurs de 1953 à 2013 sous le titre « Appel aux riverains » (Les Hommes sans Epaules éditions, 2013). A ce propos, il faudrait aussi évoquer son œuvre considérable de critique littéraire et de critique d’art. Dauphin a décidément une capacité de travail et de création qui, au sens propre, m’époustouflent !
Et comme il est encore jeune, bien que dans l’âge mûr, je lui souhaite de continuer ainsi avec la même vigueur et la même ferveur. Maintenant qu’il est devenu secrétaire général de l’Académie Mallarmé, il n’en aura que plus de force pour défendre et illustrer la poésie contemporaine, et pour soutenir ses créateurs.
Fraternellement en notre diversité."
Roland NADAUS (cf. « Lettre ouverte à Christophe Dauphin », in revue Friches n°118, mai 2015).
*
"Christophe Dauphin se sert du prétexte de diverses boissons alcoolisées et de différents vins pour faire appel à quelques poètes et autres célébrités (comme Joséphine Baker ou Léo Ferré) pour mieux se révolter contre l’ordre établi et ses injustices. Il renoue ainsi avec une tradition qui traverse la littérature française depuis Olivier Basselin et François Rabelais dont le « le vau de vire » du premier et l’ivresse chez le second ont été élevés au rang de métaphysique et de moyens de connaissance du réel. Et après ce parcours tant poétique qu’éthylique, Christophe Dauphin termine par ce mot qui sonne comme un coup de tocsin « Enivrez-vous ! ». Et par ce constat que la poésie n’est que la métaphore du vin (ou vice versa). Ses poèmes ont donc valeur de manifeste(s).
Ce n’est pas un hasard si le recueil s’ouvre sur une ode à l’ouzo qui se transforme rapidement en réquisitoire contre la politique européenne à l’égard de la Grèce : les technocrates unis contre la volonté d’un peuple. Technocrates et politiciens réunis par leurs trahisons ; l’exemple de la Grèce permet de dire ce qui se passe ailleurs (à propos de la crise) : « tu es belle comme les hauts-fourneaux de Florange / mastiquant de la gum Goodyear ». L’actualité du moment où j’écris ces lignes se retrouve dans ce vers « sur les chenilles des panzers de Madame Merckel ». Et ce n’est pas un hasard non plus si « Les oracles de l’ouzo » se termine par ce cri d’espoir « Rêve général ! » qui n’est pas sans rappeler ce beau titre de Pablo Neruda, « Le Chant général »…
Via le rhum, le whisky, le tequila, la bière ou, plus particuliers, le vin des côtes de Toul, le côteaux-du-layon, le chablis, le malbec, le montlouis, le champagne ou le saint-chinian (parmi d’autres) sont convoqués le surréalisme, l’anarchie, les poètes hongrois, Marc Patin, Jean Rousselot et bien d’autres. Et c’est à chaque fois l’occasion d’évocations d’événements historiques, du racisme, de la xénophobie, de la mort de l’amère Thatcher (qui nous vaut ces vers imprécatoires : « Dame de Fer, baronne de l’Enfer ! Rouille / rouille saloperie ! Que l’ordure aille aux ordures ! »), de l’assassinat du Che… Voilà qui explique l’engagement de Dauphin et qui donne sens à ces trois vers qui terminent « Poème ardéchois » (traversé par le souvenir de Jean Ferrat) : « Le jour est vide comme un verre / et le temps brûle comme une barricade / avec sa révolution licenciée par ses révolutionnaires. »
Mais Christophe Dauphin a aussi le culte de l’amitié et cultive le souvenir de ceux avec qui il a trinqué (du moins on se plaît à l’imaginer) : Guy Chambelland, Yves Martin, Jean et Alain Breton, Thérèse Plantier ou Jacques Simonomis qui sont, d’une certaine manière, à l’origine de ces vers émouvants : « Un Gewurz, un Riesling et un Singulier Grand ordinaire / c’était avant Jacques bien avant / que la tumeur ne ronge ton cri jusqu’à l’os » ou « Je suis seul et triste comme un con / avec Gabrieli et Meursault et toi… ». C’est peut-être là qu’il est le meilleur, peut-être... Le reste ne va pas sans quelques illusions : le Mexique est devenu l’arrière-cour des Yankees, la Hongrie s’est débarrassée de ses révolutionnaires d’opérette pour se donner au fascisme, les USA sont le pays de Guentanamo et toujours du racisme et du mépris pour les autres peuples… Christophe Dauphin, s’il rend hommage à des poètes comme Henri Rode, Alain Breton ou Paul Farellier, prêche pour sa paroisse (ce qui est normal) : « C’est un Lirac qui nous régalait là-bas / là où le Rhône émonde nos chants émotivistes / […] / ainsi sont les Hommes sans Épaules ainsi sont les Wah / buveurs de Lirac… » ; mais la poésie est diverse…
Que dire encore ? Qu’en cette époque où il ne faudrait boire que de l’eau, Christophe Dauphin est politiquement incorrect (ce qui est réjouissant), tant par ses préférences politiques, que par son éloge des boissons alcoolisées. Que le mot amitié revient souvent car ce recueil est celui de l’amitié qui n’est pas toujours nommée (mais alors on la devine), cette dernière coulant autour d’une table où les verres se remplissent… Que le temps est à relations intéressées… Que l’on ne prend jamais Christophe Dauphin en défaut sur la description des vins, que certains de ses poèmes comportent même des recettes (comme dans le poème intitulé « Asti »), que la fantaisie éclate dans la troisième strophe du « Vau de Vire du pauvre Lélian » : « Est-elle brune blonde ou rousse ? Je l’ignore / mais la Belgique nous en offre plus de sept cents / […] / des îles de houblon glissent sous le vent trappiste »… Mais, il faut être sérieux avec l’objet de ses rêves, sachant que cet avertissement vaut autant pour le poète de « Un fanal pour le vivant » que pour le signataire de ces lignes…"
Lucien WASSELIN ("Chemins de lecture 2015" in revue-texture.fr, août 2015).
*
"Ça bouge, ça danse, ça remue à profusion ! Il y a tant de matière à danser dans ce livre, il y a tant d’embryons, d’explosions, de longues et belles vies en chorégraphie que les lignes semblent la figure intrépide, les battements géants, les membres, la psyché multiprises d’un seul corps !
Lève-toi et danse ! Dévêts-toi de tes vêtements, de tes douleurs et désillusions, de ta mort, exalte la vie, le corps en transe, la primauté et l’infinitude du mouvement, comme David vêtu d’un simple pagne dansant devant l’arche d’alliance ! On dirait donc l’agencement, le rassemblement d’un seul être, transcendant, tumultueux, communautaire, où chaque poème, à tour de rôle, se lève, s’individualise, dit son histoire, son rêve, son essence, son origine, puis retrouve sa place au sein du corps dont il est solidaire. Et un autre à son tour se dresse, et un autre, et chaque effet individuel accroît l’effet général de rythme, de cadence, d’enivrement, d’allégresse qui doit autant à la réalité qu’à la prodigalité de l’auteur qui la met en texte. Je ne suis pas sûre (il s’en faut de beaucoup) de connaître le nom de tous ces vins, mais je suis sûre que Christophe Dauphin est un irremplaçable poète et que son ivresse de vivre nous promet encore de prodigieux lendemains.
Odile COHEN-ABBAS (in revue Les Hommes sans Epaules n°40, octobre 2015).
*
"Voilà bien longtemps que la poésie avait oublié les voies des chansons à boire. Non que les poèmes de Christophe Dauphin soient réellement à chanter, mais ils sont une véritable invite à boire. Il n'oublie certes pas toute la poésie à redécouvrir, les parfums et les couleurs avec le vocabulaire ad hoc qui déjà fait chanter les âmes. Et en bon poète qu'il est, il n'a de cese de se référer aux autres poètes, de Villon à Baudelaire, et de chanter autre chose que le vin, le whisky ou le calvados. Il remet ainsi au goût du jour les "vaux-de-vire" ou "vaudevires", célèbres au XVIe siècle.
Le vin sait couler ma naissance mon nom mon ombre - et mes angoisses - qui me suivent à la trace loup aux crocs de vigne.
En n'oubliant pas que le vin peut crier contre les misères sociales partout dans le monde et particulièrement dans nos territoires d'outre-mer: contre la vie chère kont pwofitasyon."
Bernard FOURNIER (in revue Poésie/première n°62, octobre 2015).
*
Son recueil, Un fanal pour le vivant, aurait pu s’appeler Alcools. Las, Apollinaire avait pris ce titre. Car Christophe Dauphin, né en 1968 en Normandie, écrit avec toutes sortes de breuvages, cidre, whisky, bière, Gigondas… Sa poésie est forte en goût, tonitrue, éclabousse, ou s’engourdit dans quelque rêverie… « Paupières d’ardoises et cils d’écume/Dieppe fait rouler ses falaises/dans le fond de tes poches trouées/d’où s’envolent des avions en bois. » Et ce constat qui ravira tous les dignes amateurs : « Nous sommes deux pour inventer le temps/dans un verre de mercurey. » À lire sans modération. L’avantage de la poésie est que son verre ne se vide jamais.
Philippe SIMON (in Ouest France, 15/16 octobre 2016).
*
"Il incombe à Adrian Miatlev d’ouvrir la marche d’Un fanal pour le vivant, le dernier livre de poèmes de Christophe Dauphin, dont le titre est tiré d’un texte du grand poète lyonnais Roger Kowalski : Un vin rigoureux dissipe la pénombre, une lueur de cuivre sur la table, un fanal pour le vivant. Sous l’aile de ces deux aînés, Christophe Dauphin donne libre cours à ses envies, à ses passions, à ses excès de toutes sortes, qu’il gère par le biais de la poésie ; une poésie qui rappelle celle du cher vieux Cendrars. On est dans le ton. On vit les choses avant de les écrire. Tiens ! En parlant de « vit », il en est fortement question dans ce livre. Allez-y voir ! Ici, on boit du vin, du bon, du meilleur : un Pomerol, par exemple ! À la santé de Luis Buñuel, de son Los Olvidados et de bien d’autres.
Mais il n’y a pas que le vin dans la vie, ni de films en version originale. Christophe Dauphin est sensible à bien d’autres choses. D’aventures syntaxiques, de paris, de jeux frivoles et/ou graves ; il amasse, il emplit ses coffres de poèmes et d’objets hétéroclites, qui s’avèrent être sous sa plume des objets poétiques, des mots qui dérangent, qui interpellent.
Dans cet ouvrage, comme dans la plupart de ceux de Dauphin, le quotidien est sublimé. Le poète veut tout. Maintenant. Tout vivre et tout voir. Tout entendre, tout respirer. On est riche d’expériences, de gestes, d’émois. Christophe est le dauphin de l’Empire du surréel. Son esprit fourmille. La poésie : il aime ; la sienne et celle des autres.
Chez lui, chaque battement de cil est un poème.
Il faut goûter les textes d’Un fanal pour le vivant, pour apprécier les saveurs de la poésie qui se crée aujourd’hui. Ajoutons, qu’Un fanal pour le vivant s’est vu décerner le premier Prix Roger-Kowalski des Lycéens en 2015."
Jean CHATARD (in Les Hommes sans Epaules n°43, 2017).
*
"Il était possible de s’en tenir à l’esprit, à la lettre féconde de ce grand livre sur l’éloge de la Vigne de Christophe Dauphin « Un fanal pour le vivant », de suivre le parcours, les trajectoires innombrables de ce vin identitaire au travers des mœurs, des régions du cœur, des pays. Et notre joie, notre surprise auraient été combles. Mais ce qui m’a encore voluptueusement, béatement, captivée dans cette épopée énergique, magistralement composite de l’ivresse, c’est celle qui l’exprime, et la façon insolite, toute nouvelle dont elle l’exprime : la bouche. La bouche éminente du poète.
Ici la bouche qui dit et la bouche qui boit est érotisée à l’extrême, la bouche duelle du verbe et de l’ingestion, s’étire, se meut, se transcende sans retour, se compose en un mode majeur et, dans une tension de suprême dilatement, s’unifie, jusqu’à faire du poème un concept organique quand le lieu du vin et le lieu du texte convergent. « La poésie crée la soif du poème et du corps -que mord le mot soleil -une femme se cambre comme un pont sur l’été - et la bouteille libère son fleuve »
La bouche maîtresse du poème de Christophe Dauphin est une bouche qui nous donne à baiser ses lettres mêlées au goût des vins et de leurs origines, mais aussi, écartelée de tous les appels du réel, une bouche qui s’ouvre toute, qui a sa demeure dans l’engagement, le serment et l’honneur, fondant sa mystique de dons concrets et d’échanges substantiels. Car cette bouche, ces lèvres dilatées ont ceci de particulier qu’elles sont à la fois forme et action. Beauté formelle qui se réalise dans l’espace, y trouve son règne plastique, et percées dans les mouvements du temps, les circonstances, les traumatismes historiques. « Tyrannie dans la maison que tu habites - et dans la clé qui la ferme - dans le sommeil et les saisons au visage inutile - dans l’enfant qui boit un fil de lait - dans la femme et le travail que tu as perdus - dans le flocon qui fait fondre les oiseaux - dans le poème que tu écris ou n’écris pas - dans le soleil qui donne froid dans le dos - dans la couleur de tes yeux et celle de ta peau - il y a tyrannie »
Cette bouche généreuse, qui semble sans fin s’ouvrir primitivement sur l’univers, comme rejouant son surgissement d’un moment fatidique, originel, prend tout, combine tout, transmute tout, incorpore les substances scripturaires à la flaveur des vins et de la salive : l’être, l’écrit, le dire, le cep, la vigne, les hommes, les poètes, les bourreaux, les victimes, soi-même, la mort, le désir. Portée dans son discours vivant aussi, témérairement, la mort insupportable de l’ami ! Je me suis demandé s’il y avait concoction, préméditation ? alchimiques à cette allégeance totale aux forces efficientes du langage, ce fracas d’armes verbales d’une efficace et d’un sensualisme envoûtants.
Mais non, chez Christophe Dauphin, tout vient d’un coup, à chaque instant. C’est son panache, sa joute ascendante ! Le meilleur ni le pire n’épuiseront jamais les atouts de sa langue. Sa bouche, ses fonctions linguale et linguistique sont des liqueurs laudatives. « La joie est dans toute chose, mais toute chose a besoin d’une autre chose, pour faire jaillir sa joie. La joie c’est ce visage, cette vigne et ces mains énormes de soleil, ces yeux où les regards tournent comme des insectes dans les trous d’un arbre, ces tempes, ces joues creusées par l’orage, ce corps de femme qui attend l’amour et dont le fleuve est un bras jeté en travers d’un pont, alors que l’autre tient haut dans l’air le bouquet des comètes, qui voyagent comme les tannins traversent l’aurore boréale, pour atteindre Braila, que le fleuve rejette comme un vieux marin triste contre l’épaule des Carpates ; »
Et le vin, mémoire intime, mémoire commune, mémoire historique (toutes consanguines), prendra toujours le pas sur l’ensevelissement, la finitude de l’autre mémoire, triomphe et grâces indemnes du souvenir ! Cependant, la lecture de « Un fanal pour le vivant », n’est pas une lecture paisible. De part en part de la texture poétique, l’extraordinaire émerge et déchire la trame, offrandes de mots, d’images, d’associations violentes et rares qui ont coupé leurs nœuds et leurs liens avec le terrestre, le sensé, le raisonnable. La bouche fait des voltes, entre dans les voies sarmenteuses du secret, du jamais énoncé, connait l’union sensuelle avec d’autres langages de sang, de vin, de pierre, d’eau et de feu. « Le Tequila se boit la tête dans un mur - qui déchire les veines coupe les voix - arrache les tripes des mots et divise - jusqu’à la mer éventrée qui rouille dans ses vagues - à Tijuana les projecteurs sont braqués sur la mort - par le yankee qui sonne la charge de 7e de cavalerie »
Ce qui me transforme au fur et à mesure de ma lecture, c’est le polymorphisme d’un authentique courage (et pas seulement un courage poétique), une puissance, une jouissance insurgées de vivre qui affrontent les phases les plus sordides et les plus sublimes de la réalité. Voici sa révolte, l’enrôlement du cœur qui exulte : « Margaret n’a plus une seule arête - et le genre humain se donne la main - pour sabrer cette cuvée Amour blanc de blanc - pour savourer son trépas - des notes florales de tilleul et de chèvrefeuille - qui crachent sur sa mémoire et son sang pourri - Battler Britton et Lord Byron crient : champagne ! » Et parce que l’ouvrage ne saurait, par essence, en rester sur une fin, ceci encore, volubilement amoureux, qui me fait tant sourire : « Qu’est-ce qu’on boit maintenant Alain Thibault - un Gasnier ou un Angeliaume ? -Une Vieille vigne 100% Cabernet Franc - une Vielle vigne de Cravant-les-Coteaux - pardi ! »
Odile COHEN-ABBAS (in revue Les Hommes sans Epaules n°45, 2018).
*
"Ces poèmes parcourent l'Europe pour célébrer le vin et la vigne, la richesse des terroirs et l'ivresse qui exalte les passions. "
Electre, Livres Hebdo, 2015.
*
« Ce Vésuve qui marche en moi la nuit »
Christophe Dauphin
On n'en finit/finirait pas de relever les bonheurs d'expression, les trouvailles, l'oeil surréaliste et inventif de l'auteur, à la lecture de ce Fanal pour le vivant, dont le sous-titre Poèmes décantés diffuse déjà un peu des effluves, des arômes corsés qui attendent le lecteur dès les premiers poèmes. La densité du livre ne se volatilise pas dans l'écoulement des pages. Il faut, consciemment, ou pas, se préparer à tendre souvent son verre. La soif du poète est communicative. Qui s'en plaindrait ?
Livre ouvert, c'est souvent gargantuesque, ça porte une adresse verlainiene pour le pauvre Lélian, ça flatte ailleurs la chanterelle ou le bandonéon, ça trinque avec Jehan Rictus, ça enchante le gosier, tombe la veste/le cuir. Et souvent ça fait un bras d'honneur à la mort. Comme les toasts au champagne à la nouvelle du décès de Margareth Thatcher[1], dont la politique et le soutien affiché à un certain général chilien ont laissé leur traces dans les mémoires. La sentence pour celle qui n'aura su que se révéler indifférente, méprisante à ceux d'en bas, se mue, à juste titre, en hymne à la joie... et au champagne !
Difficile de résister à l'élan de vie du bon buveur qu'est Christophe Dauphin, à l'enthousiasme de cet échanson, qui tient du maître de chais et qui le prouve à l'envie.
Mes dithyrambes de l'alambic/mes poèmes décantés des iles tanniques» C'est lui qui parle....Et qui ajoute La poésie crée la soif du poème et du corps/que mord le mot soleil/une femme se cambre comme un pont sur l'été/et la bouteille libère son fleuve. Ailleurs ce titre Il faut être ivre pour être vivant. Rappelons en passant que le personnage est un gilet jaune affirmé et qu'on a pu le voir, en bonne logique et bonne compagnie, sur les rond-points !
Impossible non plus de ne pas lui tenir compagnie quand s'allonge l'insoutenable liste des amis passagers des voyages sans retour, avec lesquels les liens ne pouvaient être que fraternels et/ou teintés de respect. Parmi leurs noms qui s'allument dans le texte, figurent Albert Ayguesparse, Guy Chambelland, Jean Breton, Jean Rousselot, Illyes et Gara, Sarane Alexandrian, Jacques et Yvette Simonomis, (Jacques auquel le recours à l'argot fait penser) Marc Patin, Yves Martin, Alain Thibaut, Ilarie Voronca, Jean Sénac, Mouloud Feraoun, Jacques Taurand, etc, etc … Les poèmes alors sont chargés d'une tendresse réelle. Dauphin est un authentique adepte de la fraternité humaine, dont le pendant peut se révéler être une férocité justifiée, défensive. [2]
Le personnage n'est pas épargné non plus par les plongées en abîme Ce vin c'est une cure de sommeil sur la rampe du coma/c'est le cru de l'oubli/ de l'homme qui boit/de l'homme que personne ne voit/qui apaise sa douleur dans la soif. Ou ailleurs Une corde est accrochée à une poutre//Les wagons s'enfoncent dans la nuit-Krisztina/et dans chaque compartiment/on dort dans le verrou de la mort.
Sans oublier Ici rien ne chante/que les fonderies dans l'oracle du fer/et des oiseaux en fusion s'envolent/comme des cloches qui sonnent le glas.
Christophe Dauphin, il tient la barre en bon Viking est un voyageur qui n'aura pas seulement voyagé autour de sa chambre, un voyageur qui salue, ce n'est pas contradictoire, Joë Bousquet, grand paralysé de guerre. Il a écrit (et bu, comment non ?) en Amérique Latine, (Chili, Mexique notamment) Lèche ta peau entre le pouce et l'index/le mot et la vie et bois le Tequila/qui nage dans l'agave et brille d'azur dans nos gouffres/au bord de l'aile et de l'abîme...Il a séjourné aux Etats-Unis C'est un whisky [3]que le blues distille/dans la nuit du lézard qui déboutonne le désert/sous les paupières ensevelies du sommeil. Son poème garde vivant le sang de son passage dans plusieurs pays d'Europe (et pas seulement le sang de la vigne). Et il ne maque pas d'appétit pour les dépaysements, les changements d'horizons qui fertilisent l'écriture, tordent le cou aux habitudes.
Ce fanal pour le vivant illumine les ivresses, adoucit les angoisses. Comment ne pas être tenté de remettre une tournée porteuse d'autant d'arômes ?
Gérard Cléry (in revue Concerto pour marées et silence n°16, 2023).
[1] Requiem pour une dame de fer, page 60
[2] Soleil d'Agave, page 20
[3] Le blues de la nuit californienne, page 34
Gérard CLERY (in revue Concerto pour marées est silence, 2023).
|
|

|
|
Lectures critiques :
Enveloppe ouverte, on croit un moment halluciner ! Une nouvelle livraison de la revue Le Cri d’os, pourtant disparue en 2003 ! La couverture est un peu plus étroite et le papier différent, avec ici photo couleur et pelliculage… En fait, elle ressuscite pour un n° spécial consacré entièrement à feu son animateur, le poète Jacques Simonomis, grâce à Christophe Dauphin et aux Hommes sans Épaules éditions.
On est donc aux confins du numéro de revue et de la monographie. La revue a existé dix ans entre 2003 et 2013, s’est arrêtée au n° 40 (moitié trimestrielle, moitié semestrielle). Et Jacques Simonomis s’est éteint, il y a dix ans tout juste.
Cette présentation en trompe l’œil et pour rire ferait presque oublier que Simonomis fut surtout un poète avant d’être, une décennie durant, un revuiste incontournable. L’hommage qui lui est rendu remet les choses en perspective. Christophe Dauphin, dans une première partie fournie, s’attarde chronologiquement sur la vie et l’œuvre du poète, en s’intéressant à chacun de ses recueils. Ainsi qu’à son engagement libertaire et humaniste, qui lui fera consacrer des études à Tristan Corbière et Gaston Couté... Pacifiste aussi puisqu’il connut la guerre d’Algérie pendant vingt-huit mois, comme toute cette génération de poètes qui en fut profondément marquée. Simonomis reste original, puisque sa poésie, et au-delà son écriture, sont difficilement classables. Gravité et légèreté se croisent, réalisme et imagination voisinent, fantastique, fantaisie et humour cohabitent, le tout dans une langue où le lexique n’a pas de limite. Simonomis qui a fait de son nom un palindrome, a trouvé un style, une plume et un ton pour le moins singuliers.
Nous qui ne sommes pas « nés » / gens sans terre sans fortune / petit peuple qu’on range / d’un coup de trompe ou de langue / avec la meute... Il a su faire de son socle prolétarien un tremplin pour un imaginaire débridé, insolite et fantaisiste. On a / volé le tapis volant / reflétri le roseau pensant / coupé la bosse au dromadaire / fait la guerre au propriétaire. Avec grand appétit de vie et conquête du temps : je ne crois plus à mon déclin j’appartiens à la route / j’ai faim. Son sens du merveilleux se marie parfaitement à l’érotisme dont le poète est friand : De mes poings sortent des oiseaux. Autour de tes seins, je tatoue des poèmes que tu ne peux pas lire.
Jacques Simonomis est à lire, ou découvrir. « J’écris pour ne pas me rendre », écrit-il. Poète plus complexe qu’il ne paraît, il a su couler sa poésie si personnelle dans l’éventail des formes, de l’aphorisme à l’histoire courte pour chaque fois faire mouche :
Perfectionniste, il raturait ses ratures.
LE CLANDESTIN
Le train s’arrêta. Je sautai sur le ballast et longeai les wagons plombés à la recherche d’un signe. Un ver luisant me prit la main. Nous évitions les aiguillages où le destin bascule car nous voulions toucher le bout des nuits, là où la solitude, la liberté et la mort étendent sur le champ le drap du jour nouveau.
Jacques MORIN ("La revue du mois" in dechargelarevue.com, mai 2015).
*
"Dans le travail d’information que mène Ent’revues, repérer les revues naissantes est la moindre des choses. Aviser de la fin d’une revue est moins évident : la revue s’arrête-t-elle, est elle arrêtée, empêchée, agonisante ? Et puis un dernier numéro peut apparaître, épuisant les inédits, fonds de tiroirs, de rédaction. Il ne s’agit pas de cela ici. Le Cri d’os, achevé d’imprimer cet avril 2015, est le « no 41/42 et ultime dernier ». Cette revue fut créée en 1993 et publiée jusqu’en 2003 sous la direction de Jacques Simonomis. Sous ce palindrome spéculaire se cache – à peine – un autodidacte atypique, poète truculent et combatif, « [de] la lignée d’un Corbière, d’un Alfred Jarry ou d’un Paul Vincensini ». D’ailleurs, il écrit :
« JE SUIS SIMONOMIS ho hisse
mon nom claque sur mes cuisses
avec mes mains
rieuses paysannes. »
Il est mort il y a dix ans : Les Hommes sans Épaules éditions lui rendent hommage en publiant cette livraison singulière. Il s’agit de la réédition d’un essai de Christophe Dauphin paru en 2001, revu et augmenté, et complété d’un important choix de textes et poèmes reflétant l’œuvre multiple, foisonnante.
Laissons la parole à celui qui fut aussi un animateur de Soleil des loups (1985-1992) :
« Je ne veux pas mourir dans la peau d’un revuiste, mais dans celle d’un poète indépendant. J’aurais acquis, dans cette aventure, un immense respect pour les responsables de revues, même celles que je n’aime pas ou qui m’ont été hostiles. J’ai fait ce que j’ai pu, comme j’ai pu, avec ce que j’avais. En définitive, Le Cri d’os m’aura apporté plus d’emmerdements que de joie. Mais il est trop tôt pour dresser un bilan. »
À noter, Les Hommes sans Épaules seront présents au 25e Salon de la revue, et présenteront sur leur stand la revue Le Cri d’os."
ENT’REVUES, le journal des revues culturelles (in entrevues.org, mai 2015).
*
" Un remarquable et inattendu hommage au maître d’œuvre de la revue Le Cri d’os qui parut de 1993 à 2003, soit la même époque que Gros Textes. Ce numéro met également l’accent sur le poète Simonomis. L’ensemble est une passionnante page d’histoire littéraire de la marge et nous donne à lire quelques échantillons de la langue riche d’un qui apprit le métier chez Corbière, Couté ou Richepin. "
Yves ARTUFEL (in grostextes.over-blog.com, 11 mai 2015).
*
« Jacques Simonomis nous a quittés en 2005, deux ans après avoir publié le dernier numéro de la revue Le Cri d’os, fondée en 1993. Nous devons à Christophe Dauphin ce numéro exceptionnel et inattendu d’une revue emblématique en hommage à son fondateur. Le Cri d’os, annonce-t-il, ce sont « neuf cents notes de lecture, trois cents auteurs différents, quatre-vingts illustrateurs » plus « de nombreux numéros spéciaux consacrés à Max Jacob, L’école la poésie, François Jacqmin, L’Homme et l’œuvre, Jean Cassou, Le surréalisme américain, Norbert Lelubre, Théodore Koenig, Luc Decaunes, L’Erotisme…) ». Une œuvre énorme, tranchante et puissante comme seuls les poètes savent le faire.
Cet ultime numéro est composé de deux parties, un long portrait, presque une biographie avisée, dressé par Christophe Dauphin, compagnon de route de Jacques Simonomis, et un ensemble de textes et poèmes choisis de Jacques Simonomis. Et d’abord ces mots de Christophe Dauphin qui donne un sens aigu au nom de la revue, Le Cri d’os : « Simonomis dévorait la vie avec excès, comme pour conjurer les blessures et les frustrations d’une jeunesse bafouée et mal vécue. Simonomis, c’était le fils du peuple et de la mère-caresse, de la mère-douleur et du père volage qui dépensait sans compter l’argent du ménage. Une enfance mutilée jusque dans les rides de la mère. Simonomis, c’était le jeune homme au regard d’abîme, au dossard illisible, qui dut gagner son pain d’adolescent. C’était l’autodidacte total, parfait et rageur, l’homme de la culture intégrale, y compris et surtout populaire, les plaies du réel, la marche sur le fil du rasoir. Simonomis – il me l’a dit à plusieurs reprises –, n’avait pas peur de la mort. (…) Simonomis invente son monde et son univers, qui débouchent sur une mythologie personnelle. En cela, dans un monde aussi étriqué que le nôtre, l’aventure du Cri d’os créa-t-elle un espace de liberté et d’ouverture en libérant un précieux oxygène. Derrière la bonhommie de l’ours, comme derrière son rire énorme, il y avait tant de fêlures. Tout était à vif. Simonomis était parfois entêté, emporté et maladroit, susceptible, mais toujours fraternel et entier. »
Et de citer Jean Despert : « il faut l’avoir vu se hérisser lorsqu’on tente de se mettre en travers de sa liberté d’homme et de poète. Car, il y a le poète, le narrateur, le critique, le polémiste, l’homme aux quelque trente ouvrages drus comme lui, chargés d’humour et de dynamite de tendresse pour les uns, d’acide décapant pour les autres, avec cette sensibilité à vif de peau et de cœur qui vous entre dans la poitrine et le cerveau pour y creuser un chemin qui vous mènera parfois plus loin qu’il ne le souhaitait… »
L’homme, talentueux, est attachant et ne laisse pas indifférent, il secoue, il réveille. Les témoignages recueillis pour ce numéro ultime concordent sur un point essentiel, ceux qui le côtoient se sentent davantage vivants.
Jacques Simonomis a commencé à écrire tôt pour n’être publié qu’à trente-cinq ans. Bien sûr, il se heurta à l’indifférence et à la bêtise du milieu littéraire dans lequel il ne connaissait personne. Son premier recueil, Les Sirènes avec nous, paraîtra en 1975, une poésie troubadouresque qui précèdera une trilogie de jeunesse au caractère très vital. Il commence à fréquenter les poètes mais à part Jean Cassou, ces rencontres ne seront pas décisives et se révèleront plutôt décevantes. Avant de fonder Le Cri d’os, il collaborera à de nombreuses revues et en animera certaines comme Soleil des loups de 1985 à 1991.
Son œuvre est marquée par la gravité, notamment quand il traite de la guerre : il a vécu la guerre d’Algérie. Jacques Simonomis ne laisse passer aucune des turpitudes humaines même s’il sait aussi faire preuve de légèreté, s’exerçant à la caricature ou au burlesque. L’œuvre est sombre. Mais plane toujours dans ses poèmes la lumière, même pâle, qu’apportent la révolte et l’inconditionnalité. Et l’amour, toujours présent à travers sa compagne et muse, Yvette Demay.
Le flibustier laisse son œuvre comme un hymne à la liberté. Il appelle au combat permanent. Il a cherché des mots pour se battre, il les a trouvés, il nous les a laissés pour que nous poursuivions le combat."
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 7 juin 2015).
*
« Après nous, un dossier encore pour Simonomis. Avant tout le dernier numéro 41/42, posthume hélas, du « Cri d’os », hommage imposant et essentiel de Christophe dauphin au grand Jacques, plus que complet, grâce aux documents prêtés par sa chère Yvette et les souvenirs encore si vivants de l’impossible et si humain et authentique anar. »
Paul VAN MELLE (in Inédit Nouveau n°275, juillet 2015, La Hulpe, Belgique).
*
"Ce fort volume de 240 pages, donné comme l’ultime dernier de la revue Le Cri d’os [1993-2003], cependant édité par Les Hommes sans Épaules, s’avère un régal. La première moitié du volume est consacrée à une présentation du poète Simonomis, 37 ouvrages parus, un prix obtenu en 1993 auprès de la SGDL, un poète peu connu donc, présentation signée Christophe Dauphin. Et la seconde moitié fournit un copieux choix de poèmes qui retient plus que l’attention.
La présentation, riche d’informations sur la vie poétique des cinquante dernières années, est conduite avec adresse, lucidité, et une confraternité du meilleur aloi. C’est une analyse de l’œuvre et un témoignage à la fois dont les cinq parties se lisent d’une traite. Cela commence par le vif portrait d’un « jeune homme au regard d’abîme, au dossard illisible, qui dut gagner son pain adolescent ». Au travail, en effet, dès l’âge de 17 ans, le poète a acquis sa culture en autodidacte. Il pourra écrire, ne publiant son premier volume qu’à 35 ans, « ma poésie ne sort pas des livres ». Péguy, rapporte Gérard Cléry dans sa préface à ce livre, notait qu’un « mot n’est pas le même selon un écrivain ou un autre : l’un se l’arrache du ventre, l’autre le tire de son pardessus ». Simonomis écrivait à peau nue. C’est sans doute en partie pourquoi « le milieu le reçut à bras fermés » et pourquoi cet ouvrage est si émouvant.
Christophe Dauphin, qui a de même présenté Jean Breton ou la poésie pour vivre en 2003, rappelle sans ambiguïté : « La poésie fait-elle autre chose que fouiller cette plaie qu’est l’homme ? » Le critique a des trouvailles, c’est-à-dire un style : « les images glapissent […] le poète se bonifie livre après livre […] il a l’humour d’attaque ». Il a su prendre le pouls de l’œuvre de Simonomis consignant cette grave facétie : « La vie n’est pas sérieuse, la preuve c’est qu’on en meurt. »
Le critique distingue trois plaques tectoniques dans cette œuvre. La première, dans le temps, s’apparente à la poésie des sans-grade, d’un pessimisme actif. Lui succède une poésie picrocholine que Dauphin préfère d’ailleurs rattacher à la nature des contes. Enfin il y a toute une part proche de Vincensini, si naturelle qu’elle parle aux enfants, et qui, dans de courts poèmes en prose, rejoint parfois Godeau. Ces trois axes s’interpénètrent. Ce sont en fait les frontières qui varient.
Le choix de poèmes, nourri, procurant une belle anthologie sur 120 pages, illustre bien ce que le critique a su lire et donner l’envie de lire. Un des premiers poèmes publiés, "Le Puits", en 1976 fait qu’on ne peut mieux dire : « Mi-larmes, mi-colère / mécontent de ce bas bonheur / je descendais dans le cafard / nu, sans poignard, cigale à folie noire […] Je ne crois plus à mon déclin, j’appartiens à la route / j’ai faim. » À ce cycle faut-il rattacher les poèmes sur la guerre d’Algérie, dans un choix établi par Jean Breton et publié en 1999 sous le titre La Villa des roses ? Le très beau poème qui donne son titre à ce volume devrait en tout cas être étudié au collège. Donner à partager la nature même de l’injustice, la plaie de l’homme, quoi de plus nécessaire ? Simonomis ne conciliait-il pas ce qu’attend la jeunesse : « Donnez-moi les mots pour me battre » en même temps que « la tactique de mon cœur / était de vous aimer ». On lit encore ce cri d’os, comme il disait : « j’ai voulu vivre sans mentir » et, les illusions consumées, « les yeux ne sont pas faits pour se regarder écrire ».
Un fort beau volume, donc, qui confère à ses auteurs, l’un vif et la mémoire de l’autre lui devant de le rester, une pleine et entière reconnaissance. Puissiez-vous, qui passez, la partager à votre tour !"
Pierre PERRIN (in recoursaupoeme.fr, août 2015).
*
"Le Cri d'os a cessé de paraître en mai 2003 avec son n° 39/40… Et voici que Christophe Dauphin publie un hommage à Simononomis, l'animateur de cette revue, décédé en février 2005; un n° 41/42 et ultime dernier qui se présente comme les précédents à peu de choses près, les amateurs reconnaîtront. Cet hommage regroupe une préface de Gérard Cléry, un essai de Christophe Dauphin (intitulé Comme un cri d'os, Jacques Simonomis, paru en 2001 sous un autre titre et ici revu et complété), un choix de textes et de poèmes de Simonomis et une bibliographie de ce dernier. Le livre est complété par de nombreuses illustrations et une liste des poètes et des illustrateurs publiés dans Le Cri d'os de mai 1993 à mai 2003.
J'ai toujours dans ma bibliothèque les livres de Jacques Simonomis, ceux que j'ai achetés comme ceux que j'ai reçus en service de presse de sa part ou de celle de son épouse Yvette après sa disparition… L'un d'entre eux me fit une telle impression, La Villa des roses (publié en 1999 par la Librairie-Galerie Racine) que je le place aux côtés de La Question d'Henri Alleg (ouvrage que celui-ci complétera en 2001 par un entretien co-édité par Le Temps des cerises et Aden)… J'avoue que j'ai ouvert à nouveau La Villa des roses : l'impression est toujours la même…
L'essai est une bonne introduction à l'œuvre de Simonomis qui pourrait apparaître hétérogène à ses nouveaux lecteurs : de l'humour au conte en passant par la dénonciation et l'indignation ! C'est que, comme le souligne Christophe Dauphin il n'y a chez lui "aucune trace du politiquement correct". On peut lire aussi dans cet essai un intéressant développement sur le poème en prose et une comparaison avec l'utilisation de la prose par Benjamin Péret qui vise à mettre en évidence l'originalité de Jacques Simonomis : "… les petites histoires de Simonomis ne relèvent pas, même si certaines s'en approchent fortement, du poème en prose" et "Le conte de Péret relève de l'écriture automatique, du surréel. Le conte de Simonomis, d'une réalité qui dérape, pour gagner les terres de l'imaginaire, du burlesque et de l'humour". Le plus beau et le plus intéressant chapitre de cet essai est sans doute celui consacré à la guerre d'Algérie et à la publication de La Villa des roses. C'est le constat implacable de la démarche d'un appelé du contingent, non politisé et qui n'est pas encore poète : comment Simonomis réagit à ce qu'il voit et à ce qu'il subit. La Villa des roses est un très beau livre, un livre utile comme disait Paul Éluard… Un livre toujours d'actualité : on peut relever dans ce qu'écrit Christophe Dauphin ces mots : "On le sait, nombreux sont ceux qui n'accepteront pas et n'acceptent toujours pas d'avoir dû lâcher leurs privilèges", mots qui renvoient à l'article paru sur le site internet La Faute à Diderot qui rappelle que la nostalgérie (1) est toujours de mise… Façon de dire ici que La Villa des roses est toujours à lire ou à relire.
Christophe Dauphin illustre son essai par un choix de poèmes qui permet de se faire une idée précise du talent de Simonomis : presque tous les recueils sont représentés. Cette anthologie est une épreuve de rattrapage pour tous ceux qui n'auraient pas encore lu le poète… Certes, le "politiquement correct" est absent de cette poésie. Mais ce sont les poèmes de l'époque 1954-1962, écrits pendant la guerre d'Algérie, qui ont ma préférence : peut-être est-ce dû aux bruits de bottes, aux explosions, aux miaulements des shrapnels et autres fantaisies guerrières qui dominent actuellement le monde… Pour ne pas désespérer des hommes."
Lucien WASSELIN (in recoursaupoeme.fr, août 2015).
Note 1: Nostalgérie. L'interminable histoire de l'OAS. Christian Langeois a lu le dernier livre d'Alain Ruscio.
*
" Une belle photographie de couverture offre au lecteur la bienvenue chez Jacques Simonomis, qui ouvre une porte en guise d’accueil poétique. Une façon aimable de convier à la lecture de ce brillant essai signé Christophe Dauphin ; essai de 150 pages suivi d’une sélection des principaux ouvrages de Simonomis. Tous les textes majeurs sont bien entendu au rendez-vous et l’on peut lire et relire les extraits les plus représentatifs de ce poète utilement secondé par une épouse admirable (le fameux « colibri ») qui fit beaucoup pour sa notoriété et qui poursuit encore aujourd’hui les retombées d’une oeuvre trop tôt interrom-pue. Tout, chez Jacques Simonomis, était prétexte à poème ; tout tournait autour de la poésie, en tout premier lieu la revue Le Cri d’os, qu’il fonda après avoir fait ses « humanités » dans d’autres publications poétiques. Ce coup d’essai fut un coup de maître (40 numéros parus) et sa grande facilité d’élocution fit beaucoup pour la revue, mais également pour l’oeuvre personnelle du poète. Il savait « payer de sa personne » et n’hésitait pas à prendre la parole en public, à faire une conférence ; ce qui lui procurait une certaine audience, qui se répercutait sur le nombre croissant de ses lecteurs. Christophe Dauphin a su, en cet essai, privilégier le côté « grand public » de Simonomis, son désir d’être le plus près possible des gens. Le présent volume (Le Cri d’os n°41/42) consacre plus de 100 pages à une sélection très « pointue » des oeuvres du poète. Les photographies y abondent, en compagnie de différentes personnalités du monde poétique. Détail émouvant : la tombe de Jacques Simonomis au cimetière du Père-Lachaise, à Paris :
AMIS
Amis
aidez-moi de vos voix lointaines
quand mon corps hésite
Caressez-moi de mots que nous aimons ensemble
tous unis
contre la varlope
de la mort qui chante
Le bruit insidieux
de son atelier
ne faiblit jamais
la cheminée
crache des visages
Le mot de vie
c’est un prénom de femme
Mon amour
embrassons-nous toujours
sur la route froide
L’invincible silence
a piégé la nuit
Jean CHATARD (in revue Les Hommes sans Epaules n°40, octobre 2015).
*
" Venu d'outre-tombe la revue Le Cri d'os n°41/42 ressuscitée pour un seul numéro par Christophe Dauphin. Ayant bien connu et apprécié Simonomis, je me réjouis de ce retour temporaire et vous invite vivement à aller vous requinquer à la lecture de ce numéro gargantuesque."
Jean-Pierre LESIEUR (in Comme en poésie n°63, septembre 2015).
*
"Christophe Dauphin est le maître d'oeuvre de cet ultime numéro de la revue Le Cri d'os, créée et animée de 1993 à 2003 par Jacques Simonomis. L'ouvrage, illustré de nombreuses photos, se compose d'une présentation de l'homme (décédé en 2005) et du poète à l'oeuvre protéiforme par Gérard Cléry; d'un essai bien documenté de Christophe Dauphin qui fait découvrir le critique et le revuiste sans concession, l'aventure de la revue et un ensemble de poèmes choisis, sous le titre : La poésie n'a pas de barreaux."
Marie-Josée CHRISTIEN (in Spered Gouez n°21, ocotobre 2015).
*
"Dans la lignée d’un Tristan Corbière, d’un Alfred Jarry ou d’un Paul Vincensini, la poésie de Jacques Simonomis est teintée de l’humour d’attaque, de la dérision. Elle est taillée d’un seul tenant dans les méandres mystérieux de la vie, avec son ton, son style, ses différents registres."
Electre, Livres Hebdo, 2015.
|
|

|
|
Critiques
"Si les articles sur Lucie Delarue-Mardrus commencent à se multiplier et permettent de redécouvrir son œuvre, les biographies concernant ce personnage littéraire sont suffisamment rares pour que l'on salue la parution de cet essai de Christophe Dauphin. Ce critique et essayiste s'est appliqué à retracer l'existence de cette femme de lettres en choisissant de l'aborder sous l'angle de la féminité. Les thèmes abordés dans son œuvre sont replacés dans le contexte esthétique de l'époque et mis en relations avec les écrits de ses contemporaines, révélant ainsi que l'esprit novateur qui anime ses premiers écrits.
Un des intérêts majeurs de cette biographie est le portrait assez étoffé que Christophe Dauphin brosse du Dr J.-C. Mardrus qui, jusque-là, n'était qu'à peine esquissé. On comprend mieux dés lors avec quel homme charismatique Lucie Delarue-Mardrus vécut jusqu'à la veille de la Première guerre Mondiale. On y trouvera également une réflexion sur sa démarche spirituelle et sur son homosexualité.
Nous saluons donc ici une belle tentative de concilier les différentes facettes de cette personnalité dont tous les critiques saluèrent l'énergie, la créativité."
Nelly Sanchez (in Cahiers Lucie Delarue-Mardrus, septembre 2015).
*
"Qui est Lucie Delarue-Mardrus ? Le mérite de Christophe Dauphin, outre répondre à cette question, est de nous rendre cette femme d’exception familière et attachante. Ce livre succède au récit de souvenirs de Myriam Harry paru en 1946, et à celui d’Hélène Prat paru chez Grasset en 1994. Il n’est pas possible de résumer cette biographie tant la vie de Lucie fut mouvementée, intense et littérairement extraordinaire. Elle a écrit plus de quatre-vingt romans (de 1901 à 1946), treize recueils de poésie, des pièces de théâtre, elle fut traductrice, critique littéraire et musicale ; conférencière, peintre, auteur de contes, de récits de voyages et de chansons. Colette dira d’elle : elle avait le bonheur d’aller à tous les travaux avec une fougue conquérante. C’est cette même fougue qui anime l’écriture de Dauphin et propulse le lecteur dans les méandres les plus subtiles de la force vitale et créatrice de cette femme hors du commun. L’accent est mis sur sa qualité de poète c’est assurément par le biais de la poésie que l’auteur des Sept douleurs d’Octobre, appréhende le monde avec le plus de force écrit Dauphin. Elle-même affirme : Je l’ai déjà dit, le vers fait partie de ma respiration// Je ne suis et ne fus qu’un poète. Née en Normandie, et ayant habité de nombreuses années à Honfleur dans Le Pavillon de la Reine, ce vers peut emblématiser le fait qu’elle ait été souvent considérée comme une auteure régionaliste : L’odeur de mon pays était dans une pomme. Or sa poésie ne saurait être réduite. Lucie Delarue-Mardrus, dans la lignée d’Anna de Noailles, Renée Vivien, Marie de Hérédia, est une femme de Lettres. De même que sa poésie illustre sa maîtrise de toutes les formes, du rondeau à l’élégie, Lucie multiplie les expériences tant amoureuses que créatrices (sans oublier ses crises mystiques) dans le Paris-Lesbos de la Belle Epoque : Tes yeux ne brûlent plus mon âme de garçon// et mes yeux noirs qui ont des regards de garçon//. Elle fut même comparée à Katherine Mansfield : comme Lucie, Katherine Mansfield a connu cette glorieuse chance d’avoir à dire avant de savoir dire.
La composition du livre de Dauphin : une riche et longue présentation de Lucie Delarue-Mardrus, une biographie passionnante et de larges extraits de son œuvre poétique, fait de la princesse amande une figure proche et émouvante. Son mariage avec Joseph Charles Mardrus son Homme de Feu orientaliste et traducteur des Mille et une nuits (liaison qui durera jusqu’en 1913) l’entraînera pendant plus de deux ans sur un sable d’ailleurs où ses découvertes renforceront sa soif d’engagement et son indépendance, comme l’illustre son rejet farouche de toute maternité : dans mes flancs malgré moi, l’horreur d’une âme humaine. Lucide à la fin de sa vie quant à sa solitude et à sa pauvreté : la triste fée aux doigts perclus/ Que je deviens dans ma ruine// Quoi ! Cette fente dérisoire/ Entre ces deux maisons/ Serait-ce la fin d’une histoire/ Riche de tous les horizons ?//, cela ne l’empêchait cependant pas d’accomplir de façon pérenne ce rêve si justement révélé par Dauphin tout le long de ce livre : Elle rapportera sur ses frêles épaules/ Le monde et tous les ciels aux pointes des ses mâts. Oui, elle a voulu le destin des figures de proue. Sa vie et sa poésie incarnent ce vœu."
Marie-Christine Masset (in revue Phoenix, 2015).
|
|
|