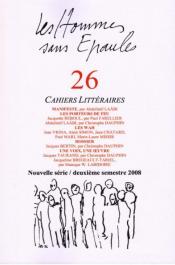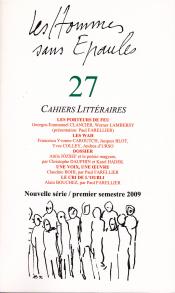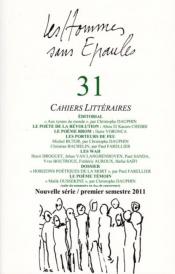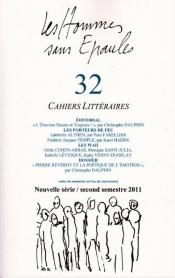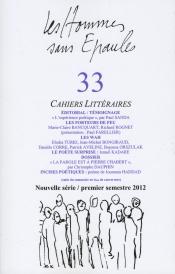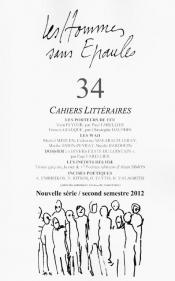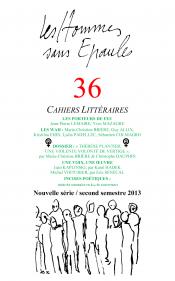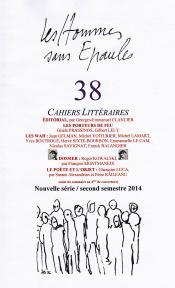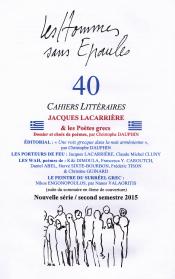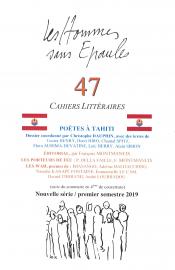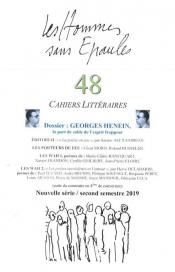Elodia TURKI

Elodia Zaragoza Jover est née à la fin de la guerre civile espagnole, en 1939, à Valence. Elle est la fille d’Antonio Zaragoza, Capitaine de Corvette de la Marine républicaine, à bord du seul sous-marin de la flotte et de la Chiqueta, Amelia Jover Velasco (Cullera, Valencia 1910-París 1997), une femme exceptionnelle dans l’amour comme dans le combat pour la liberté. « Ta mère a failli être fusillée quatorze fois. Pas une, quatorze ! Elle avait beaucoup de courage. Elle a sauvé plusieurs vies. Elle était l’idole de Cullera », lui dira-t-on lors de son premier voyage en Espagne, bien plus tard. Elodia ressemble comme deux gouttes d’eau, physiquement, à sa mère. Cela en est non pas troublant, mais bouleversant.
Amelia est une grande figure de l’anarcho-syndicalisme espagnol et de la légendaire Confederación Nacional del Trabajo (Confédération nationale du travail, CNT) qui, pendant la période républicaine (1931-1936) et la guerre civile (1936-1939), joue un rôle tout à fait central en Espagne. La CNT, qui dispose d’une structure fédérale (syndicat, comité régional et national) compte alors cinq cent trente-cinq mille adhérents en juin 1931 et deux millions pendant la guerre. Une situation qui contraste singulièrement avec celle que l’on observe aujourd’hui, puisque le mouvement anarcho-syndicaliste a pratiquement disparu de la société espagnole. En cause, la répression franquiste, les affrontements internes, l’absence d’une relève générationnelle et la faiblesse de l’aide internationale. Amelia Jover est naturiste, responsable des Juventudes Libertarias, de la Fédération anarchiste ibérique, membre de la CNT, au sein de laquelle elle contribue à créer la section féminine du syndicat, secrétaire général de la Fédération régionale de la jeunesse libertaire. Conférencière et publiciste, elle écrit pour la presse confédérale.
La chute de Barcelone (26 janvier 1939), l’internement de l’armée républicaine en France (5 février) et le blocage de la flotte à Bizerte (27 février) marquent la fin des opérations militaires et de la guerre civile, déclenchée par le soulèvement nationaliste des 17 et 18 juillet 1936. Les nationalistes occupent toute l’Espagne, et leur cinquième colonne leur livre Madrid (28 mars). L’Angleterre et la France reconnaissent le gouvernement de Franco. Amelia est capturée en 1939 dans le port d’Alicante par les troupes de Franco qui l’emprisonnent au Cine Ideal (centre de détention pour femmes), puis, au domaine d’Albatera et, après une tentative d’évasion avortée, dans la prison du Convento de Santa Clara de València, où elle est torturée, alors qu’elle se trouve dans un état avancé de grossesse.
Amelia est détenue à l’hôpital provincial de Valence, qui dépend de la prison, sous une haute surveillance (deux policiers montent la garde jour et nuit devant la porte de la chambre), car elle a été condamnée à mort. Elodia y naît en novembre 1939. « Ta mère, témoigne Manolo, le beau-frère de la Chiqueta, est restée « au secret » jusqu’à ta naissance. Plus de cinq mois dans un cachot, dans une cave, sans la ration de lait à laquelle elle avait droit puisqu’elle te portait. Les autres prisonnières qui étaient enceintes lui cédaient, avec la complicité d’un gardien, leur ration de lait à tour de rôle, une fois par semaine, jusqu’au jour de l’accouchement. » Amelia ajoute : « Tu étais un grand bébé. Tu étais à moitié bleue à cause des coups de pieds que j’avais reçus dans mon ventre. On voulait que je parle. Que je dénonce mes camarades. Je ne l’ai jamais fait ! » Avec l’aide de la famille et de la CNT, Amelia parvient à s’enfuir, sa fille dans les bras, déguisée en infirmière.
Amélia Jover est sans nouvelle de son mari, qui combat, comme elle, les Franquistes depuis trois ans. Mère et fille traversent les Pyrénées et arrivent en janvier 1940 sur la plage d’Argelès-sur-Mer, dans le sud de la France, où Amelia apprend que son mari n’est pas mort au combat, mais qu’il est vivant et a réussi à échapper à la répression franquiste pour gagner la Tunisie avec la flotte républicaine en partant de Carthagène le 6 mars 1939. L’amiral Bonita chef de la marine républicaine en rade dans le port de Carthagène a pris la décision de quitter la ville avec la flotte républicaine (composée de 4.200 hommes, de douze navires et d’un sous-marin) pour la sauver des griffes de Franco en rejoignant la Tunisie et Bizerte où se trouve le seul port en Afrique du Nord qui a les possibilités techniques d’accueil.
Avant de pouvoir rejoindre Antonio en Tunisie, Amelia et sa fille connaissent en 1939/40, en France, les camps de concentration d’Argelès et de Bram. L’émigration vers la France connaît un mouvement d’accélération important au cours de la bataille de l’Èbre[1] et dans les mois suivants, dans un mouvement appelé la Retirada (retraite). L’exode des populations en provenance de Catalogne devient massif après la chute de Barcelone le 26 janvier 1939. Le gouvernement Daladier doit ouvrir la frontière le 27 janvier, et les réfugiés affluent à travers les Pyrénées par Le Perthus, Cerbère et Bourg-Madame. En mars 1939, le nombre de réfugiés espagnols en France est estimé à 440.000 personnes dans un rapport officiel. Les historiens ont estimé à 465.000 exilés dont 170.000 civils le nombre de réfugiés après la chute de la Catalogne. En France même, ce sont les départements du Sud-Ouest, à proximité de l’Espagne, qui ont accueilli le plus de réfugiés.
De nombreux journaux français (L’Humanité, Ce soir, Le Populaire, Regards, Le Libertaire, La Flèche de Paris…) multiplient les reportages dans les camps afin d’alerter sur les conditions de vie des réfugiés. Ces derniers sont exposés à la faim et au froid, provoquant chaque nuit des morts, aux maladies mais aussi à la violence de certains gardiens des camps (gardes mobiles et troupes coloniales). La presse conservatrice manifeste une franche hostilité. Pour Le Petit journal, la « débâcle des marxistes espagnols oblige à protéger le territoire. » L’hebdomadaire Gringoire titre : « L’armée du crime est en France, qu’allez-vous en faire ? » Devant la Retirada, les autorités françaises, débordées regroupent les réfugiés dans des camps de concentration ou d’internement situés dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, Le Barcarès, en bordure de mer. Des camps d’internement qui regroupent notamment des Basques et des anciens des Brigades internationales (Gurs), des Catalans (Agde, Rivesaltes), des personnes âgées (Bram), et la division Durruti (Le Vernet), à l’intérieur des terres en février 1939.
Elodia et sa mère, sont internés dans le camp d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), qui a été construit à la hâte à partir de février 1939 sur les plages de la commune pour faire face à l’afflux sans précèdent de réfugiés. D’abord érigé pour accueillir des républicains espagnols, il sert ensuite de camp de concentration pour les Tsiganes, les Juifs, ainsi que pour de nombreux étrangers lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en France. Avec plus de 250.000 internés transitant par le camp de 1939 à 1941, dont plus de 110.000 uniquement dans la période de février à juin 1939, il s’agît de l’un des premiers et un des plus importants camps de concentration français perçu comme l’un des symboles de la Retirada. Le camp ferme en 1941 pour devenir un Chantier de la jeunesse française sous le régime de Vichy.
Amelia et Elodia restent trois mois dans le camp d’Argelès, avant d’être transférées au camp de Bram, dans l’Aude, proche de Carcassonne. Amelia témoigne à sa fille : « C’était terrible. Il y avait une épidémie de fièvre typhoïde. Les enfants mouraient tous les jours. J’avais un vaccin qu’un ami détenu avait pu m’obtenir. Le médecin du camp refusa de l’utiliser pour toi. Il le prit et me dit que la priorité allait aux enfants français… Nous dormions sur la paille, sans éclairage la nuit à cause des bombardements… Il y avait des rats partout. Des gros rats. Je te mettais dans une grande chemise que j’attachais autour de mon cou et sous tes pieds, comme un sac, à cause des rats, et je te couchais sur mon ventre… toute la nuit. » Puis, Amelia et Elodia parviennent à rejoindre Antonio en Tunisie. Elodia évoque le déracinement ressenti par sa famille : « Quand nous sommes arrivés en Tunisie, ils nous ont appelés Espagnols... Après vingt-trois ans en Tunisie, ils nous ont envoyés en France, et là-bas, ils nous ont appelés Tunisiens. Nous venons en Espagne, ils nous appellent Français ! Je me demande ce que nous sommes. » Elodia grandit en Tunisie. Sur la vie de ses parents dans ces premières années, elle rapporte : « Ils étaient comme ces tubercules aux racines aériennes qui, contre toute logique, ne se nourrissent que d’air et d’eau... leur patrie permanente… Ils se sont habitués, sans jamais s’habituer, à la douleur intolérable d’être amputés d’eux-mêmes… Ils allaient vieillir lentement, comme une vieille jeunesse vaincue aux yeux brillants d’adolescents blessés et à la nostalgie intacte. Elodia qui a les nationalités française, tunisienne et espagnole (à partir de 1976), se sent de « partout » et de « nulle part », à la fois. Elle parle parfaitement le français, l’arabe et l’espagnol.
Mais l’accueil en Tunisie n’est pas celui espéré par les républicains espagnols. Ces « communistes, ces militaires de gauche, ces syndicalistes, ces anarchistes », font peur aux autorités françaises comme à la forte communauté italienne : l’Italie de Mussolini a très activement participé à la guerre civile aux côtés des franquistes. Les Français décident d’éloigner et d’isoler les Espagnols, qui sont désarmés et acheminés dans des trains, réservés pour le transport des chevaux, dans des conditions atroces, pour être internés dans des camps (notamment Meknassi et Gabès). De son côté, Franco entend bien récupérer la flotte espagnole et envoie un émissaire en Tunisie : l’amiral Salvatore Moreno. Deux mille marins espagnols (à qui l’on a promis en vain qu’ils peuvent rentrer sans craindre ni représailles, ni emprisonnement) repartent en Espagne avec l’amiral Moreno et les navires de la flotte. Certains seront arrêtés et fusillés dès leur arrivée. D’autres, emprisonnés. L’autre moitié des réfugiés espagnols entend rester en Tunisie pour tenter d’y vivre en s’impliquant dans la vie quotidienne. Ce choix est celui d’Antonio Zaragoza qui accueille sa femme Amelia et sa fille Elodia.
La Deuxième Guerre mondiale provoque en Tunisie un manque de main d’œuvre en Tunisie. Les Français comprennent le parti qu’ils peuvent tirer en exploitant à bon compte cette main d’œuvre espagnole, qui comprend des militaires, des médecins, des jardiniers, des maraîchers, des agriculteurs…. Ils feront tout et seront corvéables à merci. Les plus récalcitrants sont déportés dans le camp disciplinaire de Gabès, que l’on appelle l’enfer. Les conditions de vie et de travail sont très dures. Le résident général Eric Labonne a l’idée de valoriser la région de Kasserine en utilisant la main d’œuvre locale tunisienne, italienne, française et espagnole. Les Espagnols sont acheminés vers Kasserine dans des conditions déplorables. Ils sont logés dans des grottes et dorment sur la paille. Tout est à faire à Kasserine et les Espagnols feront tout, y compris le fait de « dompter » le cours d’eau qui menace la ville. L’État colonial français met à leur disposition 100 hectares du domaine de l’État, pour donner naissance à la ferme de Chambi, une ferme pilote qui donnera les meilleures productions de légumes en Tunisie.
En 2018, le rapport de l’Efe « Mourir en exil, mourir dans l’oubli » fait ressurgir de l’oubli le cimetière oublié des exilés républicains, aux tombes détruites et/ou abandonnées (datées entre 1940 et 1947), de la ville de Kasserine, à la frontière avec l’Algérie, où une partie de ces Espagnols se sont installés après avoir subi l’humiliation des camps de concentration français. Ces Espagnols exilés sont morts loin de leurs familles et ont travaillé dans des conditions comparables à de l’esclavage pour le protectorat français (1881-1956). En Algérie notamment, les exilés devenus captifs sont utilisés sur les chantiers du Transsaharien dès 1939. Les républicains portaient des valeurs démocratiques, ils étaient donc fermement opposés au colonialisme. L’exploitation d’un peuple par un autre était pour eux une horreur. Les républicains espagnols voient et dénoncent la pauvreté des « indigènes » (comme le pouvoir Français les nomme), l’exploitation, la torture, l’injustice, le pillage des ressources. Automatiquement, ils ont adhéré à leur combat. Avec le temps, les Espagnols finissent par partir, principalement à cause de problèmes économiques. La dernière vague quitte le pays à la mort de Franco, lorsque l’Espagne reconnait leur service dans la marine. Antonio et Amelia quittent la Tunisie pour gagner Paris, en 1962, sans Elodia, qui demeure à Tunis.
Du passage des républicains au Maghreb, il reste des pierres tombales, bien peu de textes, beaucoup de zones d’ombre à éclaircir. Antonio Zaragoza a plus de chance que ses malheureux camarades espagnols exilés en Afrique du Nord, car il parvient à refaire sa vie en Tunisie avec sa femme, qui devient enseignante, et sa fille Elodia. Mais il ne reverra jamais l’Espagne, contrairement à sa femme Ameli, qui s’y rend à plusieurs reprises au secret en raison de ses responsabilités au sein de la CNT anarchiste espagnole clandestine. Toutes les organisations antifranquistes ont été affectées à des degrés divers par les luttes internes dans l’après-guerre, mais celles-ci ont été particulièrement violentes entre membres de la CNT. Ces affrontements provoquent une première scission du mouvement libertaire, qui dure seize ans (1945-1961), puis une autre, définitive celle-là, au milieu des années 1960. Deux organisations maintenant les mêmes sigles émerge. La CNT « orthodoxe », éminemment révolutionnaire et majoritaire en exil — dirigée par Federica Montseny et son compagnon Germinal Esgleas —, veut le retour aux purs principes anarchistes. Défendant les collectivisations et les milices, cette fraction souhaite refermer la page de la participation aux gouvernements républicains pendant la guerre civile, qu’elle perçoit comme une cause de l’affaiblissement du mouvement libertaire. De son côté, la CNT « possibiliste », syndicaliste et majoritaire en Espagne, persévère dans la collaboration avec le reste des organisations antifranquistes, y compris en participant aux gouvernements républicains en exil.
Angel Herrerín López, professeur à l’Université de Madrid et auteur de La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y exilio 1939-1975, écrit (in Le Monde diplomatique, 2009) : « Les deux organisations divergent ainsi quant aux tactiques à développer pour chasser Franco du pouvoir. Tandis que les orthodoxes misent sur l’action directe, c’est-à-dire l’insurrection, le sabotage ou l’attentat, les possibilistes défendent la négociation politique, avec pour objectif de rallier les puissances occidentales afin de provoquer la fin de la dictature. Pour les premiers, comme ils l’écrivent dans leur publication, CNT, en décembre 1945, « La chute de Franco sera le fait de la résistance de l’intérieur, de l’action directe contre toutes les formes de tyrannie... en marge de toute action diplomatique, en dehors et au-dessus de tout gouvernement ». Cet affrontement ne pouvait pas pu être plus néfaste pour les libertaires : on a par exemple vu la direction orthodoxe envoyer des militants en Espagne pour chasser les possibilistes de la direction de l’organisation clandestine. Ceci a déconcerté les militants et, dans certains cas, facilité l’action répressive du régime. De plus, toujours en Espagne, la CNT s’est vue privée de l’aide économique qu’elle pouvait recevoir de l’organisation majoritaire en exil, à des moments d’extrême nécessité. Avec la victoire des orthodoxes, la « trilogie sacrée » (syndicalisme révolutionnaire, action directe et communisme libertaire), approuvée lors des congrès de l’avant-guerre, a servi de guide d’action pour l’avenir. La CNT a ainsi continué à voir l’Etat comme son ennemi, à un moment où l’essor du rôle de ce dernier dans la redistribution des richesses fragilisait ce type de critique dans un monde ouvrier qui en bénéficiait largement. Mais le plus grave, sans doute, pour l’organisation fut l’absence de relève générationnelle : ses membres restaient liés à la guerre civile. Le même phénomène affecta l’organisation en exil : consacrant toute son énergie à l’Espagne et caressant l’espoir du retour, elle resta en marge des luttes sociales et politiques des pays d’accueil. Elle se coupa ainsi de sources importantes de renouvellement et abandonna des terrains sur lesquels les libertaires avaient traditionnellement été à l’avant-garde, comme la défense de la liberté personnelle, la culture ou la sexualité. »
En Tunisie, la belle Elodia Zaragoza Jover devient une sportive de haut niveau, athlète sélectionnée aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. L’année précédente, elle a été élue Miss Tunisie 1959. Les jambes, mais aussi, la tête est bien faite et bien pleine, chez Elodia. « Dans les années 50, j’étais championne de toutes les disciplines de natation en Tunisie. C’est ainsi que j’ai rencontré mon mari. Un jour nous nous baignions sur la plage de Hamam-Lif (au sud de la capitale). Il m’a vu et est tombé amoureux », témoigne Elodia Zaragoza Jover, qui devient Elodia Turki. Son mari, Brahim Turki, décédé en 2018, frère du peintre tunisien Zoubeir Turki, devient ambassadeur de Tunisie et secrétaire d’État, auprès du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Fitouri, dans le gouvernement de Hédi Nouira, formé le 27 décembre 1977. Brahim, diplomate de carrière fait partie des jeunes qui rallient les pionniers de la diplomatie tunisienne après l’indépendance. Il est tour-à-tour diplomate, puis ambassadeur dans nombre de capitales européennes. Son dernier poste est celui d’ambassadeur à Paris de 1989 à 1991. Trois enfants naissent : Khayam, Rim (veuve Christophe de Ponfilly) et Sarra.
Après avoir fait le « tour du monde », le couple Turki est installé à Paris, ville où la poète Elodia prend son envol. Il reste, de cette période, comme l’écrit notre ami Pierrick de Chermont, une volonté de se multiplier pour éprouver fortement le maintien du libre dans les hautes eaux. Ce n’est peut-être pas un hasard si elle épouse un diplomate et vit sans se fixer dans les grandes villes d’Europe ; qu’elle possède trois passeports, ou qu’elle mène autant d’activités que de vies : championne de natation et d’athlétisme, Miss Tunisie, professeur de yoga, psychanalyste, éditeur..., comme si lieux et activités offraient un même mélange d’exil et de villégiature, de péril et de liberté reconquise. Jeu d’apparente légèreté ou de détachement, où la poésie joua peut-être le rôle de la mère patrie.
En 1990, Elodia, qui écrit depuis de nombreuses années, depuis toujours, publie son premier livre, De Pierre et d’eau, primé par le grand prix de la Baule. En 1993, elle fait la rencontre capitale de Guy Chambelland, qui édite son deuxième livre, Possibilité antérieure, en 1994. Elodia Turki fonde l’association Le Pont de l’Épée pour soutenir l’activité éditoriale du poète Guy Chambelland et la survie de sa librairie-galerie du 23, rue Racine, à Paris. À la mort de Guy Chambelland en 1996, elle fonde avec Alain Breton les éditions Librairie-Galerie Racine, sauvant ainsi la mythique librairie-galerie du 23, rue Racine, tout en relançant le lieu et le travail éditorial de la maison : « La LGR n’est ni une école qui dicte ni une avant-garde qui guide. Rejetant toute conception élitiste ou idéologique qui manierait le mépris et la censure, elle défend et respecte une large pratique de l’écriture poétique dans le cadre d’un droit fondamental de l’individu : le droit à l’être. Ses repères sont clairs et exigeants, tant dans son activité éditoriale que dans ses manifestations poétiques. L’écriture poétique, plus qu'un jeu de mots ou d'émois, est une quête pour structurer son identité à son expérience intérieure, besoin vital et enjeu d’être pour un sujet, un autre et un monde plus réels et plus complets, unissant le sens du langage au sens de l’existence selon la liberté et l’authenticité de chacun : privilégier l’émotion, bien viser l’âme ou l’être, délivrer la beauté, dans la présence et la coïncidence du monde. Langage de l’être qui ne triche pas avec l’être, la poésie instruit l’authenticité émotionnelle de la vie. »
Chaque année, près d’une trentaine de recueils enrichirent le catalogue de la collection LGR. Un an plus tard en 1997, la revue Les Hommes sans Épaules est relancée, de concert avec Jean Breton et Christophe Dauphin. La Librairie- Galerie Racine propose des rencontres, des échanges, qui bien souvent se poursuivent jusqu’à tard dans la soirée à la Brasserie Les Racines. Durant cette période, elle publie plusieurs livres de poèmes importants : El Ghazal en 1997, L’Elle du doute en 2001, Ily Olum en 2003, Mains d’ombre en 2012, L’infini Désir de l’ombre en 2017. Outre des livres de poésie, Elodia Turki publie des nouvelles comme Le Charme d’Élie en 1993. Elodia Turki, membre du comité de rédaction de la revue Les Hommes sans Épaules, co-dirige les éditions Librairie-Galerie Racine, de 1996 à 2006, vit entre Sidi Bou Saïd et Paris. Et n'oublions surtout pas son récit autobiographique poignant, La Chiqueta (2004).
C’est à compter de ce livre, qui fait date dans sa vie comme dans son œuvre (et qui sera traduit en espagnol sous le titre La Xiqueta), qu’Elodia commence à nous parler de l’Espagne, de la guerre, de l’exil. Il y avait un rituel avec Elodia. Elle nous invitait en petit comité, poètes de la Librairie-Galerie Racine et des Hommes sans Épaules, pour déguster la paella qu’elle cuisinait elle-même, dans son pied à terre parisien de la rue Ernest-Reyer (Paris 14). La paella, rappelait-elle, est un plat valencien. Il signifie d’ailleurs en valencien « poêle à frire ». Lors de la première, j’ai eu l’outrecuidance de lui demander du chorizo. Lecteur, il faut que tu le saches, surtout si tu manges le plat emblématique avec des valenciens : On ne plaisante pas avec la paella de Valence ! Elodia me fusille du regard : On ne met jamais de chorizo dans la paella !
Elodia était complètement décomplexée en apparence. Avec elle, tous les sujets pouvaient être abordés. Elle semblait sans tabou ni limites. Mais pourtant, il y avait beaucoup de pudeur, de secrets et de blessures en elle. À commencer par la naissance, l’enfance, l’arrachement au pays… (« La vie est belle, vue de l’absence de douleur qui devient une grâce. Parfois mes vies se chevauchent et se blessent. Parfois elles s’articulent et cohabitent harmonieusement »). Tout ce qui apparait, souvent voilé dans sa poésie et sa belle langue, si personnelle : « L’Espagne était un rêve. Le pays dont on m’avait dépossédée. Le bouc émissaire était tout désigné : Franco. Assimilé au diable. Par sa « faute » nous vivions en exil, entre parenthèses, dans un pays provisoire qui devait durer plus de trente ans. Là-bas il ne pleut que la nuit, nous disait ma mère. Les femmes y sont si belles !, disait mon père entre deux interminables silences où seuls ses yeux obliques parlaient dans leur langage de lumière…. Ce qui rendait mon Espagne à moi utopique, c’était son impossibilité à être atteinte. On n’avait pas le droit d’y aller. On devait attendre la mort de Franco. Alors « on » attendait… » Il y avait un rituel avec Elodia : la paella !
La langue, comme l’écrit Rémi Boyer, redevient sous le regard d’Elodia ce continent créateur, ce réel unique que masquent les mondes. Les mots peignent et dépeignent, par touches légères, qui, au lieu de couvrir, libèrent. Il s’agit simplement de beauté. Devant cette poésie, le lecteur a juste envie de silence afin de laisser la profondeur l’engloutir avec bonheur : Tu viens vers moi des lucioles plein les yeux — Tu déclenches le jour — Le ciel recueille tes étoiles… L’œuvre d’Elodia est un inlassable chant d’amour aérien, dont certaines pièces n’auraient sans doute pas été reniées par Hâfez, le grand maître de la poésie persane, lui-même. Langage épuré, image sensuelle et soigneusement ciselée, vocabulaire précis. Chez Elodia l’amour côtoie le doute, la solitude, l’attente, l’absence et le questionnement de soi. Notons, ajoute Lucien Wasselin (in recoursaupoeme.fr, juin 2018), que le poème est court, la plupart du temps. Elodia Turki donne l’impression de décrire ses relations avec un tu jamais identifié. S’agit-il de la description de l’amour, de la passion ? Notons aussi le goût de l’image : « Et j’invente pour nous une très lente nuit / tissée de peurs et d’innocence / qui nous dépose sur les grèves du temps / ensoleillés de lunes ». Est-ce le stupéfiant image dont parlait le surréalisme ? Elodia Turki ausculte son corps car elle est sensible à ses changements. Cela ne va pas sans obscurités que soulignent ces mots : « entourés d’ombres longues ». Elle a le goût des mots rares comme ouroboros sans qu’elle éclaircisse le sens de ce terme mais sa forme la plus courante est celle d’un serpent qui se mord la queue, le plus souvent. Ce vers « Et voici le poème d’où surgit le poète ! » n’est-il pas éclairant ? Elodia Turki souligne qu’elle ne facilite pas la lecture de ses poèmes : « Je signe enfin de cette encre furtive / quelque chose de moi qui se rebiffe // L’irréversible plonge ses griffes d’ombres / fige notre désir pour toujours différent ». Et puis, il y a cette soif inextinguible d’écrire : « Terrible est le silence ». Et puis, il y a cette attirance de l’ombre… Elodia Turki dit haut et fort sa féminité et la passion amoureuse.
Notre très chère Elodia est décédée en Tunisie le 30 novembre 2020, à l’âge de 81 ans. « Ainsi, je suis tombée, toute petite, dans un tonneau d’amour, de liberté et de courage. Heureuse d’être femme et d’avoir été nourrie au lait de cette mère qui n’était peut-être pas consciente qu’il n’y aurait jamais rien d’autre à comprendre que ce qu’elle avait compris », écrit-elle de cette mère, la Chiqueta, à laquelle elle consacre l’un de ses plus beaux livres, de ses plus beaux chants. Il y en a tant. Mais le plus beau chant d’Elodia, c’était sa vie, sa présence, son amitié parmi nous depuis 1996…
Fille de deux héros républicains espagnols, la fille de l’héroïne anarchiste de Valence, la Chiqueta, Elodia a hérité de ses parents l’esprit de combat et de résistance contre l’avilissement de l’Homme : « Je n’accorde à rien ni à personne le droit de penser ou de ressentir à ma place... Quand le cœur devient l’unique occupant d’un corps et se pend au gibet de sa gorge, se fait lourd, outre veloutée et tiède qui menace de choir... alors la main spontanément se tend, s’arrondit pour recevoir, protéger, caresser, consoler, aimer. Et cette émotion suspendue, le temps d’un étonnement, comme un éclair domestiqué, abrite et habite, Hôte absolu, l’Autre, dans une reconnaissance éperdue. »
Elodia a été durant vingt-quatre ans, pour nous les poètes des Hommes sans Épaules, notre soleil, notre sourire insaisissable, notre sœur et confidente en vie et en poésie, notre camarade qui ne se plaignait jamais des épreuves de la vie et de cette maladie des os, qui la martyrisait et déformait ses mains, ses doigts : « Une maladie rhumatismale me squatte… Mes mains sont déformées à leur tour, transformant ma blessure en douleur, mon enthousiasme en vide. » Chez Elodia comme dans son poème, il y a beaucoup de douleur et beaucoup d’amour, le tout étant cousu, décousu et recousu par son immense sourire.
Elodia disait s’être transformée en oiseau et aussi : « J’ai eu une vie très heureuse, j’ai eu de la chance malgré l’exil et la nostalgie du pays où je suis née enfermée et dans lequel mes parents n’ont pas pu revenir libres et en démocratie. » Unique et irremplaçable, Elodia nous laisse inconsolable, avec plein de poèmes et de mystères… Elodia, ma Belle dans un calque de fleurs tes doigts dénouent le vent… Mais le plus beau chant d’Elodia, c’était sa vie, sa présence, son amitié parmi nous depuis 1996… Nous avons perdu notre très chère Elodia et nous n’y croyons pas… Valence et Sidi Bou Saïd, non plus… ses soleils que notre Elodia aimait tant… Dans un calque de fleurs tes doigts dénouent le vent…
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
Œuvres :
De Pierre et d’eau (CDP, 1990), Le Charme d’Élie (Souffles, 1993), Possibilité antérieure (Le Pont sous l’Eau,1994), Al Ghazal (Librairie-Galerie Racine, 1997), L’Enlèvement, avec Pierrick de Chermont, (Librairie-Galerie Racine, 2000), La Disparition, avec Pierrick de Chermont, (Librairie-Galerie Racine, 2000), L’Elle du doute (Librairie-Galerie Racine, 2000), Le Plus beau village du monde, avec Pierrick de Chermont, (Librairie-Galerie Racine, 2001), Ily Olum (Librairie-Galerie Racine, 2003), Que passe une fraîcheur, avec Jean-Marc Riquier (Librairie-Galerie Racine, 2003), Ainsi soit Ellil ! ou Les Champs du Paradis, avec Jean-Marc Riquier (Librairie-Galerie Racine, 2004), La Chiqueta (Librairie-Galerie Racine, 2004), Mains d'ombre (Les Hommes sans Epaules/ éd. Librairie-Galerie Racine, 2012), Mains d'ombre, édition bilingue français/arabe, poèmes traduits du français par Habib Boularès (éd. Librairie-Galerie Racine, 2015), L'infini Désir de l'ombre (Collection Les Hommes sans Epaules/éd. Librairie-Galerie Racine, 2017).
[1] Le plus vaste des combats qui furent livrés durant la guerre d’Espagne entre les forces républicaines et les insurgés nationalistes. Elle se déroula dans la basse vallée de l’Èbre, entre le 25 juillet et le 16 novembre 1938. Ce fut la dernière grande offensive des républicains, mais elle se solda par un échec tactique et stratégique, qui précipita la fin de la guerre.
*
La mer dessinée par ma soif
portera mes vaisseaux
tout sera car je suis
fantastique animale
enfant illégitime
d’une grotte… et d’une étoile
*
Sa main - la tienne
telle une ombre jalouse
dans la fleur innombrable de ma peur
peut-être eut-il suffi
que la lenteur des yeux
épelle enfin le trouble
pour que pour toujours soit
l’improbable partage
Elodia TURKI
(Poèmes extraits de Mains d’ombre, édition bilingue, éd. Librairie-Galerie Racine, 2015).
*
Je poursuis l’onde lente
le contre-songe de notre histoire
C’est de tous les souvenirs le plus doucement triste
Quelque chose rouge quelque chose fort en mes doigts dénoués
Tu cherches un contour – un dieu pour l’implorer
Qu’espères-tu qui ne soit en toi depuis le premier souffle ?
Seul interdit – ce moment suspendu perplexe –
un peu –
qu’un liquide brûlé enfin délivre
Elodia Turki, L’Inifini désir de l’ombre
*
LETTRE A LA CHIQUETA
Je n’ai jamais connu les camps de concentration, et pourtant deux camps m’ont connue et « accueillie » pendant une dizaine de mois : celui d’Argelès-sur-mer et de Bram.
Je suis née en prison, à Valencia, en novembre 1939, où ma mère, Amelia Jover, républicaine anarchiste libertaire, a été enfermée à la fin de la guerre d’Espagne pour activités antifascistes. Elle avait 28 ans, venait d’épouser mon père, Antonio Zaragoza, capitaine de corvette dans un sous-marin républicain. Trois jours ensemble et tout se délite : plus de nouvelles de mon père pendant des mois.
Ma mère a appris qu’elle était enceinte de moi dans la prison. Toute sa grossesse s’est passée alors qu’elle était au cachot, au secret. Toutes les autres femmes s’étaient réunies pour renoncer chaque jour à une portion pour la donner à ma mère, et que moi je me porte bien quand je sortirais de la prison.
Elle disait qu’en prison, il y avait une grande solidarité entre les prisonniers et les prisonnières, et même entre les gardiens. Parce que ma mère était quelqu’un qui avait fait beaucoup de bien autour d’elle, comme mon père aussi. C’était une femme très humaine. Et tout ce qu’elle avait fait pour les autres, cela lui a servi plus tard. Parce qu’elle avait retrouvé un gardien qui se rappelait qu’elle avait fait quelque chose pour son frère, alors il l’a un peu protégée. Et elle a eu ses rations dans les cachots, pendant sa grossesse. Ensuite elle a accouché à l’hôpital de la prison, avec deux policiers devant la porte de l’infirmerie. Ces deux policiers devaient la regarder, la surveiller. Et quand même, elle a obtenu qu’ils puissent tourner le dos pendant qu’elle accouchait. De là, elle a développé une terrible haine de la police.
Elle ne sortait pas se promener, elle n’avait pas le droit de communiquer avec les cellules voisines. C’étaient des cachots à l’ancienne, il n’y avait pas de communication avec l’extérieur, c’étaient des portes fermées. Et c’est vrai que moi j’ai toujours adoré les endroits fermés. Pour moi je crois que le cachot, c’était l’utérus de ma mère. Parce-que c’est là que j’ai été conçue jusqu’à ma délivrance. C’est chez moi. J’ai mis du temps à aimer les espaces ouverts. Je les aime, quand je suis dehors, mais quand je suis dans une maison, je peux être dans un endroit sans fenêtre, sans porte, cela ne me dérange pas ! C’est drôle...
Un enfermement pour moi ? Son ventre + le cachot pour elle? On a envie de dire oui, mais... non ! Des dizaines de fois, à toutes les périodes de ma vie, j’ai écouté le récit de ma mère. Ses remarques. Ses comparaisons avec ce qu’elle voyait vivre autour d’elle. L’urgence. Le non-choix.
« Il y avait pire que moi. Je voyais ces files de femmes et d’hommes, avec leur petit baluchon, souvent avec des enfants, en hiver, traversant les Pyrénées pour atteindre la sécurité qu’ils pensaient trouver en France. Ce n’était pas le moment d’avoir des états d’âme. »
Quand je suis née, ma mère apprit qu’elle risquait d’être exécutée mais qu’on attendrait que j’aie trois mois pour me confier à ma grand-mère. Elle organisa alors, avec l’aide d’un parent, au cours d’une visite médicale, son évasion. Peu importe les détails, rocambolesques comme ils peuvent l’être dans ces situations-là. Elle était jeune, croyait en ses idées, croyait en tout ce qui était juste et positif et la voici, avec son bébé de deux mois, dans la file de ces réfugiés hagards en plein mois de janvier, vers le camp d’Argelès-sur-mer.
Mais le camp était encore un projet: pendant des jours et des jours les arrivants ont dû dormir à même le sable, creusant des trous que les plus chanceux recouvraient d’une bâche ou d’une couverture. Moi sur son ventre. Contre elle. Dans un sac qu’elle refermait autour de mon cou (l’ancêtre de la gigoteuse ?)
« Ensuite on nous demandé de participer à la construction des baraquements. Beaucoup d’enfants mouraient. Il y a eu une épidémie de choléra. Les conditions sanitaires étaient horribles. Moi je te nourrissais au sein. C’est ce qui t’a sauvée. Plus tard j’ai eu une autorisation de nourrir deux autres bébés. Je n’ai jamais su ce qu’ils étaient devenus.»
La vie s’organisait dans le camp. La solidarité aussi. Elle avait réussi à se procurer un vaccin pour moi. À l’infirmerie on le lui confisqua (priorité aux enfants français). Pas grave, j'avais déjà été condamnée à vivre. Je me passai de vaccin.
J’entends la voix de ma mère raconter, humblement, fièrement, tranquillement, l’insupportable. Des compagnons battus et torturés pour qu’ils se dénoncent les uns les autres. La France qui venait les rassurer et leur dire que tout avait changé en Espagne et qu’ils pouvaient tous rentrer chez eux.
« Tous ceux qui se sont laissés tenter ont été emprisonnés ou exécutés. Je l’ai su plus tard. C’était un piège tendu par les deux gouvernements pour se débarrasser de nous. Nous étions trop nombreux. Les Français avaient mauvaise conscience : nous avions le tort d’avoir gagné les élections et d’avoir subi un coup d’état fasciste. Ils avaient d’autres plans. On gênait.»
Elle était intarissable quand il s’agissait de cette période de sa vie (elle nous a quittés à 86 ans, de mort naturelle).«Il y avait des rats partout. Des gros rats. J’avais peur qu’ils te mordent. Qu’ils profitent de ton sommeil pour t’attaquer. Je te faisais d’autres sacs, plus grands au fur et à mesure que tu grandissais. Et je te serrais contre moi toute la nuit. Je les sentais courir sur toi, sur nous, mais jamais ils ne t'ont attaquée. Et à chaque instant je remerciais la vie de nous avoir malgré tout protégées. Il y avait tant de malheurs autour de nous.»
La vie des camps commençait à s’organiser. Ma mère retrouvait de temps à autre des connaissances. Des voisins. On commençait à communiquer, à partager des informations, la plupart du temps dramatiques. Familles séparées. Suicides. Elle aidait aux cuisines. Après quelques mois on décida de nous transférer dans un camp disciplinaire. Celui de Bram. Que ma mère écrivait Bram!!!!«Je l’écrivais avec plein de points d’exclamation tellement c’était terrible. Il n’y avait aucune humanité. Un des responsables du camp était allemand, il avait deux chiens énormes qui terrorisaient tout le monde. Et là, en écoutant chuchoter les uns et les autres, j’entendis quelqu’un évoquer le nom de ton père!»
Pendant encore des semaines elle essaya de se mettre en rapport avec mon père. Elle apprit qu’il avait rejoint la Tunisie avec son sous-marin. Un intermédiaire accepta de lui faire parvenir une lettre.
« On ne pouvait quitter le camp que si on retournait en Espagne. Et ça, il n’en était pas question, avec ce salaud de Franco à la tête du pays. Plutôt mourir! Mais on avait aussi des chances de le quitter pour rejoindre son conjoint. Il fallait ruser: dans le camp de Bram une partie des responsables étaient pro-fascistes, mais on murmurait des noms de personnes qui pouvaient aider, par la filière bienveillante pro-républicaine amie. De la Tunisie je reçus une lettre du représentant des réfugiés de Tunis, qui joignait aussi une lettre signée par un colon français qui se portait garant pour mon père et donc pour ma mère.»
Quand je demandai à ma mère « Tu as dû te sentir soudain libre ? » elle me répondit quelque chose de si évident que j’eus presque honte de lui avoir posé la question:
«Libre? Mais j’ai toujours été libre, moi! On ne peut pas enfermer une idée ni une liberté. J’ai encore appris dans les camps. J’ai encore grandi. Tu as toi aussi toujours été libre et tu seras toujours libre. Tu avais choisi la vie parce que tu n’avais pas le choix. Quand on a quitté Bram tu avais près de onze mois et je me disais que tu ne te souviendrais de rien, mais j’ai gardé pour toi ta plaque avec ton numéro de prison et celle des camps. Et je t’ai toujours dit que la liberté tu peux l’avoir même dans une prison. Ta liberté c’est ta liberté de pensée et ton éthique. Tout le reste ce sont des anecdotes.»
Ainsi, je suis tombée, toute petite, dans un tonneau d’amour, de liberté et de courage. Heureuse d’être femme et d’avoir été nourrie au lait de cette mère qui n’était peut-être pas consciente qu’il n’y aurait jamais rien d’autre à comprendre que ce qu’elle avait compris.
Juste merci, maman.
Elodia TURKI
*
HOMMAGE A ELODIA TURKI
(30 novembre 2021)
Je suis triste infiniment. J'aimais tant Elodia Turki. Il y a quelques années en me promenant dans les chemins du Coglais avec « L’elle du doute » , quel titre !, livre d'Elodia paru il y a vingt ans, à Librairie-Galerie-Racine, j'avais écrit un poème publié en 2009, à la même Librairie-Galerie-Racine, lieu d'importance pour nous deux, à l'origine de nos rencontres. Ce long poème se terminait ainsi :
Un livre à la main
c'est un printemps fait pour la joie
Dans un épais parfum d'acacias
Monte d'un champ voisin
Une pensée d'Elodia Turki
Solide et fraternelle
En harmonie un pouvoir
Au bon moment
Se pose sur le monde qui chancelle
L'œuvre d'Elodia est diverse aussi forte et juste qu'elle l'était dans la vie. Avec Elodia écrire c'était vivre. J'ai souvent présenté et souvent lu des poèmes d'Elodia. J'aimais me glisser dans sa peau ! Je disais familièrement que c'était une sacrée nana ! ça la faisait sourire ! Elle m'avait impressionné par son parcours de vie, son charisme, son authenticité, sa franchise. Tout ça faisait une sagesse ! Nous avions établi un dialogue amical à la LGR mais depuis plusieurs années, nous avions pris l'habitude de nous faire signe quand nous étions à Paris l'une et l'un. Nous mangions alors près du parc Montsouris qui était aussi un de « nos » lieux ou dans une brasserie que nous aimions près d'Odéon. Parfois nous appelions Julie Nuna Bataille qui nous rejoignait, ou c'est dans un repas avec Julie que nous pensions à appeler Elodia qui alors nous rejoignait. La dernière fois que nous avons mangé tous les 3 c'était début mars juste avant le premier confinement. Julie qui est chercheuse nous disait de prendre ce virus au sérieux. Nous avions alors décidé d'être prudents et de ne pas nous embrasser... mais au moment de nous quitter, nous avons oublié notre promesse et nous nous sommes « claqués » une bise qui me revient là abrupte avec son statut de bise définitive. Je pense à tous ces amis, à ces proches qui avaient la chance de fréquenter une femme aussi simple qu'elle était d'exception et la tristesse qui doit être la leur et je leur transmets mes condoléances les plus sincères.
Un poème de « L'elle du doute » me revient en mémoire, avec les deux premiers vers :
C'est un langage fou
une douleur poème
et les deux derniers :
Tout cela devenait
Langage du jardin
*
COLERE D’ARGILE
à Elodia Turki
Ça colle aux souliers
Ce sang
Sali de boue
Rosier d’argile
Rageur
Quand le poète est un hérisson d’atomes
Ce monde est improbable
Religieux et non spirituel
Où l’enfant de Bagdad
Est coupé en deux pour son bien
On dit une frappe chirurgicale
On dit des mots comme ça
Est-ce la fin de l’homme
Quand la mort technique et moderne
Se couvre des mots du soin
Où sont les mots qui lient
Où sont les pays
Où sont les sages
Où sont les solides questions
Est-ce la fin d’un cycle
Comme tu le pensais mon père
Le temps du Pontificat de Jean
Celui que Jésus aimait
La chute nécessaire annoncée
A ceux qui savent lire
Au-delà des grognements et des syntagmes
Le livre de la religion universelle
Et les ayatollahs commentent
Et s’entretuent déjà
Lirai-je les cent quarante sourates
Les comparerai-je aux Testaments
Puis au livre de Bhagavad Gitâ
Verrai-je avec toi dans ce grand désordre universel
Le temps venu d’une nouvelle descente
D’un Vishnu ou d’un Jésus
Non
Je t’emmènerai doucement chercher l’or du temps
Chez un André qui n’est pas ton enfant
Chez ces hommes-oiseaux qui voulaient changer le monde
Avec ce qui est disponible à l’homme au magasin des merveilles
Un projet héroïque qu’on ne visualisa hélas qu’un instant
Et qui est mon père toujours en moi
Ce sont des certitudes
Quand je marche simplement
Dans un chemin que le hasard a choisi
Un livre à la main
C’est un printemps fait pour la joie
Dans un épais parfum d’acacias
Monte d’un champ voisin
Une pensée d’Elodia Turki solide et fraternelle
En harmonie un pouvoir
Au bon moment
Se pose sur le monde qui chancelle
André PRODHOMME
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
Publié(e) dans le catalogue des Hommes sans épaules

|

|

|
| Mains d'ombre | L'infini Désir de l'ombre | Mains d'ombre (bilingue) |