|
Tri par numéro de revue
|
Tri par date
|
Page : <1 2 3 4 5 6 7 8 >
|

|
|
Lectures :
Tout ce cinquantième numéro est orienté vers la liberté et la résistance comme si, en cette période, il fallait rappeler que la poésie est toujours une résistance à toutes les formes d’oppression, jamais une collaboration.
Les premières pages rendent hommage à Maria Andueza, personnalité foret et discrète de la scène poétique, compagne de Jean Breton, basque espagnole de la Retirada, retraite des réfugiés espagnols de la guerre civile 1936-1939.
Christophe Dauphin livre un éditorial plein d’une saine colère dite coronavirienne à propos de la mort de Guy Chaty : Qui a tué le poète Guy Chaty ? lance-t-il, cette « femme tousseuse » ? La sous-estimation des risques ? Le mépris des « expériences étrangères » ? Le court-termisme cynique politicien ? Leur incompétence ? L’Etat néolibéral et son inhumanité ? L’hôpital à la carcasse désossée par l’Etat néolibéral ? L’absence de tests, de moyens, de masques ? Marc Bloch nous dit d’outre-tombe (in L’Etrange Défaite, Société des Editions Franc-Tireur, 1946) : « Nous venons de subir une incroyable défaite. A qui la faute ?… A tout le monde en somme, sauf à eux (nos généraux). Quoi que l’on pense des causes profondes du désastre, la cause directe – qui demandera elle-même à être expliquée – fut l’incapacité du commandement. » Et plus loin : « l’épidémie a mis à nu et fait ressortir toutes les impostures de la doctrine libérale ».
Christophe Dauphin propose textes et notices de poètes à l’hôpital. Nous retrouvons Arthur Rimbaud, Antonio Tabucchi, Richard Rognet, Paul Verlaine, Madeleine Riffaud, Henri Michaux, Jean Rousselot, Stanislas Rodanski.
Le dossier est consacré à René Depestre « ou l’odyssée de l’Homme-Rage de vivre ». René Depestre, poète haïtien errant et homme d’exception dont la route serpentine le conduisit auprès de Che Guevara, Fidel Castro, Mao-Tsé-Toung comme aux côtés des poètes et penseurs Blaise Cendrars, Tristan Tzara, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, André Breton, Léopold Sédar Senghor et tant d’autres.
L’un des aspects les plus intéressants soulevés par Christophe Dauphin à propos de son nomadisme est sa capacité à exiler l’exil : « Je ne suis pourtant pas un homme de l’exil, explique René Depestre ; je ne connais pas l’effondrement existentiel, la perte tragique de soi des exilés de à vie. J’ai pu partout sur mon chemin prendre des racines. Je me suis ajouté les pays de mon nomadisme. Et je ne suis pas désespéré, et j’ai fait de la mondialisation comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, sans le savoir ! Comme aurait dit Sartre, j’ai fait de ses antagonismes de l’exil des contradictions fécondes. »
« René Depestre ne s’est jamais considéré en exil, reprend Christophe Dauphin, il n’en a jamais souffert, car, nous dit-il : « J’ai emporté avec moi Jacmel, mon enfance. Je n’ai jamais eu le sentiment d’être un exilé ; je n’ai jamais souffert de l’exil parce que depuis la plus haute Antiquité, il y a une sorte de dolorisme attaché à la notion de l’exil, à la notion de nostalgie, à la notion de saudade au Brésil, en portugais. Moi, je n’ai jamais connu cette sorte de malaise existentiel dû à l’exil, parce que j’emporte avec moi partout où je vais Haïti, mon chez-soi haïtien ; mon chez soi insulaire m’a toujours accompagné, mon natif natal fait partie de mon nomadisme, si je peux dire. »
C’est sur ce socle que René Depestre a développé une poésie puissante et joyeuse pendant « soixante années de création poétique, précise Christophe Dauphin, dont chaque mot a été lavé par la vie, dont le poète est le vaudou-l’arc-en-ciel, avançant à grands pas de diamant ; véritable journal de bord intérieur sur le qui-vive du monde, autobiographie criblée de combats, de rivières et de rêves en crue ; taillée dans la saison des îles du sang poétique, le long d’un itinéraire exceptionnel, qui unit le mythe aux nervures du vécu, des premiers poèmes en colère, au chant dionysiaque et vigoureux des passions caribéennes, avec l’étoile de tous les hommes. »
« Poème ouvert à tous les vents »
Tu as mis une paire d’ailes à ton art
Car tout poète sait quand c’est l’heure
De jeter ses dernières cages à la mer
Et de lever des voiles qui font route vers son identité.
A l’homme à qui on a tout pris : son nom,
Sa patrie, la fable de son enfance,
Le bois de ses souvenirs, sa rage de vivre.
A cet homme à qui on a enlevé ses jambes
Pour qu’il reste à jamais coincé dans ses cris.
A cet homme brisé, fourvoyé dans sa peau.
Je lègue ma fureur et mon bruit, je remets
Une colline que tous les vents traversent
Pour qu’il soit toujours en train de se battre
Et qu’il n’arrête jamais de frapper les papes
Qui vole à la vie ses perles et son orient.
A cet homme que l’horreur infinie du monde
N’a pas encore vaincu, à cet homme dompteur
Des métaux de son sang, géomètre des courbes
Lyriques de la femme, et qui répète que
La vie humaine est la fumée d’un incendie
Dont le nom n’apparaît dans aucun idiome.
A cet homme né sur un ordre du rossignol
Et à qui le feu confie ses bêtes de proie
Je réveille son droit de réinventer l’homme.
Je luis dis : « Suis-moi. Je suis le vieux soleil
Qui émerge de la douleur pour mieux sauter
Dans la vie du siècle et pour combattre
Sa routine et ses malheurs. Viens avec moi,
Homme qui ressemble à l’aventure des flammes
Et des illusions qui protestent dans mes yeux ! »
René DEPESTRE
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 2 août 2020).
*
« Les poètes d’Europe ont cessé de chanter – Ils ont fait de l’écriture un tremplin – D’où ils lancent des papillons de cirque – Sans aucun secret dessiné sur leurs ailes. » René Depestre, c’est le grand invité du n°50 des Hommes sans Epaules. Christophe dauphin lui consacre une étude, « poète haïtien, poète français, universel, nomade enraciné, homme banyan, métissé, solaire et souriant ». Faut dire qu’il en a rencontré du monde, Depestre : on le voit en photo auprès de Mao-Tse-Toung, de Neruda, de Césaire, de Guevara…
L’autre grand invité, c’est le Suisse Pierre-Alain Tâche : « J’ai glissé dans mon sac une offrande – un caillou rond qu’il me faudra jeter – plus loin, pour témoigner de mon passage – (Et c’est bien plus que des pierres en tas – peut-être une grappe offerte au seigneur – à sa vendange ultime, au jour qu’il a fixé… »
Dans ce numéro itou, un gros dossier (inspiré par le covid ?) sur les poètes à l’hôpital : Rimbaud, Verlaine, Artaud, Yves martin, Michel Merlen, Madeleine Riffaud, Henri Michaux, etc. avec des textes des susnommés ou celui d’Alain Morin : « En ce lieu – les hommes brouillent l’air – ou se rassemblent – On est seul – à manger l’espace – qui a le goût de panade – Le temps est un cadavre – que l’on n’enterre pas ».
Remarquable aussi la série d poèmes du camerounais Kouam Tawa : « On cherche – le buffle – sans trouver le buffle - On trouve - le buffle – sans saisir le buffle – On danse - la danse – des mangeurs de poussière ».
Christian Viguié : « Je ne sais pas qui je suis – mais il y a ton nom que je murmure – comme s’il a avait un autre air à respirer… »
Philippe Monneveux, Jean-Pierre Otte et Béatrice Pailler : « Je suis ongle – tu es papillon – Tes paupières – Je les vole – Tes lèvres – Je les vole – Tu es papillon – Je suis bec – Couteau sur ton abdomen… »
Plein d’autres choses comme l’annonce de la mort de la poète grecque Kiki Dimoula : « Ta démission est acceptée – Dommage – Tu avais tant à perdre encore ici.
Et de nombreuses critiques. »
Christian DEGOUTTE (in revue Verso, 2020).
|
|

|
|
Lectures :

*
Ce beau numéro de la revue fondée par Jean Breton en 1953 est consacré aux Damnées et Damnés de la poésie.Voici quelques extraits de l’éditorial puissant de Christophe Dauphin qui appelle à un Manifeste de l’Emotivisme :
« La création est pour le poète la blessure originelle. Son poème est habité, vécu, y compris dans la dimension onirique : un enjeu d’être total, et pour tout dire, émotiviste, car l’émotion est l’équation du rêve et de la réalité ; qui met le sujet hors de soi. »
« La poésie c’est l’être et non le paraître, un vivre et non un dire. Dans cet enjeu d’être total, ils sont nombreux, ceux qui, connus, inconnus, méconnus, ont laissé jusqu’à leur vie : les grands gisants d’intime défenestration, écrit Roger-Arnould Rivière, qui ajoute : je sais que la détonation contient le même volume sonore – que les battements du cœur qui bâtissent toute une vie. »
« La damnation, la malédiction du poète, c’est aussi ces livres qui se lisent peu ou pas, dont la diffusion est complexe et dont personne ne parle, qu’à titre confidentiel. Au mépris de la société répond souvent, plus cinglant, le mépris ou l’incompréhension de l’entourage. Le mépris, c’est-à-dire, l’indifférence. En somme le poète est un invisible, il n’existe pas. On l’aime mort après une vie malheureuse. »
« Il faut bien dire cette solitude, ce désarroi, ce désespoir, qui entourent le poète. Il n’était pas, il n’est toujours pas facile de vivre dans la peau d’un poète, qui doit exister en face de gens qui nient purement et simplement son existence… »
Pourtant, aucun misérabilisme chez Christophe Dauphin mais une juste lucidité qui s’accompagne de sagesse, d’une science du combat et d’un art de l’être.
« La poésie est l’unique réponse aux mascarades mensongères du monde, l’expression la plus intime et la plus intense de l’être. »
Il ne s’agit pas seulement de résistance à l’oppression mais bien d’un chemin intime de libération, ce qu’illustre le dossier consacré à Edouard J. Maunick, « le poète ensoleillé vif », dont la poésie s’épanouit entre île et exil, la condition même de l’être, exilé dans l’humain, et qui se constitue comme île.
« Pour moi, dit-il, la parole poétique n’est pas du tout différente de la parole physique, c’est-à-dire de ce mécanisme de vie qui commence au ventre, au plexus solaire, traverse la colonne, la trachée et sur lequel, au moment où l’expiration va se produire, l’homme appose une rumeur intelligible. C’est cela la parole. Je n’ai jamais pu corroborer l’expression coup au cœur – pour moi, il s’agit toujours d’un coup au ventre. Le poème étant la parole exigée, toute parole prononcée par l’homme et qui ne ressort pas au quotidien domestique, est poème. Par quotidien domestique, entendons ce que les civilisations nous ont donné comme manières, nous ont créé de verbiages, etc. »
Testament d’un errant (extrait)
… si meurt le poème/
le bluff littéraire
l’aura emporté
sur une autre Passion
sans les trente deniers
mais payées en nègres/
sans Gethsemani
pour dernière prière
mais l’île de Gorée
pour station maudite/
triste embarcadère
d’une ébène de chair
vers l’Outre-Atlantique/
Golgotha de mer
dans le Sanhédrin
ni de Ponce Pilate/
mais docteur-es-Traite/
sans couronnes d’épines
mais chaînes et carcans/brûlures de fouet
pour flagellation.
Reste la mise en exil :
Si meurt le poème/comment conjurer Gorée ? »
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, juin 2022).
*
« Je parle de l’île comme je parle du ventre, parce que c’est à partir du ventre que j’ai été lâché dans la merveille » (Edouard J. Maunick). Trois parties (je simplifie) composent ce numéro 53 de Les Hommes sans Épaules.
Une première partie : Edouard J. Maunick (un dossier « Le Poète ensoleillé vif » de Christophe Dauphin, avec les contributions de Jean Breton - un formidable entretien avec Maunick - et Léopold Sédar Senghor) et les poètes des îles Mascareignes (Océan Indine : Réunion, Maurice, Rodrigues)). Du plus ancien, Evariste Parny : « Le lit de feuilles est préparé ; je l’ai parsemé de fleurs et d’herbes odoriférantes ; il est digne de tes charmes, Nahandove, ô belle Nahandove ! », à la plus récente, Catherine Boudet : « Mon verbe est celui d’un marronnage blanc – Silencieux poussant cru – Contre l’ortie des hontes – Le bétel du raisonnable », en passant par Malcolm de Chazal et Boris Gamaleya : « ibis – ibiscus – le ciel a ramené au peuple ses rivages – ses racines d’éclats – son corail bec d’oiseau – écoutez-moi – et cette mer en son ancienneté ».
La deuxième partie « Pour les Damnés » (par Christophe Dauphin) dresse une géographie de l’enfer ordinaire sur terre et convoque des poètes mis à la torture par la misère, la maladie, la mort, le sexisme, la guerre, etc. « Ah ! je t’ai bien connue, Misère, j’étais de ceux que tu encenses… » (Ilarie Voronca), « je suis toujours l’individu perdu dans sa propre foule » (André de Richaud), « Une fille et un garçon – la mère préfère – le garçon à la fille – car le garçon épaulera la mère – quand viendront les mauvais jours – et la fille enfantera un autre garçon – qui l’épaulera à son tour » (Ashraf Fayad, emprisonné et condamné à mort pour blasphème en Arabie Saoudite), Laurent Thinès, Joseph Ponthus, Marie Murski, Taslima Nasreen et Claude de Burine : « …ils ont l’air, eux, de tout savoir – parce qu’ils dansent – Les notaires – Les dentistes – Les plombiers – Les chirurgiens-dentistes de fesses – Nous, nous sommes les enfants du malheur ».
La troisième partie, c’est l’anthologique, avec Edith Brick revenue des camps de la mort : « c’est difficile d’être un survivant », Nathalie Swan (l’amour, rien que l’amour) : « Tes coups de reins scrutent mon visage… J’y dévalerai ton éboulis. Quand tu creuses ma faille, la lumière s’avance en aveugle. Deux anges retiennent les mains d’un cri qui voudrait tout oublier », Mathilde Rouyau : « Ton corps muet au bord des nuits, c’est candeur – tes cheveux quand ils infusent dans les bassines de lait de la pleine lune, alors la nacre – tes clavicules trop – fines – tes jambes à peine cuites… » Jennifer Grousselas : « chat suicidé ressuscité – J’ai saisi la tige à boire – qui me poussait l’esprit – me suis deux fois entendue lumière – accouchée par la voix du saint « et enfin un homme (et quel homme !) : Jean-Pierre Lesieur : « On n’apprend pas bien dans les livres – quand on ne sait pas lire les lignes de la vie – ni le sgraffitis qui fleurissent un peu là où – on ne les attend pas – naître pauvre ne facilite pas l’insouciance… » Sinon, plein d’autres choses (pensez 356 pages !) : lectures critiques, regards sur l’art, etc. Voyvez le site : www.leshommessansepaules.com
Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°190, septembre 2022).
|
|

|
|
Lectures :
LA REVUE DU MOIS DE MAI 2023, C’EST : Les Hommes sans Épaules n° 55
On a une somme ! Près de 350 pages, consacrée aux poètes de l’Est (de la France), entre Alsace et Lorraine. Tous les auteurs importants alsaciens et lorrains sont recensés dans ce volume. Tous avec une notice biographique et bibliographique large et soignée.
Chaque fois, on rentre dans un destin, une histoire, pour ne pas dire hors norme, on va dire étonnante. Ces vies de poètes si différents défilent et on y trouve chaque fois un intérêt renouvelé. Parfois aussi on est un peu déçu par les textes joints et proposés, peut-être insuffisamment nombreux ou reflétant des époques même récentes un peu dépassées ou des styles relativement datés. Mais j’ai tout lu d’un bout à l’autre en me régalant. Il faut bien avouer qu’il y a là un particularisme spécifique entre une histoire avec un basculement de nationalités entre 1871 et 1919, puis entre 1940 et 1945 d’un côté et de l’autre consécutivement une langue tiraillée entre français et allemand.
Pour prendre les grands aînés : Jean Hans Arp parle trois langues dans son enfance, avec l’alsacien. Il est aussi bien poète que sculpteur et fera partie du groupe fondateur du mouvement Dada. Les oignons se lèvent de leurs chaises / et dansent aussi rouge que si l’on gantait le jus des nains… Second « porteur de feu » : Yvan Goll, seul représentant de l’expressionnisme en France. Il s’opposera à Breton qui défend écriture automatique et récits de rêves contre une pensée où la raison intervient davantage. Il a inventé le Réisme. À noter, comme le souligne Christophe Dauphin, que son œuvre en France n’est plus du tout éditée. De lunes à lunes / se tendent les courroies de transmission / Soleil sur monocycle / au vélodrome astronomique / poursuis ton handicap…
Suivent ensuite Charles Guérin, poète symboliste, franc-tireur, avec un focus sur le maître verrier Emile Gallé. René Schickele, « général des pacifistes », Claire Goll, à la vie exaltante, Nathan Katz et un second focus sur les « Malgré nous ». Puis Henri Thomas qui pense que « le roman est lié à la vie alors que la poésie est liée au langage. Déclenchement d’une action contre déclenchement d’une harmonie ». La Bastille a des aubes froides / La neige y fait des taches noires.
Le grand Jean-Paul de Dadelsen dont le maître livre est « Jonas ». Claude Vigée disparu en 2020 à l’âge de 99 ans. Il ne nous reste pas un endroit pour tomber. Daniel Abel, son amitié avec André Breton, son lyrisme teinté de merveilleux. Jean-Claude Walter publié par Rougerie. Jacques Simonomis, revuiste de « Soleil des Loups » avec Jean Chatard et du « Cri d’os » : Des terres attendent / serrées dans tes poches / rapetassées d’étoiles filantes / d’éclisses de soleil / avec sous ton mouchoir / la mer qui vaut le coup…
Le dossier central est consacré à Richard Rognet par Paul Farellier : l’enfant s’est retrouvé / prisonnier de la vie, sentinelle d’un territoire / qui ne s’est pas livré. Autre dossier : Maxime Alexandre par Karel Hadek. Il a connu une vie passionnante, rencontre avec Aragon, rupture avec le surréalisme, communisme, expérience catholique…
Joseph Paul Schneider, Roland Reutenauer et Jean-Paul Klée, qu’on adore : « la matière verbale s’est emparée de ma pauvre personne ». Autant de livres édités que d’inédits. Avec un focus sur le Struthof où son père est mort par Christophe Dauphin et des dessins d’Henri Gayot. Enfin Germain Roesz à la fois peintre, poète et éditeur des « Lieux-Dits ». Gérard Pfister et les éditions Arfuyen…
Enfin Ernest de Gengenbach par César Birène, sous-titre : « Satan dans les Vosges ». Une vie incroyable qui mériterait un film. Il est exclu du groupe surréaliste en 1930, y opposant politique et ésotérisme. Prêtre défroqué, a collectionné les « bienfaitrices »…
À noter encore René Char, Christophe Dauphin et Marc Patin, les critiques…
Un numéro passionnant.
Jacques MORIN (in www.dechargelarevue.com, 1er mai 2023)
*
Les Poètes de l’Est dans les Hommes sans Epaules
Christophe Dauphin a voulu ce numéro consacré aux poètes de l’Est, de l’Est de la France, autour de l’Alsace et de la Lorraine, à l’identité marquée et souvent douloureuse. Le dernier numéro consacré aux poètes de cette terre pourtant propice à la création datait de 1972. Il était grand temps. Dans ce numéro de Poésie 1, le n°26, la question alsacienne était présente, celles aussi de la langue, de la guerre, de l’occupation allemande, de l’annexion, etc. Christophe Dauphin prend le temps de rappeler les traumatismes, les blessures non cicatrisées qui immanquablement, consciemment ou non, orientent encore la chanson du poète de l’Est même si la Lorraine et les Vosges relèvent d’autres particularismes que l’Alsace. Si le destin n’est pas commun, il est bien partagé.
Deux porteurs de feu sont présents dans ce volume, Jean Hans Arp et Yvan Goll.
« Jean Hans Harp, nous dit Christophe Dauphin, n’est pas seulement le plus grand artiste sculpteur et poète alsacien, mais aussi, avec Francis Picabia, le plus grand peintre-poète du XXe siècle. Les deux sont issus du sulfureux et subversif mouvement Dada. Il y a donc une injustice à voir son œuvre plastique magnifique occulter son œuvre poétique, qui ne l’est pas moins, magnifique. »
Les HSE nous introduisent ainsi à la poésie du strasbourgeois qui disait de sa sculpture « C’est de la poésie faite avec les moyens plastiques ». L’œuvre poétique de Arp dépasse son expression poétique, elle-même remarquable, pour embrasser toute sa création.
Extrait de « Sophie rêvait Sophie Peignait Sophie dansait » :
Tu rêvais d’étoiles ailées,
de fleurs qui cajolent les fleurs
sur les lèvres de l’infini,
de sources de lumière qui s’épanouissent,
d’éclosions symétriques,
de soies respirantes,
de sciences sereines,
loin des maisons aux mille dards,
aux prosternations de déserts naïfs,
parmi mille miracles débraillés.
Tu rêvais de ce qui repose dans l’immuable de la clarté.
Tu peignais une rose dévoilée ;
un bouquet d’ondes,
un cristal vivant.
Yvan Goll (1891-1950) est vosgien. Il laissa une œuvre considérable en allemand, français et anglais. Si la poésie tient dans son œuvre la place essentielle, il s’intéressa aussi au roman, au théâtre, à l’opéra, rédigea des essais, des anthologies et assura des traductions. S’il est connu et reconnue en Allemagne, il est totalement oublié en France, malheureusement. Ce « Jean sans Terre » devenu par la poésie homme complet, homme universel, mérite pourtant une attention très particulière. Les HsE nous offrent donc la possibilité de découvrir pour la plupart d’entre nous un poète exceptionnel et parfois visionnaire.
Extrait de « Amérique » (in Elégie de Lackawanna, 1944) :
Amérique aux yeux de mercure et d’oranges
Amérique au crâne rempli de fourmis et de comètes rouges
Amérique qui cours et qui n’habites
Que des villes défaillantes sur les dunes
Halte ! Halte ! sur les boomerangs de tes highways
Halte ! devant tes totems d’essence
Dont les yeux de tabac et de pétrole
Clignent sous la dune d’anis
Halte ! te dis-je, car dans ton dos cavale l’avenir
Et le regard sacrificateur de l’Indien
Fait tourner à l’envers les roues de ton soleil
Les roues rutilantes de tes iris ferrugineux
Et les dollars de on chariot roulant à l’infini
Amérique prends garde aux venins verts du lierre indien
Aux plumes de coqs déjà plantées dans ton échine
Prends garde au triangle de l’oiseau nickelé
J’entends tes fleuves frapper leurs écailles de cuivre
Et les oreilles de tes moules emplies
Du suicide éternel des eaux et de la créature
Bien d’autres poètes de l’Est sont présents dans ces pages, notamment Richard Rognet longuement présenté par Paul Farellier et le toujours aussi étonnant Ernest de Gengenbach, abbé saisi et déchiré entre dieu et diable par sa rencontre avec le surréalisme.
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 13 juin 2023).
*
La belle revue pilotée depuis 1997 par Christophe Dauphin parait deux fois l’an, en mars et en octobre, proposant 350 pages de poésie venue de tous les coins du monde. Cette troisième série, qui en est aujourd’hui à son numéro 55, a été précédée d’une première, initiée par Jean Breton, qui parut à Avignon puis à Paris de 1953 à 1956 (neuf numéros), puis d’une seconde, sous la direction d’Alain Breton, publiée à Paris de 1991 à 1994 (onze numéros).
Les Hommes sans Épaules est le nom d’une tribu dans le roman Le félin géant de J.-H. Rosny aîné, ainsi que le rappelle l’extrait du roman placé en quatrième de couverture, hommes que ne charge aucun fardeau, « hommes de la tête aux pieds, sans épaules mais entiers, c’est-à-dire avouant nos faiblesses et nos forces, [qui] célébrons encore le rêve, l’amitié de l’homme et de la nature ». Un historique très complet de la création et de l’évolution des Hommes sans Épaules est retracé par Christophe Dauphin à l’occasion des 70 ans de la revue, dans un Salut aux riverains de 2023 qui fait écho à l’Appel aux riverains de 1953, le manifeste des Hommes sans Épaules, dans lequel Jean Breton écrivait : « La poésie ne saurait se définir par sa mise en forme, puisqu’elle échappe à son propre moule pour se répandre et se communiquer. Elle est cette rumeur qui précède toute convention esthétique ; domptée, mise au pas ou libérée selon une technique personnelle à chaque poète, elle court sa chance, à ses risques et périls ; elle s’offre à la rencontre, au dialogue… Notre revue est un lieu de rencontres. Nous ouvrirons les portes, les laissant battantes, nous inviterons nos amis à s’expliquer sur ce qui leur paraît essentiel dans leur comportement d’être humain et de poète… ».
Ce numéro 55 des HSE est consacré aux poètes de l’Est de la France : Alsace, Lorraine et Vosges. Nous renvoyons le lecteur à la présentation qu’en fait Christophe Dauphin sur le site de la revue, à partir du voyage qu’il a réalisé dans ces régions durant l’été 2021. Il y détaille notamment le contexte alsacien, avec la longue occupation allemande (1871-1918), le tiraillement entre deux langues, le sentiment de dépossession d’une culture proprement alsacienne, ni française, ni allemande, ainsi que l’exprime le dessinateur Tomi Ungerer : « En Alsace, j’ai été élevé entre deux arrogances, allemande et française. Les Français et les Allemands sont pour moi des occupants. Psychologiquement, la France a commis sur mon pays un assassinat culturel difficile à pardonner, car il m’a coûté très cher. À l’école, c’était deux heures de retenue ou une baffe dans la gueule pour un mot d’alsacien… Avec les nazis on n’avait pas le droit de parler le français, et avec les Français on pouvait être puni pour un mot d’allemand ou d’alsacien... ». Contexte difficile pour les poètes que ce bilinguisme de fait, tant la langue dans laquelle est écrite le poème est constitutive de sa musique, qui touche autant à la forme qu’au fond. Les deux Porteurs de feu (poètes jugés majeurs du siècle écoulé, placés à la une de chaque numéro de la revue), sont pour ce numéro l’alsacien Jean Hans Arp, le célèbre peintre et sculpteur cofondateur du mouvement Dada, dont on sait moins qu’il fut aussi un grand poète, et le poète vosgiens Yvan Goll. Les deux hommes maitrisaient aussi bien le français que l’allemand, et ont écrit dans les deux langues. Citons le poème intitulé Tu étais claire et calme de Arp, pictural et lumineux, dans lequel il parle de sa compagne Sophie Taeuber, également peintre et sculptrice : « Tu étais claire et calme. / Près de toi la vie était douce. / Quand les nuages voulaient couvrir le ciel / tu les écartais de ton regard. // Tu regardais avec calme et soin. / Tu regardais soigneusement le monde, / la terre, / les coquilles au bord de la mer, / tes pinceaux, / tes couleurs. // Tu peignais le bouquet de la lumière / qui croissait, / s’élargissait, / s’épanouissait / sans cesse sur ton cœur clair. / Tu peignais la rose de douceur. / Tu peignais la source d’étoile. » De Goll, ce poème sombre, Ta lampe de deuil, extrait du recueil Traumkraut, traduit en français par sa femme Claire Goll (L’herbe du songe), écrit à l’hôpital de Strasbourg tandis qu’il luttait contre la leucémie, qui dit la souffrance de l’exil loin du pays natal (c’est en exil aux États-Unis, où il passe de nombreuses années, de 1939 à 1947, qu’il apprend en 1945 sa leucémie, dont il décèdera cinq ans plus tard) : « Ta lampe de deuil, bien-aimée / Brille vers moi à travers tous les lointains / Comme les yeux rougis des étoiles tourmentées // J'ai bu les timbales de vins fatals / Quand j'étais solitaire / Et exilé de ton vignoble // Pourquoi le soleil bruit-il plus doré / Quand je ferme les yeux / Et pourquoi ton sang bat-il en moi plus violemment // Si toi qui m'es ravie / Tu ne m'appelles plus qu'avec des bras de brume ? ».
Les auteurs recensés dans ce volume, comme dans tous les autres, font l’objet de notices biobibliographique particulièrement riches et soignées. Douze poètes alsaciens sont présents dans ce numéro 55. Outre Arp, on peut lire Maxime Alexandre, poète juif alsacien surréaliste communiste puis chrétien, Nathan Katz, poète dialectal méconnu, à tort, hors de sa région, le météore Jean-Paul de Dadelsen, Claude Vigée, Joseph Paul Schneider, Jean-Claude Walter, Roland Reutenauer, l’enfant terrible Jean-Paul Klée, Jacques Simonomis le poète du Cri d’os, le peintre-poète strasbourgeois Germain Roesz et Gérard Pfister, poète qui a aussi développé un impressionnant catalogue éditorial chez Arfuyen. Parmi les poètes lorrains et vosgiens, outre Yvan Goll, figurent dans ce numéro le symboliste Charles Guérin, notamment autour de sa passion pour l’Alsacienne Jeanne Bucher, appelée à devenir l’une des grandes figures de l’art moderne, Daniel Abel, très marqué par le surréalisme, Serge Basso de March, l’abbé Ernest de Gengenbach, Henri Thomas, proche d’Artaud et de Gide. La rubrique Une voix, une œuvre, proposée par Karel Hadek, est consacrée à Maxime Alexandre, né en 1899 et mort en 1976. C’est par l’intermédiaire d’Aragon, rencontré dans un café de Strasbourg, qu’il rejoint à Paris le groupe surréaliste autour d’André Breton, dont il fréquente les réunions jusqu’en 1932. Il pose dès 1927 la question d’un rapprochement avec le parti communiste, Aragon adhérant précisément la même année au parti, adhésion qui le conduira à une rupture officielle avec Breton et les surréalistes. Traumatisé par la guerre et l’holocauste, qui lui faire prendre conscience de sa judéité, Alexandre se convertit en 1949 au catholicisme sous le parrainage de Paul Claudel, conversion dont il reviendra, « étranger parmi les surréalistes, étranger parmi les communistes (et les athées), étranger parmi ses compatriotes, étranger parmi ses coreligionnaires… », éternel solitaire, tel le mendiant d’un poème extrait du recueil Le juif errant :
J’ai longé les routes sans dormir
J’ai offert mon visage aux nuits
Une branche verte m’a dit de pleurer
Le songe de l’eau m’a fait boire
C’est la soif de l’homme
Qui n’a pas de bornes
La soif de l’homme
Dans le sable des routes
C’est la faim de l’homme
Qui n’a pas de bornes
Comme l’aile de l’oiseau
Sous le vent des mers
J’ai gémi dans le sable rouge
J’ai parlé au sable du désert
Un souffle ardent m’a répondu
Le vent a soulevé le feu du ciel
[…]
C’est à Richard Rognet, poète vosgien resté toute sa vie attaché à sa terre, et Porteur de Feu des Hommes sans Épaules (n°33, 2012), qu’est consacré le dossier central sous la houlette de Paul Farellier, qui écrit notamment, concernant cette poésie : « Il en émane – dans ses registres opposés : d’un côté l’obscur, l’âpre et le voilé, et de l’autre, la douceur du regard, la clarté sensitive – quelque chose comme d’une âme souffrante et illuminée. L’unité de cette œuvre tient moins à la pure qualité formelle, jamais relâchée, de la chose écrite, qu’à la conjonction « astrale » qui s’y révèle d’un élan du vivre sous la fascination de la mort et d’un désir de se surmonter vers l’inaccessible ». Pour Christophe Dauphin, toujours à propos de Rognet : « Le poème se situe ici à la lisière du monde, du temps, du dehors et du dedans, du lointain et du proche, « là où la vie ne – distingue plus ce que tu vois dehors de ce qui – vibre en toi, comme le lieu parfait de ta naissance. » Là, ou le brin d’herbe incarne tout le cosmos, en équilibre sur la foudre, le poème et la tombe : Aujourd’hui, au déclin – de ma vie trop visible, - j’étrangle mon poème : - je veux voir l’intérieur, - les passagers confus – qui me frôlent, se taisent. Le poète ne soulève pas seulement le temps, il le secoue comme une nappe, faisant alors ruisseler, vallées, fleurs, enfance, et émotions toujours (rien n’est gratuit dans sa poésie) entre les herbes drues et les tendres, l’arbre et les pierres entre les doigts du jour ». Citons un extrait des cinq poèmes inédits de Richard Rognet présentés dans le dossier central, qui dit la présence caressante de la nature : « Pourtant, les oiseaux, devant ma porte battante, couvraient de chants subtils et vigoureux les roses défaillantes. Je croyais en eux, je pensais qu’ils m’éviteraient les menaces massues, les parfums altérés, les traces que laisse derrière elle une nuit de larmes. Je leur accordais, à la pointe de mes paroles, les mêmes vertus que celles que dispense un ciel subrepticement dégagé, je les voyais comme l’étrave d’un vent réconfortant préparant le passage d’une joie franche, à hauteur d’homme – ô les abris rêvés sous d’inimitables voix ! et ces baisers qui traversent l’obscurité comme une eau dévalant les montagnes en grésillant sur les pierres ! / Revenons aux oiseaux, à la place qu’ils ont partagée avec celle des branches où murmure, longtemps après leur envol, la paix d’un matin propice aux interrogations du réveil ou celle, non moins pénétrante, d’un soir qui bouge à peine devant les filets de la nuit ».
César Birène consacre une rubrique intitulée Satan, la poésie, à Ernest de Gengenbach, qui alors qu’il était au séminaire pour devenir prêtre, a connu une expérience amoureuse avec une comédienne. Dénoncé et chassé du séminaire, le jeune homme, très perturbé, a la révélation du surréalisme et rencontre Breton, qui publie de lui une lettre dans La révolution surréaliste d’octobre 1925, lettre où Gengenbach écrit notamment : « J’ai trop subi l’empreinte sacerdotale pour pouvoir être heureux dans le monde… Je tombai dans la neurasthénie aiguë et la dépression mélancolique et devins nihiliste, ayant complètement perdu la foi, mais restant néanmoins attaché à la douce figure du Christ si pure, et si indulgente. J’ai maudit tous ceux qui, prêtres, moines, évêques, ont brisé mon avenir parce que j’étais obsédé par la femme, et qu’un prêtre ne doit pas penser à la femme. Race de misogynes, de sépulcres blanchis, squelettes déambulants !... Ah ! si le Christ revenait ! ». Breton rompra plus tard avec le personnage, qui se déclarera « surréaliste sataniste », et mènera une vie marquée au sceau d’une schizophrénie tous azimuths, « sans cesse écartelé entre vie mondaine et vie mystique, christianisme et surréalisme, religieux et profane, Dieu et Diable, chair et mysticisme, péchés et repentirs, hystérie et duperie, liaisons sulfureuses et saintes femmes », qui le conduira à de fréquents séjours en hôpital psychiatrique sur la fin de sa vie. Des poèmes du recueil Satan à Paris, publié en 1927, sont proposés, dont voici un extrait significatif : « Figures de pénombre / en frou-frou de surplis / tes prêtres fureteurs aux écoutes de buanderie / sont aux aguets derrière la grille / du confessionnal / pour absoudre les cochonneries / de l’homme triste animal / après le coït. / Embusqués dans le tribunal guérite / ils se tortillent comme des chenilles / à l’audition des épopées paroissiales ! ».
Les pages libres des HSE présentent quelques poèmes de René Char, Jean Breton et des membres du comité de rédaction de la revue. Puis vient la rubrique Avec la moelle des arbres consacrée aux notes de lecture, rédigées ici par Odile Cohen-Abbas, André-Louis Aliamet et Christophe Dauphin. Le numéro se clôt avec quelques informations relatives à la vie de la revue et des poètes qui l’animent : un recueil de Odile Cohen-Abbas publié par les HSE (La Face proscrite) ; la disparition du poète et romancier chilien Luis Mizon, qui dit notamment de la poésie : « Ce qui est propre à la poésie, c’est de donner matière à l’invisible, d’incarner l’âme étrangère du langage, de se laisser habiter dans la lecture par l’âme d’autrui » ; un hommage à deux poétesses récemment disparues, l’ardéchoise et militante féministe Alice Colanis, proche de Gisèle Halimi et de Simone de Beauvoir, et Jacquette Reboul, qui disait de ses livres de poésie : « je renais de chaque livre, plus riche de ce voyage intérieur, de ce long fil de mots déroulés du profond de moi-même. La souffrance de l’écriture est oubliée. Ne restent que la plénitude de son accomplissement et, jaillie du silence originel, la parole de cristal » ; la libération du poète palestinien Ashraf Fayad, emprisonné depuis plus de huit ans en Arabie Saoudite ; un compte rendu de la présence des HSE au salon de la revue 2022 ; un texte s’opposant à la démolition de la maison de Paul Éluard dans le Val d’Oise. Un contenu très riche, pour une revue à la vocation encyclopédique à n’en pas douter parmi les plus intéressantes dans le paysage poétique français d’aujourd’hui.
L'abonnement annuel (deux numéros) se fait à l'adresse suivante : Les Hommes sans Épaules éditions, 8, rue Charles Moiroud, 95440 Ecouen, France. Ce, par chèque d'un montant de 30 € (Soutien 50 €) à l’ordre de Les Hommes sans Épaules éditions, après avoir renseigné le bon de commande, à télécharger et imprimer.
Éric Chassefière (in francopolis.net, mai, juin 2023)
*
Ce numéro de la revue Les Hommes sans Épaules, qui ne compte pas moins de 346 pages, ressemble plus à une monographie qu’à un numéro de revue. la thématique principale tourne autour de Richard Rognet et des poètes de l’Est, de l’Alsace et de la Lorraine.
Christophe Dauphin nous fait découvrir Jean Hans Arp, le sculpteur, mais aussi le peintre-poète qui a recours à l’écriture automatique : « C’est dans le rêve que j’ai appris à écrire et c’est bien plus tard que j’ai appris à lire… - Sous les redents des falaises – et sur l’hermine des plages – Papillonnaient tes gants de corolle – Ton chapeau de nuage – ton ombre d’ailes blanches. »
Autre grande voix de la poésie contemporaine : Claude Vigée, pour lequel la poésie sera celle de l’exil. Ainsi en témoigne cet extrait : « Les choses continuent : mais dans l’œil des maisons – que nous hantent partout des têtes inconnues – Nos lèvres sans écho sont deux ailes sauvages – Qui voudraient s’envoler lointaines dans l’espace. »
Et puis Jacques Simonomis fut aussi l’un de ces poètes de l’Est. C’était un colosse à l’écriture incisive : « Prends la route – engrosse-la – Des terres attendent – Serrées dans te poches – rapetassées d’étoiles filantes – d’éclisses de soleil. »
Richard Rognet est également à l’honneur dans ce numéro. Sa poésie est empreinte de solitude intérieure. Il s’agit d’une poésie de l’abîme. L’auteur a essayé de dompter ses démons intérieurs : « vivre… - dans la sombre – matière du silence – que dis-je du -silence – vivre de – l’abîme en soi. » le poète a reçu en 2002 le grand prix de poésie de la Société des Gens de Lettres. Six poèmes inédits ont été publiés dans cette livraison. Parmi ceux-ci, voici un extrait : « Pourtant les oiseaux, devant ma porte battante, couvraient de chants subtils et vigoureux les roses défaillantes. Je croyais en eux, je pensais qu’ils m’éviteraient les menaces massues, les parfums altérés, els traces que laisse derrière elle, une nuit de larmes. »
Marie-Laure ANDRE-BOURGUET (in revue Poésie sur Seine, septembre 2023).
*
Les numéros de la revue semestrielle Les Hommes sans Épaules pourraient aisément composer une encyclopédie de la poésie contemporaine du monde entier. Quand Christophe Dauphin s’intéresse à la poésie d’un continent, d’un pays, d’une région ou d’une culture particulière, il l’étudie à fond et avec passion, faisant appel à ses meilleurs connaisseurs.
Cette livraison est consacrée aux « Poètes de l’Est », autour de l’Alsace, de la lorraine et des Vosges, « trop méconnus comme la riche culture et al souvent terrible histoire de ces terres ».
Le sommaire est si foisonnant qu’il est impossible de tout mentionner. Des douze poètes dont il a particulièrement étudie le parcours et l’œuvre, outre le discret Richard Rognet à qui Paul Farellier consacre un important dossier, citons le peintre-poète-sculpteur Jean Hans Arp, Yvan Goll ( dont on se souvient aujourd’hui grâce au prix de poésie à son nom), Henri Thomas, bien connu en Bretagne, Jacques Simonomis, le poète animateur de la revue Le Cri d’os, Claude Vigée, à l’œuvre universelle, les toujours parmi nous et actifs Roland Reutenauer, fidèle aux éditions Rougerie, l’insurgé Jean-Paul Klée, le surréaliste Daniel Abel (que j’ai découvert dans les revues IHV et Hôtel Ouistiti), Gérard Pfister, fondateur et responsable des éditions Arfuyen, Germain Roesz, également peintre et créateur des éditions Lieux-Dits.
Marie-Josée CHRISTIEN (in revue Spered Gouez n°29, octobre 2023).
*
De numéro en numéro, la revue Les Hommes sans Épaules voyage la France (en alternance avec le monde dans d’autres numéros). Donc, après la Normandie du n°52, voici l’Est (disons pas le Grand-Est, je sais que ça en défrise pas mal) : l’Alsace et les Vosges, la Lorraine, sont dans le numéro 55.
On y retrouve toutes les célébrités « mortes » (que vous avez déjà bien lues) : Jean Hans Arp, Claire Goll, Yvan Goll, Henri Thomas, Claude Vigée, J.-P. de Dadelsen… les célébrités inconnues : Nathan Katz, et les célébrités vivantes : le discret Joseph-Paul Schneider : Je retourne à ma forêt – A mes arbres, à mes mots – A cette plume qui est la serpe – J’élague – Ligne après ligne – Aube après aube – L’arbre du poème… Jean-Claude Walter (ce livre connu (de moi, pardon !) Le sismographe appliqué) : On vous plante un arbre dans le cœur, en avant marche, le temps est venu, le temps de quoi, peu importe, l’essentiel est d’avancer… Roland Reutenauer, le tonitruant Jean-Paul Klée : jusqu’au silence des radios – écrasé de bonheur sous la lampe – je relis l’analyse de vigée – en pensant à toi – à ton sexe – inconnu… Germain Roesz (que l’on connaît mieux comme éditeur, Les Lieux-Dits) : dans la grisaille perlée – grelots de nuits empierrées – les galets charrient – la vase blanchâtre – aux écumes disjointes – Les ombres traversent l’eau – Le fleuve est sombre – dans le débris des bombes – un enfant court – de ruine en ruine – Un cyan – fréon rusé…
En vrai, le grand invité du numéro EST, c’est Richard Rognet (nombreux livres chez Gallimard) : un dossier critique de Paul Farellier. De livre en livre, l’œuvre de Richard Rognet est une longue missive ininterrompue qui traverse le temps. De Rognet on lit aussi six poèmes inédits, D’Un bout à l’autre du monde : Pourtant les oiseaux, devant ma porte battante, couvraient de chants subtils et vigoureux les roses défaillantes. Je croyais en eux… - … Je leur accordais, à la pointe de mes paroles, les mêmes vertus que celles que dispense un ciel subrepticement dégagé… On reconnait sa souplesse quasi classique. Plein d’autres trucs dans ce numéro 55. Pensez, 350 pages !!!
Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°195, décembre 2023).
|
|

|
|
Lectures :
Les Hommes sans Épaules ont 70 ans et c’est exceptionnel. Rares sont les revues de poésie d’une telle longévité. Christophe Dauphin fête cet anniversaire par un éditorial-manifeste émotiviste dans lequel nous percevons un rapport non-dualiste à ce qui se présente :
« Si l’émotivisme dont nous nous réclamons, n’est pas sensiblerie, il n’est pas pour autant culte de l’émotion. La prise qu’a le moi sur les émotions n’est jamais complète et elle réclame justement un lâcher-prise par lequel les tensions puissent se résoudre. L’émotion qui est l’équation du rêve et de la réalité, parce qu’elle jaillit brutalement, comme une réaction devant l’irritation d’une blessure, met le sujet hors de soi. « Je est un autre », « Je est tous les autres » !
Il y a là davantage qu’une intuition, il y a un chemin, une quête intransigeante, par la poésie.
« L’émotivisme est une attitude devant la vie, une conception du vivre qui ne saurait être détachée de l’existence du poète, car la création est un mouvement de l’intérieur à l’extérieur et non pas de l’extérieur sur la façade. L’émotivisme est un art de vivre et de penser en poésie, car une œuvre est nulle si elle n’est qu’un divertissement et si elle ne joue pas, pour celui qui la met en question, un rôle prépondérant dans la vie. »
Le dossier de ce numéro 56 est consacré à Yusef Komunyakaa & les poètes de la guerre du Vietnam. Yusef Komunyakaa, (James William Brown Junior) naît en 1947 à Bogalusa en Louisiane. Confronté au racisme systémique du Sud des USA, il s’implique dans le mouvement de lutte pour les droits civiques. Christophe Dauphin retrace ces années de lutte qui plongent aussi dans les horreurs de la guerre du Vietnam, inscrites par les larmes et le sang dans sa poésie : « Profondément ancrée dans son temps et dans la vie sans le moindre trompe-l’œil, dit-il, la poésie de Yusef Komunyakaa puise sa force dans le vécu même, les révoltes et les racines du poète. Les images sont celles du Sud et de sa culture, de Noirs vivant dans un monde blanc, de la guerre en Asie du Sud, du quotidien, des villes, des pulsations du blues et du jazz. Le langage est aérien, les vers sont courts et visent juste comme des flèches tirées de l’arc des entrailles. »
La Limite (extrait)
Quand les fusils se font silencieux pendant une heure
ou deux, vous pouvez entendre les pleurs
des femmes faisant l’amour aux soldats.
Elles ont une mémoire sans pitié
& savent comment porter des robes claires
pour conduire une foule, conversant
avec un peloton d’ombres
engourdies par la morphine. Leurs vrais sentiments
les font briser comme avril
et ses rouges fleurissements.
Reddition de la jungle (extrait)
d’après la peinture de Dan Cooper
Les fantômes partagent avec nous le passé & le futur
mais chacun nous luttons pour retenir notre souffle.
Allant vers ce qui attend derrière les arbres,
le prisonnier s’enfonce plus loin en lui-même, à distance
de la façon dont le cœur d’un homme le divise, plus loin
dans le mystère indigo de la jungle & la beauté,
avec ses deux mains levées dans les airs, se rendant
qu’à moitié : le petit homme à l’intérieur
attend comme une photo dans une poche déchirée, refusant
de lever ses mains, silencieux & intransigeant
tandis que le chien noir éclaireur est à ses côtés.
Amour & haine
étoffent le vrai homme, comme il lutte
dans l’hallucination des bleus
& pourpres foncés qui mettent le jour en feu.
Il somnambule dans un labyrinthe de violettes,
mesurant ses pas d’un arbre à l’autre, sachant que nous sommes tous en quelque sorte connectés.
Qu’ai-je pu dire ?
Nous découvrons dans ce numéro, à la suite de Yusef Komunyakaa, de nombreux auteurs et poètes vietnamiens qui, mieux que les historiens, disent le réel de la guerre : « Liberté est un mot vietnamien ! »
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 20 octobre 2023)
*
"Une chamionne du monde de la poésie, telle est la revue Les Hommes sans Epaules, dans laquelle Christophe Dauphin, dans son éditorial-manifeste émotiviste du n°56, donne un texte étonnament documenté dans lequel on a envie de pénétrer pour mieux apprécier la portée de ce chemin majeur de la poésie actuelle auquel je souscris de toute ma force d'éditeur de revue, qui montre mon attachement à ce genre majeur. Tous émotivistes, un mot d'ordre et de plaisir nécessaires.
Jean-Pierre LESIEUR (in revue Comme en poésie n°96, dcembre 2023).
*
« Tout poème est politique. Même le plus innocent ou le plus bête. C’est le crédo de la revue Les Hommes sans Épaules et de son animateur Christophe Dauphin. En voilà un sacré et infatigable arpenteur. Rien ne lui est étranger de l’histoire-géo, petite ou grande, de la poésie. Dans cette revue, les poèmes ne sont pas balancés comme ça, mais toujours accompagnés d’une présentation (parfois fouillée) des auteurs. Bon ! Le cœur du n°56, c’est le Vietnam dont Christophe Dauphin « raconte » l’histoire complexe, à laquelle se mêle celle de de français et d’américains venus y vivre ou y mourir. La langue vietnamienne est « monosyllabique, mais polyphone… ce qui donne au vers une grande concision et une riche musicalité » écrit Chê Lan Viên. La révolution, les guerres coloniales menées par la France et par les USA ont beaucoup nourri les poèmes vietnamiens du 20èmesiècle : « Je suis allé tout droit – Au cimetière des avions pirates américains / Une horde de cadavres, affalés, estropiés – écrabouillés… tous ces démons américains… » : Ngô Xuân Diêu ; ou d’Hô Chi Minh, lui-même : « Sous le choc du pilon souffre le grain de riz – Mais l’épreuve passée, admirez sa blancheur – Pareils sont les humains dans le siècle où l’on vit – Pour être homme, il faut subir le pilon du malheur ». D’autres poèmes disent la vie ordinaire : « Nous tressons l’épervier – avec des fils de soie jaune serrés – nous tressons la senne – avec du lin blanc… » : Anh Tho, seule femme de ce dossier avec Madeleine Riffaud, résistante lors de la guerre 39-45, activiste de la décolonisation : « Bouteilles vertes et fronts morts – Ont mêmes gestes, même lit ». Les soldats américains ont mêmes gestes, même lit ». Les soldats américains ont eux-mêmes beaucoup écrit « leur » guerre du Vietnam. Dans ce n°56, l’Afro-Etatsunien, Yusef Komunyakaa : « Mon visage noir s’efface – se dissimulant derrière le granit noir… Je descends les 58.022 noms – attendant à moitié de trouver – le mien en lettre parmi la fumée – Je touche le nom d’Andrew Johnson – je vois le flash blanc de l’objet piégé… » Mais aussi dans ce n°, les surréalistes Gérard Legrand, Guy Cabanel (présentés par Christophe Dauphin) et des créations d’aujourd’hui : Eric Chassefière, laurent Thinès, Sadou Czapka : « Le mur est une limite – et nous sommes des animaux aveugles… » et André-Louis Aliamet : « Papillon dans l’encre incertaine – toi qui n’habites aucun corps – pas même l’eau qui vole – en portant tous les souffles… » Proses et nombreuses lectures critiques. »
Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°196, mars 2024).
|
|
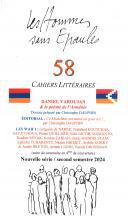
|
|
Lectures :
Les Hommes sans Épaules, numéro 58 : Daniel Varoujan. Quand on reçoit un numéro des HSE, plus que pour bien des revues, il faut se précipiter sur l’éditorial de Christophe Dauphin. Il donne le ton et l’esprit aux cahiers qui suivent en dessinant un pays où s’entrelacent le mémoriel, l’histoire, le politique, les coups de gueule et les bourrades chaleureuses. Un peu comme un marin qui après un long périple revient au bar du pays et vous parle de « là-bas ».
Celui du numéro 58 est parmi les plus émouvants que j’ai lus. Il dit s’inspirer d’un manuscrit inédit (j’espère pas trop longtemps) qui nous fait partir de son village natal où prit racine sa relation avec l’Arménie par l’intermédiaire d’un ami, Raphaël Thorossov, mort en 1998, à 101 ans : « Du fond de mon enfance, je te revois Raphaël. Tu déambulais dans le village coiffé de ta légendaire toque noir et vêtu de ton manteau en astrakan […] Tu me parlais, de là-bas… Ce pays que tu avais quitté, non sans avoir emporté dans un bocal de généreux grammes de terre. “Elle partira avec moi” me disais-tu. ».
Des noms surgissent, connus ou méconnus (j’y apprends les racines arméniennes de Paul Farellier, ce qu’ami aveugle je n’avais pas relevées), des rencontres, des titres de recueils, des pages d’histoire arménienne, avec ses crimes, pillages, massacres d’hommes, femmes et enfants jusqu’à ce « génocide de 1915 », et qui fut suivi de deux guerres récentes, puis encore celle de 2020… Et pourtant le pays dont il nous parle brille d’une lumière inégalable, avec ses jardins, son architecture, sa musique car ce pays est d’abord celui apparu par un lien d’amitié : « Que d’histoire de sang et de liens fraternels avec l’Arménie dans le mouchoir de nuages de notre bourg haut-normand ! »
Après cet édito, le cahier Ainsi furent les Wah I ouvre ses pages aux auteurs ayant mentionné l’Arménie durant cette période, dont Quillard, Max Jacob, Hikmet, Mandelstam et Grossman avec son inoubliable carnet de voyage, Que la paix soit avec vous. S’y joignent des poètes arméniens, dont le plus ancien, dont on garde trace s’appelle Grégoire de Narek (940‑1000), avec ce poème « Toi qui prends soin des âmes », Siamanto, Lubin, pour donner des noms que je connais un peu. C’est une nouvelle occasion de signaler la qualité des notices biographiques de la revue qui en fait un incontournable de toute bibliothèque résolue et ambitieuse.
Quelques vers arméniens résonnent encore à mon oreille : « Nous voici, nous arrivons, nous sommes la malédiction / La lance rusée enfoncée dans l’obscurité » (Sévak). « Notre génération a plus d’amis dans l’autre monde que celui-ci » (Kostan Zarian). Je fais connaissance avec ce poème d’Armen Lubin « N’ayant plus de maison ni logis / Plus de chambre où me mettre / Je me suis fabriqué une fenêtre / Sans rien autour. »
Ensuite s’ouvre le dossier sur Daniel Varoujan qui tisse à maille serrée la biographie du poète et la tragédie du génocide durant laquelle le poète avec trois compagnons fut attaché à un arbre et lardé à mort de coups de couteau. En regard de ces pages si douloureuses représentées par l’emblématique poème « Terre rouge », me frappe cette vague de grands poèmes épiques et fraternels qui compte (au moins) Varoujan, Hikmet. Ils nous racontent l’histoire de héros éponymes de leur pays, chantent leur peuple et leurs paysages, visant ainsi, comme l’écrit Dauphin en parlant de Varoujan, à réconcilier « le mythe héroïque et le réel ».
Suit le cahier Ainsi furent les Wah II où je découvre deux poèmes de Manouchian (j’ignorai qu’il était poète) dont ces quatre vers : « J’ai pris la sinueuse allée du village ; / — Mon soleil sur les épaules comme un abricot, / À mes lèvres tremblantes un vieux chant de laboureur -, Je pars livrer mon cœur au cœur des montagnes. » C’est beau comme du Whitman.
D’autres auteurs se succèdent. Les lisant, je ne fais plus la distinction entre les poètes arméniens ou autres, les biographies s’entremêlent, avec, omniprésentes, les pages sombres de l’histoire universelle du XXe siècle, que pourtant traversent de nouveaux poèmes, telles un Nil aux eaux félines traversant les sables du désert. Quelques noms et vers lus et médités : Verdet et son Anthologie des poèmes de Buchenwald, Mélik, Bonnefoy évoquant l’Arménie et nous confiant cette définition de la poésie : « C’est tenter de rendre aux mots la pleine mémoire de ce qu’ils nomment » ; Sévak, Kertész et encore Buchenwald ; puis de grandes et belles pages sur le poète et traducteur Godel ; l’article sur la géopoésie de Chaliand, arpenteur du monde et de ses luttes qui nous dépose un conseil de vie : « Il faut conserver son esprit critique, ne jamais se laisser duper par notre propre propagande, et faire preuve de détermination, toujours… ». Je m’attarde, distrait sur ses vers biographiques : « J’ai fait plus de quinze métiers / au gré des pays et du vent / Je gravis le toit du ciel / avec ma chevelure de nuage / et mon cœur coule par la nuit des villes » ; Mahmoud Darwich apparaît en nous offrant trois poèmes de pleine humanité : « Dépose ici et maintenant la tombe que tu portes / et donne à ta vie une autre chance / de restaurer le récit » ; ou encore Gérard Mordillat, dont j’ignorais le versant poétique de son œuvre ; Akopian, poète engagé pendant quarante ans auprès du Secours populaire ; l’étonnante Krikorian, « l’arménienne de Téhéran » ; le poète Rugamba et, avec lui, le génocide des Tutsi, et ce texte « Kaddish pour l’Afrique » ; puis des poètes plus proches, des amis ou des poètes à rencontrer : Caroutch, Brissiaud, Dauphin lui-même, Tison, le neurochirurgien et poète de Besançon Laurent Thinès, Tavera, Marie Bouchez (« Les toits vaguent sur notre âme / Mais c’est sur nos mémoires que le soleil se couche »), etc.
Et pour finir, avant le généreux cahier de recension, une dernière figure vient nous saluer : Kamel Bencheikh, et avec lui, la « décennie noire » de l’Algérie que surmonte une poésie invaincue (« je n’existe plus que pour la mémoire lapidée qui m’assaille ») Un numéro des HSE à vivre comme une prière universelle de la poésie.
Pierrick DE CHERMONT (cf. Revue des revues, in recoursaupoeme.fr, 6 mars 2025).
*
Les Hommes sans Épaules sont des cahiers littéraires semestriels fondés par le poète Jean Breton en 1953. Le nom de la revue provient du roman préhistorique de J.-H. Rosny aîné, Le Félin géant (1918). Cet opus n° 58 présente un dossier sur « Daniel Varoujan et le poème de l’Arménie », préparé par Christophe Dauphin, qui dirige un comité de rédaction de cinq personnes.
C’est par la rencontre avec Raphaël Thorossov, son vieil ami, que Christophe Dauphin, citoyen de la république d’Artsakh (il possède un passeport depuis 1991) est devenu arménophile. Raphaël a été l’ami de Siamanto et Missak Manouchian.
Par le biais de la poésie et ses poètes, l’ouvrage évoque le Génocide des Arméniens, ceux des Grecs pon[1]tiques et des Assyro-Chaldéens. C’est ainsi que l’on peut lire Grégoire de Narek, Nahabed Koutchak, Sayat Nova, Siamanto, Rouben Sévak, Kostan Zarian, Eghiché Tcharents, Armen Lubin, Vahé Godel (traducteur de la plupart des poèmes), Parouïr Sévak et Violette Krikorian.
Une longue biographie précède quelques poèmes de Daniel Varoujan (“J’ai là, sur ma table, dans une coupe, un peu de terre d’Arménie. L’ami qui m’en a fait cadeau croyait m’offrir son cœur – bien loin de se douter qu’il me donnait en même temps celui de ses aïeux”).
Sont évoqués également Gérard Chaliand et Charles Akopian. Quant aux arménophiles, on trouve Pierre Quillard, cheville ouvrière du journal Pro Armenia. « Les Alliés sont en Arménie », est un long poème de Max Jacob, publié en 1916. Nazim Hikmet, Yves Bonnefoy, Ossip Mandelstam, Vassili Grossman, abordent eux aussi la tragédie arménienne.
Au fil des pages, on trouve des illustrations de Léon Tutundjian, Arshile Gorky, David Erevantsi, Ervand Kotchar…
Un livre riche qui foisonne d’informations, fait office parfois de livre d’histoire et fournit, outre les titres d’ouvrages des écrivains, d’autres titres pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances.
Zmrouthe AUBOZIAN (in France Arménie n°528, avril 2025).
*
Les Hommes sans Épaules consacrent ce numéro 58 à Daniel Varoujan & le poème de l’Arménie. Au cœur de ce numéro nous trouvons le génocide des Arméniens au siècle dernier, qui n’est toujours pas reconnu par nombre d’Etats, mais aussi d’autres drames, d’autres grandeurs.
Partant de son village natal et d’une expérience personnelle, Christophe Dauphin retrace le parcours de ce peuple Arménien, combattant de la liberté et victime tant de l’indifférence que des dérives autoritaires.
Nous découvrons des poètes exceptionnels, des êtres engagés, des écrits inattendus et révélateurs qui nous parlent non seulement de l’Arménie, de ses épreuves, de ses richesses, mais de la nature humaine dans ses horreurs, ses tristes banalités comme dans ses expressions les plus sublimes. C’est toute la culture et la spiritualité arménienne en ses multiples prolongements qui s’inscrit dans les mots de ces poètes, tous survivants, tous exilés, sauf peut-être d’eux-mêmes. Ce n’est pas seulement une poésie de l’exil ou de la tragédie, ou des tragédies avant la tragédie, nous y découvrons un sens aigu du politique, une sagesse, une métaphysique, un plan pour le futur.
Extrait de Terre Rouge :
J’ai là, sur ma table, dans une coupe,
un peu de terre d’Arménie.
L’ami qui m’en a fait cadeau croyait
m’offrir son cœur – bien loin de se douter
qu’il me donnait en même temps celui
de ses aïeux.
Je n’en puis détacher mes yeux –
– comme s’ils y prenaient racine…
Terre rouge. Je m’interroge :
d’où tient-elle cette rougeur ?
Mais s’abreuvant tout ensemble de vie
et de soleil, épongeant toutes les blessures,
pouvait-elle ne pas rougir ?
Couleur de sang me dis-je,
terre rouge, bien sûr, car elle est arménienne !
peut-être y frémissent encore des vestiges
de brasiers millénaires,
les fulgurances des sabots
qui naguère couvrirent d’ardente poussière
les armées d’Arménie…
Y subsiste peut-être un peu de la semence
qui me donna la vie, un reflet de l’aurore
à laquelle je dois ce regard sombre,
ce cœur qui hante un feu surgi
des sources même de l’Euphrate
ce cœur couvrant l’amour non moins que la révolte…
Ce numéro 58 est particulièrement important, il nous entraîne au cœur de l’âme arménienne mais il retrace aussi l’histoire d’un peuple qui nous définit tous.
Rémi BOYER (in lettreducrocodile.over-blog.net, 29 octobre 2024).
*
On ne peut qu’être admiratif devant la prodigieuse puissance de travail de Christophe Dauphin ainsi que par sa parfaite connaissance des poésies du monde entier. Le focus est ici placé sur l’Arménie grâce à des documents et des écrits poétiques rares et très émouvants. Avec 324 pages de lectures enrichissantes, les HSE s’affirment encore un peu plus dans le vivier de la poésie actuelle.
Georges CATHALO (in terreaciel.net, janvier 2025).
*
« On croit « tout » savoir à propos des horreurs qui ont fait le XXe siècle, mais à chaque fois on en découvre de plus affreuses encore. C’est ce qui nous arrive en lisant le n°58 de Les Hommes sans Épaules consacré à l’Arménie.
Ici, je ne vais vous parler que des poètes qui composent ce numéro (piloté par Christophe Dauphin qui présente chaque auteur en détail), des poètes des premiers âges : Grégoire de Narek (vers l’an mille) : « Toi qui prends soin des âmes / souffrantes, mutilés / à présent je T’implore / me voici gémissant // Veille à ne pas accroître ma souffrance… » Nahabed Koutchak (16èmesiècle), Sayat-Nova (18èmesiècle), aux poètes du 20èmesiècle, dont le plus remarquable à mes yeux est Armen Lubin (1903-1973) : « Ça sent l’aubergine et le piment farci / Ça sent la cuisine orientale et le phono turc / Sur le palier une petite main mendie… / … Dans cet hôtel plein d’Arméniens sortis on ne sait d’où / D’Arméniens sortis… mettons des massacres // Monta d’abord le socialiste baron Kissikian / tourneur chez Citroën… »
Il y a bien sûr Missak Manouchian « Tourmenté comme le forçat, persécuté comme l’esclave – J’ai grandi sous le fouet du mépris et de la privation /A me battre contre la mort, aspirant à la vie / J’ai été attentif à chaque enchantement » et Daniel Varoujan (un fort dossier) : « J’ai sur ma table dans une coupe / un peu de terre d’Arménie… »
D’autres poètes présents dans ce numéro sont des amis du peuple arménien (Max Jacob, Yves Bonnefoy) ou les enfants, nés en Europe de l’Ouest, d’exilés arméniens : Vahé Godel, Gérard Chaliand : « Et nous avons fatigué le désert de nos pas / portés par l’espoir de la mer / La terre, taureau funèbre dont le souffle desséchait nos corps / longue retraite / où nous n’avons rêvé que de retour natal… »
Et encore Francesca Yvonne Caroutch : « Le ciel est plein de mains coupées / et els fossiles du sommeil / oscillent sur des socles d’ombre… / … Tu cries comme une graine folle / oubliée dans un fau d’argile » ; et la relève virulente de la poésie arménienne, Violette Krikorian (née en 1960), « Prière de femme », : Donne-moi aujourd’hui ma beauté quotidienne / délivre mes yeux des travaux / d’aiguille et des lunettes / délivre ma langue de ma bouche / délivre ma bouche de la langue de bois / délivre mes mains, mes jambes, tout mon corps… » Encore plein de trucs dans ce numéro. »
Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°200, mars 2025).
|
|
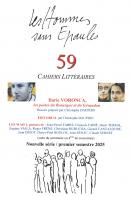
|
|
Lectures :
Christophe Dauphin a une longue histoire avec Ilarie Voronca, poète roumain né dans une famille juive non pratiquante, mort par suicide en 1946 à l’âge de 42 ans. Ce dernier appartient à « cette catégorie rare et précieuse » dont l’œuvre accompagne toute la vie. Christophe Dauphin, avec l’appui indéfectible de la revue LHSE et de quelques personnalités, œuvre courageusement depuis les années 90 pour faire connaître le poète alors ignoré et oublié dans son pays d’adoption comme dans son pays d’origine.
Rappelons son essai Ilarie Voronca, le poète intégral (Rafael de Surtis, 2011) et son action pour sauver sa tombe en 2010.
Christophe Dauphin lui consacre ici son éditorial et le dossier principal du numéro, lui associant les poètes du Rouergue et du Gévaudan. A l’instar de ses compatriotes et amis, Tristan Tzara et Benjamin Fondane, Voronca, alors reconnu comme « un phare du constructivisme roumain », s’installa à Paris en 1933 mais, en danger du fait de ses origines juives et de ses écrits, il rejoignit Rodez en 1943. Ce fut une période importante de sa vie, car il a fait partie du maquis le plus important de l’Aveyron.
Le numéro publie aussi des poètes du Rouergue de la génération de Voronca, dont Jean Sénac et Claude Sernet, ainsi que Antonin Artaud et Paul Eluard qui y ont été soignés, puis une série de poètes contemporains tels Marie-Claire Bancquart, Bernard Noël, Marcel Chinonis, François Laur, Monique Labidoire, Francis Combes et Bernard Fournier.
Le numéro se clôt sur un appel au soutien à l’écrivain Boulam Sansal, arrêté à Alger en novembre 2024 et « toujours emprisonné dans les geôles d’un régime corrompu ».
Marie Josée CHRISTIEN (in revue Spered Gouez n°31, 2025).
*
Les Hommes sans Épaules consacrent ce numéro 59 à Ilarie Voronca & les poètes du Rouergue et du Gévaudan.
Eduard Marcus, devenu Ilarie Voronca (1903-1946), méritait ce numéro, lui qui reste encore méconnu malgré un talent et une œuvre qui continuent de fasciner. Franco-roumain, il est frappé d’oubli aussi bien en Roumanie qu’en France. Il fut l’un des piliers des avant-gardes roumaines, détruites par les dictatures successives, qui trouvèrent en partie refuge en France. Christophe Dauphin raconte cette histoire complexe, encore douloureuse, et finalement toujours largement incomprise.
Réfugié, juif et antifasciste, Voronca fut sa vie durant sujet à des traques, des exclusions ou des indifférences marquées. Il fut un grand solitaire malgré son épouse, Colomba Spirt, intellectuelle, non-conformiste, égérie des peintres et poètes de Bucarest, et un autre amour, Rovena. Les joies ne font que masquer temporairement une détresse essentielle.
Pendant l’occupation nazie, il trouve refuge à Rodez et en Aveyron où, heureusement, il rencontra de vrais compagnons de route.
Son œuvre, poésie et prose, est vaste et pleine d’intensités à la hauteur de l’errance.
Le dossier très fourni établi par Christophe Dauphin permet d’approcher certains aspects d’un être qui demeure insaisissable et d’une œuvre bouleversante, habitée par la mort.
L’attendue
Il y a des pierres ici, des arbres et des herbes
Qui veulent te connaître et attendent tes mains
Il y a le satin de la mer qui attend ton corps
Pour en épouser le rayonnement et les contours.
Ton nom qui a fleuri l’univers de la chambre
Les flûtes des saisons qui attendent tes lèvres
Toute la création espère en ta venue
Car sans toi, tout est privé d’éclat.
C’est pour toi que les oiseaux chantent
Et la nuit met sa robe de velours pour ton souffle
C’est pour toi que les fleurs assemblent leurs couleurs
Car ton regard est leur plus glorieux parfum.
Tu te meus en silence et pareille aux nuages
Ne montrant que ton ombre sur les violons de l’eau
Parmi les choses dont la mémoire dessine
Ta place nettement entre les murs éteints.
Insaisissable, si je passe entre tes voiles
N’est-ce pas pour chanter ta tristesse partout
Ce désir violent qui t’amène vivante
Les doigts parés de tous les feux du souvenir.
Ce superbe numéro des HSE permettra sans doute à certains de découvrir un poète d’exception, et rendre un peu plus dense le « fantôme ».
Rémi BOYER (in lettreducrocodile.over-blog.net, 11 avril 2025).
*
|
|
|