|
Tri par numéro de revue
|
Tri par date
|
Page : <1 2 3 4 5 6 7 8 >
|

|
|
Lectures critiques :
Le numéro 51 débute par une triste nouvelle, « La disparition d’Elodia Turki, notre Femme sans Épaules et de cœur ». Nous avons déjà évoqué le talent et l’œuvre d’Elodia Turki dans La Lettre du Crocodile. Voici quelques mots extraits du bel hommage de l’équipe des HSE à Elodia : « L’œuvre d’Elodia est un inlassable chant d’amour aérien, dont certaines pièces n’auraient sans doute pas été renié par Hâfez, le grand maître de la poésie persane, lui-même. Langage épuré, image sensuelle et soigneusement ciselée, vocabulaire précis ; chez Elodia, l’amour côtoie le doute, la solitude, l’attente, l’absence et le questionnement de soi. »
Et quelques mots d’Elodia Turki qui démontrent son intuition de l’essence :
Le monde à travers moi se crée
Si je vis Tu existes
Et Tu meurs si je meurs
A l’intérieur de moi
un domaine effrayant
martèle mes secondes
J’ai recousu l’entaille
enfermé ce moteur et ma peur
et dans le lisse et la beauté
de mes masques
J’ai chanté !
Un sommaire foisonnant dont le dossier est consacré à Pierre Boujut qui fonda en 1946 et anima la revue La Tour du Feu, Revue internationale de création poétique, résolument optimiste opposé à l’existentialisme et à toute forme de nihilisme. « Si vous n’aimez pas la vie, n’en dégoûtez pas les autres. Si votre existence n’a pas de sens, ne généralisez pas. » dit Pierre Boujut, ou encore : « A contre destin, sois toi. » La revue est poétique et politique : « Tout impérialisme – capitalisme ou égalitaire – écrit-il, est abject et absurde. Il s’agit de recréer une mentalité de paix et d’arracher les peuples aux envoûtements guerriers que certains se plaisent encore à pratiquer. »
Pendant trois décennies, la revue va célébrer la vie, la créativité, la fraternité, l’amitié… Les poètes se rendent à Jarnac, où Pierre Boujut demeure, pour participer à ce mouvement humaniste et libertaire. Jusqu’à cent poètes, témoigne son fils, participent à ces rencontres.
Christophe Dauphin rappelle les « sacrements » de la revue : « 1/ Le sacrement du divorce, c’est-à-dire la désertion ; le droit de refuser ce que notre conscience réprouve. 2/ Le sacrement de la canonisation, le droit de dresser des statues aux amis et le devoir de le faire pendant qu’ils sont encore vivants. 3/ Le sacrement de l’illumination, c’est-à-dire de l’instant béni de la création qui met le poète en communion avec l’univers. Le quatrième sacrement aurait pu être le sacrement de la contradiction, tellement celle-ci (la contradiction) est au cœur des débats du groupe. »
Cette revue, conservée précieusement par ceux qui ont su se la procurer, fut marquante pour beaucoup. Pierre Boujut a lui-même publié une vingtaine de recueils de poésie. Voici un poème extrait de La vie sans recours (1958), véritable profession de foi.
Le baptême du poète
Il s’est jeté au feu avec nous
et maintenant il ne pourra plus
retourner chez les serpents
chez les glissants, chez les rampants
chez les fuyants entre deux eaux.
Il a la marque sur son front
il a la fièvre dans ces veines
et sur ses lèvres dévorantes
il a posé le pur charbon.
Quoi qu’il arrive à son navire
quoi qu’il décide en son sommeil
il est signé de notre amour
il est choisi pour un bonheur
qui s’élève à notre horizon
et le compas des solitudes
n’aura plus centre en son cœur.
Ô mes amis, plus haut que moi
formons l’essaim de vérité
et sans redouter les prophètes
écouter naître le passage
de l’arbre à l’hirondelle
de l’étoile au poème
et de la Tour de Feu au retour éternel.
« La poésie est un moyen de salut individuel et de transformation à la fois magique et révolutionnaire du monde, nous dit encore Christophe Dauphin. Qu’après avoir sauvé le poète, elle soit capable de sauver d’autres hommes, voilà pour Pierre Boujut le plus sûr critère de sa valeur. Pour lui, les poètes sont des prophètes, non pas des meneurs. »
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, avril 2021).
*
Tout d’abord signaler que ce numéro du premier semestre 2021 est dédié à une grande poétesse disparue en 2020 à qui il rend hommage, Elodia Turki, dont ces quelques mots introduisent le volume :
« Je n’accorde à rien ni à personne le droit de ressentir à ma place… »
« Quand le cœur devient l’unique occupant d’un corps et se pend au gibet de sa gorge, se fait lourd, outre veloutée et tiède qui menace de choir… alors la main spontanément se tend, s’arrondit pour recevoir, protéger, caresser, protéger, aimer. Et cette émotion suspendue, le temps d’un étonnement, comme un éclair domestiqué, abrite et habite, Hôte absolu, l’Autre, dans une reconnaissance éperdue. »
Elodia Turki, Inédits.
Ce volume, comme les autres, est une somme inouïe avec cette fois-ci pour thématique “La poésie et les assises du feu”. Dans son édito Christophe Dauphin évoque Pierre Chabert et La revue La tour de feu, “fédération de tempéraments, c’est à dire d’hommes-symboles”. Suivent les portraits de ces Porteurs de feu : Edmond Humeau évoqué par Paul Farellier et René de Obaldia par Christophe Dauphin. Une longue présentation, contextuelle autant que littéraire précède de long extraits des œuvres de ces deux poètes. Remarquable déjà.
“Une voix un œuvre” est une des rubriques habituelles de la revue. Elle nous présente Les univers imaginaires de Matei Visniec, puis place au dossier La poésie et les assises du feu. Pierre Boujut et la tour de feu, présenté par Christophe Dauphin, accompagné par un poème de Claude Roy. Un panorama aussi bien historique que didactique, et de nombreux poèmes sont là pour accompagner le propos.
Adrian Miatlev fait suite à Pierre Boujut. Dans un article “la mémoire, la poésie”, Christophe Dauphin évoque la vie et le “feu” qui a tracé le chemin du poème pour cet homme dont l’œuvre est révélée par ces pages riches et denses.
Les articles ainsi que le dossier proposé dans ce numéro sont ponctués par des poèmes d’auteurs qui s’inscrivent dans la rubrique “Ainsi furent les WAH 1, 2, puis 3, car ces plages poétiques ponctuent le volume. Des auteurs comme Alain Breton, Odile Conseil, Paul Roddie, Michel Lamart, Béatrice Pailler, Claire Boitel, Alain Brissiaud, Anne Barbusse, et d’autres, enrichissent cette somme à chaque fois impressionnante. 350 pages pour ce n° 51, où le lecteur peut découvrir des auteurs, mais aussi parcourir des étendues immenses de poésie, de mondes poétiques, de lieux où se sont écrites les pages de l’histoire d’une littérature dont Les Hommes sans épaules témoignent tant il est vrai que cette revue est le lieu d’une parole exégétique sans pour autant perturber la réception des œuvres qui sont présentées par les propos qui guident la lecture plutôt qu’ils n’en restreignent la réception.
Des notes de lecture ainsi qu’une rubrique “Infos/echos” et “Tribune” viennent clore cet impressionnant volume.
Carole MESROBIAN (in recousraupoeme.fr, 6 avril 2021).
*
« Comme n’importe quelle production humaine, la poésie a sa grande Histoire, son mainstream et ses ruisselets. Ces courants du 20èmesiècle c’est ce à quoi s’attachent de nombreux numéros de Les Hommes sans Épaules.
Ainsi dans ce n°51, Edmond Humeau (1907-1998), poète bouillant, fermement engagé : L’horrible exécution des deux anarchistes me serre la gorge… - … j’implore la force de regarder en face les corps des suppliciés et l’âme des bourreaux, mais à l’écriture angevine : La porte des morts baille – Bayez bouillez bêlez – La mort est à ma taille.
Ainsi le bouillant Pierre Boujut (1913-2011), présenté par Christophe Dauphin. L’unique vrai célèbre de Jarnac, le pacifiste mordicus. Le moteur acharné de La Tour de Feu (127 numéros d’une revue dont Christophe Dauphin dit qu’elle n’est pas jetable) avec affiché dans son bureau : « Ni dieu ni maître, mais Simone ». Pourfendeur des Barthes, des Prigent, « une bande d’abrutis en veston, professeurs de quelque chose, héritiers de quelque chose, directeurs de quelque chose… »
Une brève sélection de poèmes de Boujut suit (dont celui-ci dédié à Georges Cathalo) : J’ai toujours cherché le poème parfait – celui qui déclenche – le fait par le mot – celui qui suscite – le feu par le son – l’avalanche au cri – l’âme à la maison – Celui dont le poids est égal à soi – celui dont le bruit augmente le sens – qui appelle un homme – et réveille un dieu.
Dans ce même numéro, René de Obaldia, Adrian Miatlev -compagnon de La Tour de Feu, présenté par Christophe Dauphin) et des vivants : Béatrice Pailler, Odile Conseil, Alain Brissiaud, Claire Boitel, Anne Barbusse, Hervé Delabarre, Facinet Cissé, Elodia Turki, le roumain Matei Visniec… et de nombreuses lectures-critiques ».
Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°186, septembre 2021).
*
De cette copieuse revue semestrielle de 350 pages dont il est impossible de rendre compte de toutes les facettes, je retiens le dossier préparé par Christophe Dauphin sur la revue devenue une référence pour les revuistes, La Tour de feu, au tirage allant de 1.000 à 3.000 exemplaires selon les numéros.Fondée en 1946 à Jarnac en Charente, loin des cénacles parisiens, par Pierre Boujut qui la dirigea pendant 35 ans, la revue fut le « bouilllon de cultures et d’idées » d’un groupe d’amis qui avaient une vision non-conformiste de la création poétique, dans l’indifférence aux questions esthétiques et linguistiques alors à la mode.
Elle eut d’emblée une dimension internationaliste « de cœur comme de pensée » et un engagement pacifiste. Outre Pierre Boujut, « poète et tonnelier », le dossier s’attarde sur quelques figures et compagnons de la revue : Edmond Humeau, Claude Roy et Adrian Miatlev.
La revue rend aussi un hommage à Elodia Turki, membre active de sa rédaction et poète, décédée en 2020. Pour clore le numéro, Christophe Dauphin consacre une « tribune » salutaire à Samuel Paty, professeur de collège assassiné par un islamiste. Il retrace minutieusement la chronologie des faits, de la « campagne dénigrante » qui a attisé la haine sur les réseaux sociaux à l’horreur absolue, le meurtre par décapitation. Il inclut la tragédie de ce qui n’est pas un fait divers, dans la longue série d’assassinats et d’attentats trop vite oubliés, perpétrés par les islamistes dans une logique suprématiste.
S’interrogeant sur les conditions d’enseignement devenues aujourd’hui difficiles et sur l’absence de soutien dans un climat délétère de complaisance et de lâcheté ambiante, il reprend les propos tenus dans le journal Libération en 2006 par le poète franco-tunisien Abdelwahad Medded (décédé en 2012) affirmant avec lucidité, arguments à l’appui, que « l’islamisme est un fascisme ». « Moins que jamais il faut se taire » : c’est ce précieux conseil d’Abdelwahad Medded que Christophe Dauphin a entrepris de suivre ici.
Marie-Josée Christien (in revue "Spered Gouez / l'esprit sauvage" n°27, 2021).
|
|
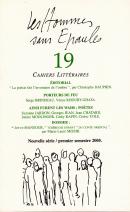
|
|
2005 - À propos du numéro 19
« L’arbre du monde est une femme : Joyce Mansour. Ah ! Fulgurante Joyce Mansour, on était depuis toujours amoureux d’elle et maintenant on la découvre belle en photo dans le n°19 des Hommes sans Épaules. Un dossier (biographique et historique) de 45 pages concocté par Marie-Laure Missir sur cette Egyptienne de feu. Dans ce même numéro un dossier sur Henri Falaise, et un plus bref sur Gérard Murail. »
Christian Degoutte (Verso n°122, septembre 2005).
|
|

|
|
2014 - A propos du numéro 37
" Somptueux numéro 37 de la toujours excellente revue Les Hommes sans Epaules. Christophe Dauphin orchestre une passionnante rencontre avec Lawrence Ferlinghetti : « C’est bien malgré lui qu’il est entré dans l’histoire de la littérature étatsunienne, avec ses grands disparus : Kerouac, Burroughs, Ginsberg et Corso ; la liste pourrait être plus longue. Il vient d’avoir 95 ans, le 24 mars 2014, et depuis longtemps déjà Lawrence Ferlinghetti fait partie, avec ses amis de la Beat Generation, du patrimoine mondial de la poésie ». Il est vrai que je ne dois pas être la seule à penser que Ferlinghetti nous avait déjà… quittés. En tout cas, le vieil homme est un monument de vivacité, toujours libertaire et en insurrection. La poésie comme « révolte contre le silence », dit-il. Merveilleux. Cela se passe à San Francisco évidemment et Ferlinghetti n’est pas que poète, si j’ose cela, il est aussi l’éditeur de la Beat Generation, celui sans qui la Beat Generation sans aucun doute ne serait pas devenue la Beat Generation. On dira « et alors ? ». La lecture des récentes lettres de Ginsberg ou du Bouddha de Kerouac, deux livres récemment traduits et édités par Gallimard, porteront réponse simple à l’interrogation. Le bonhomme est cependant et avant tout poète : « Je te fais signe à travers les flammes. Le Pôle Nord a changé de place ». La charge métapoétique des poètes du « groupe » est toujours vivace et plus que jamais nécessaire. Les curieux de cette poésie des profondeurs, défendue en France et ailleurs (entre autres) par l’action poétique de Recours au Poème, liront ce dossier avec bonheur, ainsi que les livres de Ferlinghetti (certains titres actuellement disponibles chez Maelström).
Les Hommes sans Epaules 37 apportent par ailleurs un lot de très bonnes « surprises ». On y lira, entre autres, des poèmes de Lionel Ray, Mahmoud Darwich, Lyonel Trouillot, des textes surréalistes de René Crevel (dont un « sur l’anti poésie », forme de contre initiation qui n’est pas ici la moindre de nos préoccupations), Jehan van Langhenhoven (texte qui semble paraître simultanément chez Rafael de Surtis), les animateurs des HSE… Sans oublier l’intéressante rencontre avec Nanos Valaoritis. Tout cela forme un numéro d’une très grande cohérence, l’un des meilleurs de cette superbe revue peut-être. C’est dire. "
Sophie d'Alençon (in recoursaupoeme.fr, 17 avril 2014)
" Les Hommes sans Epaules, cette revue semestrielle méritait sans doute la place de revue-du-mois depuis longtemps. Elle est tellement dense et riche qu’il est difficile d’en rendre compte d’une façon exhaustive. Près de 300 pages, d’études, poèmes, chroniques, critiques, la livraison est pleine comme un œuf !
Pour commencer Annie Salager et Lionel Ray. Annie Salager et cette déclaration initiale : Je n’aime pas que l’on m’impose, avec des poèmes délicats, sensuels et intérieurs, où nature et esprit s’entremêlent sans cesse ; et Lionel Ray, (Robert Lhoro) qui creuse entre autres thèmes, celui de l’identité : Je suis un homme sans dimanche … je suis un homme sans toit… un homme sans miroir… sans refus… Dans un autre texte : je ne suis pas qui je suis… Dans un autre encore : …labyrinthe où passe et ne passe pas le voyageur immobile que je suis et que je ne suis pas… Et cette chute : Dans les miroirs où tout s’efface / Cette buée de notre souffle / et d’invisibles traces…
5 poètes pour suivre : Mahmoud Darwich, le célèbre poète palestinien disparu en 2008 ; le poète haïtien Lyonel Trouillot ; Julie Bataille, la fille de Georges Bataille, Cathy Garcia, l’animatrice de la revue Nouveaux délits, qui donne des extraits de son recueil Fugitive (dont je rendrai compte dans le n° 162 de Décharge) ; et Tristan Cabral. - // Un peu d’histoire. En 1974, paraît aux éditions Plasma : Ouvrez le feu de Tristan Cabral, suicidé en 1972. Le livre était préfacé par Yann Houssin, son professeur de philosophie à Nîmes. Le recueil rencontre un gros succès. On apprend en 1977, que Yann Houssin et Tristan Cabral ne forment qu’une seule et même personne. A l’époque, dans la revue Le Crayon noir, avec les membres de l’équipe, nous avions dénoncé le subterfuge. Dans un premier temps, Gérard Lemaire avait fustigé « l’emballage » du recueil : tout le côté « poète maudit » mis en avant, comme principal argument de vente, - sans savoir de quoi il retournait ! Dans un deuxième temps, une fois le faux suicide en voie d’être révélé, je m’en prenais, à mon tour, au procédé que je trouvais indigne. Il est clair que le recueil n’aurait pas eu le même écho si l’auteur n’avait pas pris de pseudonyme et créé semblable personnage, fin radicale comprise. Mal m’en a pris ! Tous ceux qui avaient tressé des couronnes au soi-disant pendu me sont tombés dessus ! Les plus virulents furent les critiques du Monde qui avaient rédigé les éloges les plus fournis. Cette imposture originelle m’a toujours tenu éloigné de ce poète très combatif et militant pour le reste, dont je ne conteste pas l’œuvre, mais qui symbolise pour moi la déception.// -
Suit le gros morceau de cette livraison, une étude consacrée par Christophe Dauphin à « Georges Bataille et l’expérience de la limite ». Cette pratique de l’excès passe par le sacrifice d’un côté et de l’autre l’érotisme, « ce sacré indépendamment de la religion ». « Le détour par le péché est essentiel à l’épanouissement de l’érotisme », pour reprendre deux phrases du dossier. La vie de l’auteur de La part maudite est ensuite retracée en détails de 1897 à 1962 entre Billom et Vézelay.
Autre gros morceau : rencontre avec Lawrence Ferlinghetti, le fameux libraire de « The City Lights Books » de San Francisco, dont le nom fait aussitôt penser à la Beat generation des Kerouac, Ginsberg, Burroughs etc qui a inspiré hippies et beatnicks… Âgé de 95 ans, Ferlinghetti, qui a publié tous les textes majeurs de ce mouvement dont le Howl d’Allen Ginsberg, est toujours en pleine forme et donne une sacrée leçon de punch à quiconque. Troisième personnalité, le poète grec Nanos Valaoritis, né en 1921, le premier à avoir traduit en anglais Séféris et Elytis (en 1947). Il va voyager à Paris, aux Etats-Unis, avant de revenir à Athènes. Extrait de son poème Préavis, comme une suite d’aphorismes, ce dernier comme clausule : chaque rocher est un côté de la question. Pour suivre Gabrielle Wittkop, disparue en 2002, avec une étude très intéressante sur cette disciple du divin marquis, dont la thématique d’écriture balance entre Eros et Thanatos. Son œuvre témoigne d’une transgression encore sulfureuse aujourd’hui. Des reprises d’articles de René Crevel, et le surréalisme raconté à la manière de Jehan Van Langhenhoven. Enfin la chronique d’Eric Sénécal « La nappe s’abîme » où il met en perspective ce qui s’est passé récemment en poésie et ce qui se passe aujourd’hui : le charabia a remplacé l’intuition, la provocation, le goût du risque. Et encore, je ne cite pas les sept noms des critiques qui tiennent les notes de lecture… Les HSE, c’est une véritable source de multiples découvertes ou approfondissements tous les six mois ! "
Jacques MORIN (in dechargelarevue.com, mai 2014).
" Comme les précédentes, cette nouvelle livraison des Hommes sans Epaules est toujours aussi copieuse et rassasiante. De prime abord, on pourrait affirmer que cette revue se place dans le sillage de la comète surréaliste mais pas seulement car la variété et la diversité des écrits retenus ouvrent de nouveaux espaces. Deux poètes contemporains sont ici mis à l’honneur ; il s’agit d’Annie Salager et de Lionel Ray. Ils sont présentés tous deux par l’infatigable Paul Farellier avec de significatifs extraits de leurs œuvres accompagnés de quelques inédits. Très passionnantes ensuite sont les rencontres et interviews de personnages hors du commun tels l’Américain Lawrence Ferlinghetti et le Grec Nanos Valoritis. On lira aussi une très longue étude sur l’œuvre de Georges Bataille, étude suivie de quelques textes rares de cet auteur. En fin de numéro, les abondantes informations et notes de lectures de sept chroniqueurs apportent de belles ouvertures sur des ouvrages intéressants. La quasi-totalité de ce numéro repose sur les épaules, très solides et bien réelles, de Christophe Dauphin, cheville ouvrière de l’agencement des rubriques et responsable de nombreux écrits. On ne saurait trop louer son dynamisme et sa remarquable connaissance de la poésie vivante. "
Georges CATHALO (in revue-texture.fr, mai 2014).
" Georges Bataille dans Les Hommes sans Epaules...
Dans un sommaire une nouvelle fois magnifique, peuplé de poètes superbes, Mahmoud Darwich, Lyonel Trouillot, Tristan Cabral, Julie Bataille, Cathy Garcia Annie Salager, Lionel Ray, Lawrence Ferlinghetti, Nanos Valaoritis… le dossier, réalisé par César Birène et Christophe Dauphin, est consacré à « Georges Bataille, et l’expérience des limites ».
Dans son éditorial, Christophe Dauphin donne un extrait d’une lettre envoyée en 1953 aux HSE par Bataille : « … j’écrivais, comme je pouvais, dans le car qui me menait à Avignon, que l’érotisme signifiait pour moi ce retour à l’unité, que la religion opère à froid, mais la mêlée des corps dans la fièvre. Je ne sais si ma philosophie prendra place dans l’histoire de la pensée, mais si les choses arrivent ainsi, je tiendrai à ce qu’il soit dit qu’elle tient à la substitution de ce qui émerveille dans l’érotisme (ou le risible ou VISIBLE) à ce qui s’aplatit dans le mouvement rigoureux de la pensée. »
L’œuvre de Georges Bataille (1897-1962) est bien davantage qu’une œuvre à dominante érotique. L’érotisme est ici une quête, une pratique de la non-séparation qui illumine la totalité de l’expérience humaine. C’est le portrait d’un homme complexe, intransigeant avec l’expérience dont il cherche à extraire l’essence, qui nous est proposé. Christophe Dauphin et César Birène éclairent la place occupée par Georges Bataille dans la pensée du XXe siècle et les nombreuses avenues, rues ou parfois ruelles obscures qui y conduisent.
L’homme est élégant, par le corps certes, mais surtout par la pensée et l’écriture, une élégance qui d’emblée écarte ce qui pourrait nuire à la perception brute, parfois brutale, de ce qui est en jeu ici et maintenant dans une rencontre chargée d’impossibles trop présents, de refoulés et de non-dits. La recherche centrale de Georges Bataille à travers tous les thèmes abordés dans son œuvre, de l’érotisme à la guerre, est, nous disent César Birène et Christophe Dauphin, « l’homme ; l’homme dans son rapport au mal et dans son rapport au sacré ; l’érotisme et la mort, qui ont ceci de commun, qu’ils impliquent des états affectifs (angoisse ou extase) d’une grande violence. ».
Bataille veut penser « l’hétérogène », « tout ce qui est rebuté, réduit à rien, honni, vilipendé, ce qui dégoûte, ce qui répugne », un hétérogène qu’il sacralise et oppose à l’utile, l’efficace. On voit la dimension politique considérable de cette approche.
Il y a en permanence chez Georges Bataille une recherche d’axialité, une pensée verticale. Chez Georges Bataille, ce qui évoque un autre grand penseur, Nikos Kazantzaki, l’homme est étiré, parfois déchiré, brûlé parfois, entre un mouvement ascendant vers le divin, l’amour, et un mouvement descendant vers la souillure et la mort. Dans ce contexte de tension extrême, « l’érotisme est le nom même de l’expérience que l’homme peut faire du sacré indépendamment de la religion, la forme emblématique de l’expérience commune de l’excès ».
César Birène et Christophe Dauphin notent qu’il serait vain de classifier Georges Bataille comme de catégoriser son œuvre qui brouille les frontières et les limites pour mieux prendre l’expérience humaine comme une totalité, un continuum qui ne laisse rien de côté.
De 1937 à 1939, avec Roger Caillois et Michel Leiris, il fonde et anime le Collège de sociologie qui va étudier les manifestations du sacré dans l’existence sociale. Georges Bataille oppose la transgression, l’interdit, la gratuité, à l’utilité, la production, l’économie. Le fruit défendu se fait délice. Surtout, il libère de représentations étouffantes. Il y a quelque chose du renversement permanent chez Bataille, un renversement qui se nourrit de l’autonomie. La transgression a besoin de l’interdit pour que l’excessif soit libérateur.
Georges Bataille, parce qu’il saisit les mécanismes profonds de la violence, sera d’une grande lucidité sur les dérives fascistes. César Birène et Christophe Dauphin rappelle qu’« il montre notamment comment les fascismes parviennent à subjuguer des éléments épars et hétérogènes quand les démocraties, anesthésiées par la fable de leur développement serein, croient pouvoir les négliger ». Une observation très actuelle.
Il fondera dans les années 30 le mouvement Contre-attaque pour s’opposer à la montée du fascisme et analysera avec une grande pertinence, dans la revue de son autre mouvement éphémère, Acéphale, la récupération de Nietzsche orchestrée par le fascisme. « Bataille attaque violemment Elisabeth Foerster, la sœur (nazie) du philosophe (l’appelant Elisabeth Judas-Foerster). Il y rappelle une déclaration de Nietzsche (écrite en capitales) : « Ne fréquenter personne qui soit impliqué dans cette fumisterie effrontée des races ».
César Birène et Christophe Dauphin rendent compte de la vie agitée et florissante, en clair-obscur, de Georges Bataille, ses relations complexes avec André Breton et le surréalisme, ses alliances et ses ruptures et de la permanence de sa recherche car, à travers la multiplicité des écrits, des créations, des manifestations, des expériences, des excès, des inattendus, des rages aussi, la cohérence demeure dans le pressentiment d’une révolution de l’esprit qui restaure l’unité de l’être.
Ce dossier, hommage à Georges Bataille, est bienvenu dans un temps de crispation qui voit la pensée se rétrécir. La transgression, libre de toute utilité et de toute marchandisation, est tout autant nécessaire aujourd’hui que dans les années qui précédèrent l’avènement du nazisme. Les années 30 ont manqué de transgression comme nous en manquons aujourd’hui. Le message de Georges Bataille n’est pas contextué, il traverse les contextes comme les temps. Il n’est pas éternel, il est d’aujourd’hui."
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, mai 2014).
"La revue paraît deux fois par an et offre au lecteur beaucoup de découvertes et d’études fouillées. Le dossier principal de ce n° 37, copieux et bien documenté, est consacré à Georges Bataille, « aîné tutélaire » des HSE dès 1953, romancier et penseur à l’œuvre monumentale parmi les plus marquants du XXè siècle, mais qui n’eut pas la reconnaissance méritée de son vivant. César Birène et Christophe Dauphin en donnent une juste approche et mettent en évidence « son expérience limite » de la transgression et de l’excès, sa pensée riche et complexe, son lien avec le surréalisme. A lire dans l’abondant sommaire des textes de Mahmoud Darwich, Tristan Cabral, Julie Bataille, un choix de texte de René Crevel à (re)découvrir. Paul Farellier présente Annie Salager et Lionel Ray. La chronique d’Eric Sénécal revient pour une toujours aussi savoureuse et jubilatoire lecture. "
Marie-Josée CHRISTIEN ("Revues d'ici" in revue Spered Gouez n°20, octobre 2014).
"De nombreux articles ont, ces dernières années, souligné l’avenir incertain des revues littéraires : perte de lectorat, frais postaux devenus exorbitants, tendance de l’époque au repliement sur soi, concurrence du web, etc. La plus emblématique des revues littéraires françaises, la nrf (fondée en 1909), de mensuelle est devenue trimestrielle depuis son centenaire qui l’a quasiment tuée. Or les revues sont indispensables à la vie littéraire. Ces communautés vivantes (à propos de la nrf de Gide et de Paulhan, Auguste Anglès parle d’un « vrai collectivisme des esprits et des cœurs ») ont des rôles multiples : adoubement des jeunes écrivains, émergence de nouveaux talents, réévaluation de certains auteurs et, bien évidemment, publication de textes inédits divers dont le débouché n’est pas forcément le livre. Les revues ne vont pas mourir ; elles vont muer, abandonner la forme papier trop chère et trop encombrante pour des formes dématérialisées immédiatement accessibles. Voici une revue qui persiste dans son être de papier.
Créée à Avignon en 1953 par Jean Breton, la revue Les Hommes sans Épaules emprunte son curieux titre à un roman préhistorique de Rosny aîné, Le Félin géant, où l’on peut lire : les épaules de Zoûhr « retombaient si fort que les bras sembaient jaillir directement du torse : c’est ainsi que furent les Wah, les Hommes-sans-Épaules, depuis les origines jusqu’à leur anéantissement par les Nains-Rouges. Il avait une intelligence lente mais plus subtile que celles des Oulhamr. Elle devait périr avec lui et ne renaître, dans d’autres hommes, qu’après des millénaires. »
Le n°37 de la nouvelle série (la troisième) de ces « cahiers littéraires », dirigés désormais par Christophe Dauphin, propose un dossier consacré à Georges Bataille, « l’une des figures marquantes de la littérature du XXème siècle ». Il y a des raisons historiques, objectives, à cela : « Georges Bataille fut un aîné tutélaire et des plus attentifs des Hommes sans Épaules dès les débuts de la revue. » Lorsqu’il était bibliothécaire à Carpentras (1949-1951), Bataille se lia d’amitié avec Yves Breton (le père de Jean), notaire dans la cité papale.
Le dossier Bataille se compose d’une « introduction à l’expérience des limites » (Christophe Dauphin), d’une longue présentation de la vie et de l’œuvre de Bataille (« Georges Bataille et l’expérience des limites » de César Birène et Christophe Dauphin) et de textes de l’auteur célébré.
Face à l’œuvre « quasi mythique, monumentale » de Bataille, « dont on ne ressort pas indemne », ce dossier avoue sa modestie : « parlons d’approche, d’initiation ou d’introduction ». Bataille intimide car son projet est « le plus grand qui soit : mettre l’homme face à ce qu’il est, sans lui donner le recours à quelque faux-fuyant que ce soit. » Après une introduction resserrée sur les notions batailliennes d’hétérogène, de sacrifice, d’érotisme, de transgression, montrant l’effort constant de Bataille de « ne rien laisser en dehors de la pensée, et donc d’y faire entrer ce qui la perturbe, l’interrompt ou la révulse », l’étude de César Birène et Christophe Dauphin s’oriente vers une présentation chronologique de la vie et de l’œuvre de l’auteur de L’Érotisme. Fait rare : les deux présentateurs considèrent La Part maudite, ouvrage négligé voire décrié, comme un « livre d’une grande importance », qui « occupe une place centrale dans l’œuvre de Georges Bataille » et ils disent pourquoi. Modeste, cette présentation toujours claire occupe tout de même trente-deux pages de la revue.
Elle s’accompagne de trois poèmes extraits de L’Archangélique (1944) et de « La publication d’Un Cadavre », texte de 1951 que Bataille écrivit à la demande d’Yves Breton. Plus de vingt ans après la publication de ce pamphlet collectif contre André Breton, Bataille - qui en avait été la cheville ouvrière - revient sur le contexte et les conditions de sa mise en œuvre. Et il lâche cet aveu : « je hais ce pamphlet comme je hais les parties polémiques du Second Manifeste » du Surréalisme. En 51, il a fait la paix avec André et le dit à Yves (les deux Breton n’ont aucun lien de parenté entre eux). "
Christian LIMOUSIN (in lesrendezvousdulire-ecrire.blogspot.fr, 23 novembre 2014).
" Si ce numéro des HSE a le parfum de l'ailleurs, cet ailleurs n'est pas celui des jolis voyages: c'est Haïti sous la plume de Lyonel Trouillot, c'est la palestine dite par Mahmoud Darwich. et c'est le fumet puissant de Georges Bataille. D'ailleurs une large part de ce n°37 est sous la figure tutélaire de Bataille: qu'il s'agisse directement de lui, de son oeuvre (étude fouillée de César Birène et de Christophe Dauphin), de ses quelques textes reproduits ( dont, "Un Cadavre"), qu'il s'agisse des poèmes de Julie Bataille (sa fille): "mes yeux aspirent à la beauté de la famme arrachée", ou qu'il soit question de l'oeuvre brûlante de Gabrielle Wittkop (présentation de César Birène et de Gérard Paris): "il va fallait alors voir la Sainte-Vierge couchée sur le flanc, les yeux clos, la bouche entrouverte comme celle d'une morte, avec des filets de salive et de sang coulant sur l'oreiller, le sang lui jaillissait aussi du cul et du con : elle était bien blessée..." Plus paisibles et avec un bon nombre de pages : Lionel Ray: "Ces pauvres choses qui nous étaient / si proches...", Annie Salager : "Où j'aime tomber / mais dans / l'odeur des roses..." La wrence Ferlinghetti: "Poètes, sortez de vos placards...", le grec Nanos Valaoritis: "Chaque rocher est un côté de la question..." Je ne peux pas tout dire. chroniques, lectures poétiques."
Christian DEGOUTTE (in Verso n° 158, septembre 2014).
|
|
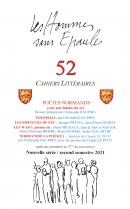
|
|
Lectures critiques :
LES HOMMES SANS EPAULES N°53 : REVUE DU MOIS, MARS 2022
La revue de Christophe Dauphin offre chaque semestre un volume copieux à la tranche épaisse, capable de relier 356 pages, et pas une de moins ! L’axe choisi cette fois tient chaud au cœur de son animateur : autour de la Normandie. Il a déjà écrit deux énormes tomes autour de la question et y revient dans cette livraison avec plaisir.
Son éditorial retrace historiquement la poésie de la normandité, depuis 911 très exactement. Depuis La chanson de Rolland, Tristan et Iseut jusqu’à aujourd’hui, le concept de normandité repose avant tout autour du paradoxe rationalité/sensibilité.
La revue va, dans ce numéro en particulier, grouper notice biographique très fouillée, suivie de la bibliographie exhaustive et extraits d’œuvre. Jacques Prevel d’abord, dont on apprend que ses trois principaux recueils de poèmes ont été publiés à compte d’auteur, avant sa rencontre exceptionnelle avec Artaud qui dura cinq ans, avant qu’il ne meure de tuberculose à l’âge de trente-six ans. Enfant je me suis étonné / De me retrouver en moi-même / D’être quelqu’un parmi les autres / Et de n’être que moi pourtant…
C’est à l’âge de vingt-neuf ans que Jean-Pierre Duprey met fin à sa vie. Il a fréquenté le groupe surréaliste. Que cherchent les regards du ciel au fond du lac / Où dorment des momies ? / Légères se balançant sur le sable bleu / Leurs membres sont des sacs…
On retrouve ensuite l’immense Henri Michaux avec des poèmes écrits à Honfleur. Puis Jean et Melvin McNair, installés à Caen en 1986. Marie-Christine Brière : Je chauffe le poème au soleil des malades // Je pense à eux dans l’air glacé de Pâques / J’offre de ces pommiers la fractale… Marie Murski : On peut fermer la grille / mettre la clé sous son sein / évider les clavicules à bretelles / sans retenir le monde qui s’écroule... André Malartre avec la revue iô, qui connut deux séries (21 n° de 1951 à 57, puis de 1964 à 69) : un grès ne prend pas peur / il nielle les ongles qui le griffent // […] seule la colère tue la pierre / et son venin conduit le deuil…
Retour au XVIIème siècle avec l’apologie de Claude Le Petit, brulé vif en septembre 1662 pour avoir écrit un libelle libertin et impie. Christophe Dauphin le qualifie aussi bien d’ordurier que raffiné. Puis le dossier : « Pour une falaise du cri ». Avec présentation de la normandité par Léopold Sédar Senghor qui met de son côté l’accent sur l’apport nordique, il cite Flaubert : partir du réalisme pour aller jusqu’à la beauté. Suit toute une galerie de poètes normands : Albert Glatigny mort à trente-trois ans , admiré par Rimbaud et Verlaine ; Paul-Napoléon Roinard, le plus libertaire ; Rémy de Gourmont, mort horriblement d’un lupus ; Gustave Le Rouge et Le Mystérieux Docteur Cornélius (1911) ; Lucie Delarue-Mardrus, phare du Romantisme féminin ; Fernand Fleuret, ami de Guillaume Apollinaire ; Joseph Quesnel et le Pou Qui Grimpe ; Georges Limbour, compagnon de route des surréalistes jusqu’en 1930 ; Jean Follain, mort renversé par une voiture en 1971. Les poèmes de Jean Follain tutoient l’existence dans ce qu’elle paraît avoir de plus infime et de plus singulier mais en définitive de plus vrai… (extrait de la présentation) les grillons des blasons / s’envoleront en cendres… ; Raymond Queneau ; Max-Pol Fouchet entre Saint-Vaast-la-Hougue et Vézelay. La revue Fontaine : 1939-47 et 63 n°. Mort à Avallon en 1980. Michel Héroult au Puits de l’ermite avec Chatard, Lesieur et Momeux puis La Nouvelle Tour de Feu : Mes vaisseaux n’en sont pas détruits pour autant / ils dérivent dans la mémoire d’un oiseau fidèle / emportant mon langage qui me sert de couteau. Michel Besnier : la mer durera / plus longtemps / que les ravaudeurs d’arbres ; Christian Dorrière et le Pavé ; Jean-Claude Touzeil et son humour : J’ai des mots plein la tête / Qui courent et qui se cognent / Et ne sortent jamais… Tout le poème est savoureux. Jacques Moulin : La falaise chute devant elle / Nous par-dedans jusqu’à nos pieds / Nos pieds perdus / Torsion pour eux dans le debout qu’ils portent / Portée de pieds et reculée… ; Bruno Sourdin que nous suivons depuis Grand écart, son Polder en 1994 ; Guy Allix, bien sûr ; Allain Leprest ; Loïc Herry mort à trente-six ans : Toux crescendo des vagues montant sur le rivage. / Cernée de moutons et de mouettes / Une barque au loin dans les creux... Eric Sénécal et l’éthopée ; enfin Yann Sénécal.
Puis Charles Baudelaire avec deux Normands : Gustave Le Vavasseur et Auguste Poulet-Malassis, l’éditeur des Fleurs du mal, puis Eugène Boudin. Ensuite Piero Heliczer, né en 37 à Rome, admire Gregory Corso, crée une maison d’édition : the dead language. Puis les Secrétions de l’artiste J.G. Gwezenneg par Bruno Sourdin.
Puis Gérard Mordillat, poète-archipel, que je n’avais jamais lu et dont l’humour et l’ironie déménagent. Jean-Paul Eloire, une révélation, c’est vrai : Pourtant le ciel s’était appauvri d’une étoile. Ou bien À quoi bon instruire son cœur et ses rides / quand la soirée est comme un gros écureuil / posé sur nos épaules ? Béatrice Pailler ; Émilie Repiquet : si vous lisez ceci, vous allez croire que je suis une fille facile…
Pour clore peut-être : Un dossier « Barrault / Artaud », à travers un carton rempli de papiers découvert par Eric Saint Joannet, à découvrir les cinq actes du dossier. Il reste plein de choses à glaner dans cette revue énorme et pleine de choses passionnantes...
Jacques MORIN (in dechargelarevue.com, 1ermars 2022).
*
Le numéro 52 de Les Hommes sans Epaules la belle revue littéraire dirigée par Christophe Dauphin est consacrée à la Poésie de la Normandité. En effet, il n’existait pas d’anthologie des poètes normands avant l’anthologie parue en 2010 aux éditions clarisse et ce cahier littéraire est la première revue qui propose un dossier original sur ces poètes dont certains sont absents de l’anthologie.
Le choix a été fait de se restreindre à la partie contemporaine à partir du poète Albert Glatigny. La première question que nous nous posons est : y-a-t-il une spécificité normande en poésie ?
La réponse est complexe et tient pour une part à l’histoire de la littérature normande depuis Guillaume le Conquérant : « Le rayonnement des poètes normands a toujours été intense, rappelle Christophe Dauphin, et c’est notamment en normand que s’est élaborée la littérature française, au cours de la période allant de 1066 à 1204, lorsque le duché de Normandie et l’Angleterre étaient unis au sein du royaume anglo-normand, depuis la victoire de Guillaume le Conquérant contre Harold II, roi anglo-saxon usurpateur, en 1066, à la bataille d’Hastings. (…) Le premier chef d’œuvre de la littérature française, La chanson de Rolland, poème épique et chanson de geste de la fin du Xième siècle, attribué à Turolde, est en anglo-normand. »
Depuis, les Normands furent toujours très présents dans la poésie et la littérature jusqu’aux poètes normands modernistes et surréalistes du siècle dernier. C’est Léopold Sédar Senghor, normand de cœur, qui définit la normandité. Il évoque l’artiste normand comme « un créateur intégral » :
« Je dis, affirme-t-il, que les Normands sont des métis culturels dans la mesure où ils ont fait la symbiose entre les tempéraments, donc les cultures, de la Scandinavie et de la France. »
Métissage et blessures ont forgé un esprit normand capable d’intégrer ce qu’il rencontre pour nourrir le feu de la création artistique.
« De la contestation et de la résistance à l’amour, la normandité se manifeste à grand renfort d’humour noir, de dérision et de satire, au besoin de Merveilleux ; caractéristiques que nous pouvons retrouver, peut-être à quelques exceptions, chez tous nos poètes… » conclut Christophe Dauphin.
Ce dossier « normand », très complet et détaillé, est d’une grande variété tant les poètes de la Normandie, qu’ils soient poètes maudits comme Jacques Prével ou reconnus comme Henri Michaux qui aimait séjourner à Honfleur, ont cherché à reculer les limites et explorer les recoins les plus sombres. Nous retrouvons souvent dans les poèmes cette lumière, que les peintres ont aussi recherchée, qui jette un voile sur la crudité de la vie et permet justement une vision intégrale moins douloureuse.
Au choix, un poème de Marie-Christine Brière :
Fécamp 3
Devant la mer aucun théâtre n’est possible
pas de tréteau face à perpétuité
où lames, ensouples, s’en viennent
les lèvres ne diraient rien les voix
faibliraient
les mouettes crient
comme elles caguent et la nuit
déchirent en groupe leur ventre
aux cheminées. Erinyes à temps plein
sur le luisant des ardoises
losangées de vertige gris
on ne voit que les nuées, le bonheur
le matin les pensées vers toi
Rémi BOYER (in incoherismwordpress.com, 29 octobre 2021).
*
« Plus de 350 pages !!! Ce n'est plus une revue mais une encyclopédie !!! Christophe Dauphin, poète de passion et de rigueur est un véritable bourreau de travail. On connaît ses talents d'anthologistes avec des volumes conséquents et érudits, pleins de belles découvertes. Notamment Les Riverains du feu (Le Nouvel Athanor, 2009) ou Riverains des falaises (éditions clarisse, 2010). Est-ce parce que Christophe est né en 1968 qu'il est si doué pour le lancement de ces énormes pavés sous lesquels il y a de bien belles pages. De chauds pavés qui, quand ils sont bien reçus sur la tête et dans le cœur, font un bien fou, nous régénèrent.
Avant cela Christophe Dauphin a donc publié Riverains des falaises mais ce numéro des HSE n'est en rien une redite. Riverains des falaises remontait aux origines. Si on excepte Claude Le Petit, condamné au bûcher le 26 août 1662, l'optique est plus contemporaine dans ce n° 52 et court depuis des poètes nés dans la seconde moitié du XIXe siècle (Glatigny, de Gourmont, Delarue-Mardrus etc.) jusqu'à Yann Sénécal, né en 1978. Et cette anthologie est comme illustrée par l'œuvre, immense (on le saura un jour !), de J.G. Gwezenneg que je présente ailleurs dans "Les invités de Guy Allix" et qui est découverte grâce aux approches de l'ami Bruno Sourdin ("C'est la magie Gwezenneg. Sa passion est d'être porteur de vie") et de Christophe lui-même ("Il fait les poches du réel et lui fait cracher sa part d'angoisse...").
Le tout enrichi de chroniques, de pages consacrées à Baudelaire, de pages libres des HSE avec Obaldia, qui vient de nous quitter, Christophe Dauphin, Paul Farellier, Alain Breton et d'un très juste texte sur la "normandité" de Léopold Sédar Senghor (au sommaire lui aussi de ce numéro, il habitait Verson où j'étais allé l'interviewer en 1982).
Et puis depuis cette fameuse anthologie de 2010, Christophe a pu découvrir encore d'autres poètes, réparer des oublis qu'on pardonne aisément dans ces entreprises prodigieuses. Ainsi avec André Malartre, le poète fondateur de la revue Iô et homme de théâtre par ailleurs (le théâtre d'Ostrelande bien connu des Caennais dans les années 70 et 80) et qui fut aussi un excellent sprinter dans sa jeunesse. Une œuvre à lire et à relire (on peut aussi la découvrir dans une très belle édition en coffret mise au point par Yves Leroy en 2016 - édition Le Vistemboir -).
Petit souvenir avec André, nous avons échangé quelques lettres et il avait fait une émission sur mon club poésie au collège Lavalley à Saint-Lô en présence de quelques élèves. J'habitais à l'époque dans un quartier assez misérable de Carentan dans la Manche au cinq place Malherbe. J'écrivais toujours mon adresse au dos du courrier... Il me retourna l'enveloppe avec la mention sourire "Enfin Malartre vint". L'étourdi proverbial que j'étais et que je suis resté avait écrit "Guy Allix 5, place Malartre" !
Dans les découvertes de Christophe il y a aussi Christian Dorrière que j'ai croisé plusieurs fois lorsque nous étions encore jeunes. Il a beaucoup œuvré pour la poésie à Caen dans les années 70 avant d'être véritablement trahi par un poète qu'il considérait comme un ami. Misère de la poésie, poètes miséreux mais aussi parfois poètes misérables au sens moral du terme quand l'ego étouffe tout amour.
On retrouve aussi deux grands poètes natifs de Seine Maritime : Jacques Prevel et Jean-Pierre Duprey que j'avais découverts à 20 ans dans la belle anthologie de Pierre Seghers Poètes maudits d'aujourd'hui. Deux poètes qui m'avaient bouleversé. Et je citais Duprey dès mon premier recueil à 21 ans. Des "porteurs de feu", oui, et de douleur. Et des maudits encore et toujours : qui en Seine Maritime, même parmi les poètes et les amateurs de poésie a lu ou lit Prevel et Duprey ? Prevel est ici fort bien présenté ici par Gérard Mordillat qui mit en scène En compagnie d'Antonin Artaud avec un fabuleux Sami Frey dans le rôle du momo et Marc Barbé dans celui de Prevel. Duprey, découvert en fait par le flair d'André Breton lui-même, est présenté de belle manière aussi par Christophe Dauphin.
Je ne peux citer tout le monde tant c'est riche mais je veux évoquer simplement les amis. Bruno Sourdin, l'éternel copain, Jean-Claude Touzeil - le père Fonda du printemps poétique de Durcet, capitale mondiale de la poésie qu'on se le dise -, Patrick Lepetit dit Bakou (devinez pourquoi) rencontré chez l'autre ami Hughes Labrusse à qui je dois tant, Marie Murski que j'ai connue sous d'autres noms naguère. Et puis il y a de grands disparus : Loïc Herry et Allain Leprest. Loïc est mort très jeune et il n'avait publié qu'une seule petite plaquette de son vivant chez Motus. L'essentiel de son œuvre, très forte, a été publiée, suite à sa mort, grâce au travail patient et à l'abnégation si émouvante de ses parents Nelly et Guy. On connaît davantage Allain, très grand auteur-compositeur-interprète écorché vif qui s'est suicidé à Antraigues-sur-Volane le 15 août 2011, un an après la mort de son ami Jean Ferrat. C'est le copain François Lemonnnier qui m'avait fait connaître Allain.
Et bien sûr, on retrouve aussi Follain sur l'œuvre de qui je dois retravailler prochainement.
Ce numéro des Hommes sans épaules est vraiment précieux.
"Ce que je peux dire
C'est que j'ai vécu sans rien comprendre
C'est que j'ai vécu sans rien chercher
Et ce qui m'a poussé jusqu'à l'extrême mesure
Jusqu'à l'extrême dénuement
C'est en moi je ne sais quelle force
Comme un rire qui transparaîtrait dans un visage tourmenté
Quand on a vu toutes les choses se perdre et mourir
Et quand on est mort comme elles de les avoir aimées
Le vent les feuilles la pluie le froid et l'amour qui leur donnait une mémoire
Je ne pourrai plus jamais sans doute me souvenir
Car je suis passé par toute la misère
Mon espoir fut criblé par toute la misère"
Jacques Prevel
Guy Allix (in guyallixpoesie.canalblog.com, 10 février 2022).
*
"Chaque semestre, Christophe Dauphin donne à lire des dossiers, des études, des poèmes et des critiques, bref, tout ce qui fait la force et l’exemplarité d’une revue. Après les Porteurs de feu que furent Jean-Pierre Duprey et Jacques Prével, on lira entre autres René de Obaldia et Gérard Mordillat."
Georges Cathalo (in terreaciel.net, février 2022).
*
« Suivez le guide. Christophe Dauphin, dans Les Hommes sans Épaules n°52, nous propose une visite de la Normandie des poètes avec milles détails biographiques.
En vrai, il faudrait dire des Normandies, tant ce territoire est un puzzle de pays : le pays de Caux, le pays de Bray, le pays d’Auge, etc. Tous plein de poètes.
Voici Bolbec et Jacques Prevel « je me retrouve sans forme humaine – Ensanglanté par mes révoltes et par mes luttes – et condamné à vivre des existences dispersées » . Rouen et Jean-Pierre Duprey « Moi, je n’aurais jamais dû me prendre les pieds dans cette galaxie ». Honfleur où Henri Michaux et Charles Baudelaire sont en villégiature et où Lucie Delarue-Mardrus est née « L’odeur de mon pays était dans une pomme ». Marie-Christine Brière « Fécamp : Devant la mer aucun théâtre n’est possible ». Marie Murski habite dans l’Eure « on crie son sexe dans l’orage – on moucharde les mouettes ». Claude le Petit (Breveuil, commune de Dampierre-en-Bray), Albert Glatigny (Lillebonne), Remi de Gourmont (Bazoches-en-Houlme), Gustave Le Rouge (Valognes), Jean Follain (Canisy), Raymond Queneau (Le Havre), Max-Pol Fouchet (Saint Vaast la Hougue), Christian Dorrière (Caen), Bruno Sourdin (Pontorson), Eric et Yann Sénécal (Dieppe) « Il y a des jours comme ça – on ne sait plus – par où commencer – avec cette impression de déjà-vu – que quelqu’un parle à notre place – c’est décidé à partir d’aujourd’hui – je ne m’dresse plus la parole ».
Tous normands. A tous, ils font cette normandité qu’explique Léopold Sédar Senghor : « l’artiste normand est un créateur intégral, avec l’accent mis sur la création elle-même. Comme le conseillait Flaubert : il faut partir du réalisme pour aller vers la beauté ».
Dans ce même numéro 52, on lit aussi Gérard Mordillat (poèmes anecdotes) « la trop poilue s’épile le delta – Elle veut faire peau neuve -Naître une seconde fois – Retrouver – Les choses cachées – Depuis la création du monde ». Jean-Pierre Eloire « Le pain perdu dans la forêt, le troupeau des œufs est avec lui » et Emilie Repiquet « Blottie dans une épluchure de liberté, entre les bras de sa maman -… Combien d’enfants noyés sur l’écran de nos tablettes… » Rubriques sur les œuvres plastiques de JG Gwezenneg et Virginia Tentindo. Nombreuses lectures critiques…
Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°188, mars 2022).
*
Cette copieuse somme préparée par Christophe Dauphin sur les poètes normands est destinée à compléter et à actualiser son anthologie Riverains des falaises (Ed. Clarisse, 2010) et à pallier l’absence de dossier en revue sur le sujet. Remontant au 11ème siècle, Christophe Dauphin constate qu’ « à travers les âges (…) on retrouve toujours des Normands aux avant-postes ». A la suite de Senghor, normand d’adoption, il définit la « normandité » comme le « fruit d’un métissage entre Scandinaves, Germains et Celtes », portant ensemble rationalité et sensibilité au plus haut degré.
Marie-Josée Christien, chronique "Revues d'ici... Revues d'ailleurs", du n°28 de la revue "Spered Gouez / l'esprit sauvage"
|
|
|