| Tri par titre
|
Tri par auteur
|
Tri par date
|
Page : <1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14 >
|

|
|
Lectures critiques:
Alain Breton est l’un des poètes les plus marquants de la fin du siècle précédent et de ce début de siècle, à l’articulation difficile de deux millénaires. En ces périodes, nous n’entendons jamais assez les poètes.
Dans la préface à ce recueil qui couvre près de quarante années de poésie, Paul Farellier remarque la profonde et audacieuse originalité d’Alain Breton qui, nous dit-il, « s’est jeté dans la marge inhabitée de la poésie française, loin des « lieux poétiques » à haute densité de fréquentation ». Parfois, les marges se constituent en centres où le témoignage de l’être devient puissance qui interroge les évidences. Le poète assume alors la fonction philosophique et va jusqu’à faire penser les morts, très majoritaires en nos temps lourds.
Dans une longue postface, Christophe Dauphin qui a établi cette édition importante, peint la complexité et la richesse du poète qui fuit les éloges. C’est en retraçant un parcours fait de travaux qu’il rend compte du personnage et de l’œuvre, étonnante par sa constance et sa durabilité, tant dans le travail éditorial que dans la création poétique. Alain Breton a déjà marqué son époque. Plus encore, il a inspiré, formé, libéré d’autres plumes qui préparent le futur.
Les poèmes d’Alain Breton sont étrangement vivants. Ils prennent chair à partir du fil des émotions qui dessinent d’improbables thèmes. L’éphémère, l’incertain, l’intranquille demeurent tandis que le lecteur cherche les fondements de cette beauté dérangeante mais qui attire irrésistiblement. Il y a quelque chose de l’ordre du scandale chez Alain Breton, un scandale élégant qui approche sans faire le moindre bruit pour mieux nous bouleverser.
Cette écriture, très resserrée sans être minimaliste comme le note Christophe Dauphin, est presqu’effrayante de justesse. C’est que l’humain à peur des songes comme du réel, il préfère les chimères et évite ainsi les miroirs poétiques, trop révélateurs. La précision des mots, du rythme, des sons, impose ici de voir l’invisible comme le dissimulé. Une réelle beauté. Le titre de ce recueil, Infimes Prodiges, désigne très exactement de quoi il s’agit.
Rémy BOYER (in incoherism.wordpress.com, mai 2018).
*
Fils du poète Jean Breton, qui fut aussi le fondateur des éditions St Germain-des-Prés puis de la revue et des éditions Les hommes sans épaules, Alain Breton est lui aussi poète-éditeur et il dirige la librairie-galerie Racine depuis 1996, après la disparition de son fondateur, Guy Chambelland, ami des frères Breton. Si on peut considérer Alain Breton comme héritier de la mouvance « émotiviste », définie et revendiquée dans le manifeste de Jean Breton & Serge Brindeau, Poésie pour vivre, fédérant, sans constituer une école, Patrice Cauda, Henri Rode, Yves Martin, Georges-Louis Godeau, et de nombreux autres, le fils ne s’est pas contenté d’être un disciple accompli. En effet, cette succession en poésie n’a pas replié Alain Breton sur sa propre création ni déterminé son exclusion sociale mais l’a ouvert généreusement à d’autres écritures contemporaines et l’a lancé à la découverte de nouveaux auteurs. Il définit lui-même la mission du poète avec une exigence de liberté et d’accueil : « Seul à jouer au meccano du monde, à l’amour, le poète exaspère ses limites. Nous rêvons que son ambitieuse quête, que sa fouille minutieuse de la langue ne soient pas perverties par une futile autant que dérisoire volonté de prise de pouvoir sociale ! Que le poète, débarrassé de l’engourdissante course aux concours-articles-subventions-relations (la fameuse tétralogie) se montre enfin accueillant aux textes de ses confrères ! […] Or la poésie devrait être avant tout accueil, méditation-lucidité, communication aimantée. » L’ouvrage comporte une douzaine de recueils publiés de 1979 à 2014, de Tout est en ordre, sûrement… à Les éperons d’Eden.
Dès les premiers textes, la veine érotique s’affirme avec une sensualité ardente. Le corps féminin, à peine entrevu à la lueur clignotante d’un néon, est évoqué en blasons successifs dérivant en variations métaphoriques luxuriantes comme en un dérèglement rimbaldien des sens : « Ô toi. Dépliements de toi, à peine humides, comme d’hypnoses qu’on écoute. / Rare Coccyx. Roseau. Rosier des reins. […] Mousse et glaise aux seins minuscules // Lèche […] Alchimie grave de ton ventre // Ta bouche / Ta paix // commencée tantôt des étoiles. » En un magnifique hommage à Maria, sa mère basque, le poète revit sa propre naissance dans l’ivresse d’une fusion charnelle : « Tu es fœtus, bouquet de gélatine, pélamide de suif […] / Tu souriais, bandé, dans ton buisson liquide / et voici que ton cri vide la peau ancienne. // Pour toi, sourcier du lieu, / nul accord ni défaite possibles. // Mais ton obéissance au seuil ? » Et dans le Final, détaché du corps de la mère, il en appelle, sur un rythme syncopé, au refus de grandir, à l’angoisse de vivre : « Ô ravin-mère, initiale ligne de feu, / je cherche ma voix dans tes déluges, / je reste seul dans mon visage, / pieds nus - sur le vacarme originel. […] J’ai peur de n’avoir été, de n’être / qu’une preuve insoutenable qui saigne / définitivement, / que l’incompréhensible tatoué entre tes cuisses, / une non-existence jusqu’au tombeau parfait, // livide à finir l’à-pic. » Et il reprend, évoquant le ventre maternel « tambouriné », comme en écho au célèbre poème de Blaise Cendrars, Le ventre de ma mère : « Ma mère, tu le sais, / je suis la grenouille de sang entre tes cuisses, / je pends encore dans le labyrinthe de l’air… » L’angoisse existentielle est récurrente dans Planètes : « En moi le deuil de chaque jour. Et tant de terre à attendre. » Et à propos du suicide du jeune Michel Conte, l’empathie saigne, prosodie haletante, cœur à vif : « L’âme dans l’évier. Sales, les veines. Maladroit, tu as taché même tes os. […] Il a fallu identifier le vieillard de vingt ans. »
Dans Juste la terre (1991), Alain Breton, alternant vers et proses, fait coïncider l’amour des paysages de la nature et celui des paysages charnels : « Il respire, sueur libre d’aimer. C’est comme mettre une grande échelle jusqu’au visage. » Et de laisser le lecteur en suspens sur une note baudelairienne : « Juste / la terre // née de fleurs inconnues ». Bivouacs (1992) s’ouvre sur un éloge énigmatique de Robert Doisneau : « On le sait. La photo vient au monde pour acculer les visages. » S’adressant à Jean, son père, le poète revendique une filiation atavique active : « De père en fils, le ciel a voyagé. Mais on travaille avec la même application, la même rude fatigue, les mêmes champs garnis. » Il célèbre aussi la demeure familiale, l’humanise avec une touche d’humour : « Pour que la maison vous adopte / il faudra un peu de fatigue, / des jeux et des odeurs. » Dans Une chambre avec légende (1999), la veine érotique, tantôt ludique, tantôt lyrique, joue des codes de l’amour courtois pour les transgresser, les retourner en images fortement suggestives : « dans un coin se débarbouille le soir / qui déroute sur des cahiers d’école / les seins trotte-menu et tous les doigts de miel ». La météorologie à fleur de peau s’affole, féconde les métaphores : « Aujourd’hui beau temps sur ton dos / seins à bouillir de fine intempérie / je joue ton sexe à la roulette […] A force d’oindre les creux de ma lionne / j’aurai oublié l’or dans sa crypte / et négligé le mot de passe… » Les remparts de robes à vertugadin s’effondrent en descentes de lit. Jubilatoire !
Sous le nom de sa grand-mère maternelle, Aramburu (Jacques), Alain Breton, changeant totalement de registre et de voix, a publié plusieurs recueils : Maison-Buffle (1993), Messe noire des vagues (1999) -Aventure maritime et pillages des pirates du Revenge-, Le chasseur de rivières (2004), Brûlant sombre (2008). Côté piraterie et messe noire, le rythme s’accélère, à boulets rouges : « La lune suffoque au ras des cabestans / ou des murailles / s’ouvrent dévoilant des canons. / De sabords à sabords, / bien moins qu’une encablure ; / les marins s’entassent derrière les lisses, / un sabre à la mâchoire. / Des tillacs, on crie ‘’feu !’’ / Et l’ennemi répond d’une mitraille. / Les orgues du diable saluent les pièces de chasse / - catins à foison des aubes. » D’une veine nonsensique, à tonalité dadaïste, dans Pour rassurer le fakir (2000), l’auteur explore l’inconscient sur le mode ludique, décline des aphorismes funambulesques. Le poète, magicien onirique, se métamorphose au gré de sa fantaisie, il met à distance ses angoisses : « Cette nuit, mon miroir m’a réveillé en sursaut : ses songes avaient disparu. » Il ressort apaisé de ses cauchemars : « Ils m’ont ausculté sous mon scaphandre. Mes os chantaient. J’avais le côté gauche paralysé, le crâne aplati et toute l’eau contenue dans mon corps était déformée, j’étais libre. »
« Tombeau » pour Jean Breton, Les Eperons d’Eden (2014) s’ouvre sur une lettre au père : « Père, tu le fus assez peu. Le temps te manquait, et la vocation […] tu avais choisi d’être plutôt mon ami […] Tu as rendu ton alphabet, trois jours après avoir vomi noir – le jus de la mort. » Au plus près de l’intimité rêvée, plutôt que retrouvée, le dialogue enfin semble possible : « Je bois dans ton bol / et m’enchaîne à tes livres ». L’émotion est forte, sans effusion, d’une sensibilité juste : « A toute vitesse, / j’ai accumulé ton visage // Pour annoter tes poèmes / de salves de toi. // Désormais je t’emporte / de meuble en planète, // Je me fais spacieux / pour ta survie [...] Pourvu que / tu écrives encore / sous la dictée / des météores [...] Je bêche le silence / je demande hospitalité à tes livres. »
Christophe Dauphin, dans une longue et belle postface, retrace l’aventure éditoriale des frères Breton, et de père en fils, salue l’ardeur de leur engagement, évoque la réussite vertigineuse et la débâcle des éditions Saint-Germain-des-Prés, la force des liens familiaux et de leurs amitiés en poésie. Il souligne surtout la singularité d’Alain Breton, l’univers propre de ce créateur pour qui, « de fait, l’être du poème est nombreux, peuplé à foison d’autres masques ou d’autres lui-même, ouvrant toujours des possibles et délivrant ce mode d’emploi à tiroirs d’une toujours plus lointaine et profonde féerie. » Il cite plusieurs critiques, dont Robert Sabatier qui a remarqué très tôt les qualités d’attention du jeune poète aux êtres et aux choses : « Elliptique, il a le sens des silences et traduit de manière limpide les spectacles de la vie. » Et Paul Sanda, de conclure l’ouvrage par un hommage, rédigé en 2016, « à la justesse d’Alain Breton » : « Enfin le reconnaître, le connaître ici à sa juste valeur : un authentique grand poète de notre temps, avec un souffle ardent, bousculant et brûlant violemment le poncif. »
Michel MÉNACHÉ (in revue Europe, 2018).
*
Établie par Christophe Dauphin qui signe également une longue et riche présentation d’Alain Breton, cette édition préfacée par Paul Farellier et accompagnée d’un hommage de Paul Sanda, est une somme de près de 500 pages réunissant l’Œuvre poétique complète d’un auteur qui est aussi critique, peintre, éditeur, fils du poète (et éditeur lui-même), Jean Breton.
De « Tout est en ordre » (1979) aux « Eperons d’Eden » (2014) en passant par « Juste la terre » (1991), « Bivouacs » (1992), « Une chambre avec légende » (1999) ou « Pour rassurer le fakir » (2000), - sans oublier des inédits, et les quatre recueils publiés sous le nom de Jacques Aramburu - les poèmes réunis ici sont ceux d’un auteur qui s’est toujours méfié de l’hermétisme, optant bien plutôt pour ce que Jean Breton et Serge Brindeau, dans leur fameux manifeste de l’homme ordinaire, ont appelé une « poésie pour vivre ».
Poésie de la vie, oui, en prise avec la quotidien le mieux partagé, pour nous parler des hommes et des bêtes, du sport (boxe, lutte, foot, judo…), du jazz, de l’amour, de la campagne, évoquer aussi les êtres dont il est ou fut proche, telle la grand-mère, ou sa mère, tel son oncle Michel, qui fonda la revue Poésie 1 où Alain fit ses premières armes d’éditeur et qui se suicida, tel son père bien sûr (« Eperons d’Eden », lire ici). Une poésie qui respire, mise sur l’émotion (vécue et transmise), la sensualité, mais sait aussi les pouvoirs du verbe et les vertiges de l’inquiétude métaphysique. Une mélancolie discrète s’y faufile, cependant l’énergie y domine l’âme grise. « Ainsi voyage le luxe des jours / dans l’appétit de vivre ».
Michel BAGLIN (cf. "Mes lectures de 2018" in revue-texture.fr, 12 juin 2018).
*
"Une vraie malle au trésor. je ne cesse d'y fouiller, puiser. Belle et sobre préface de Paul Farellier. Présentation de Christophe Dauphin (pari de nouveau gagné), qui retrace, dans ce livre, l'itinéraire étonnant, forçant l'admiration, de ce poète-éditeur aux talents multiples. Il y est bien sûr question du grand Jean Breton, le père d'Alain (évoqué in Coup de Soleil n°32), de Guy Chambelland, que j'ai rencontré naguère dans sa librairie-galerie à Paris, tout comme Yves Martin (évoqué in Coup de Soleil n°15), cité, lui aussi, de Daniel Biga, etc. "
Michel DUNAND (in revue Coup de Soleil n°103, juin 2018).
*
« Émotiviste par essence », selon Christophe Dauphin, le poème s’ouvre au merveilleux chez Alain Breton. Voici, rassemblée en plus de 400 pages, son œuvre depuis Tout est en ordre sûrement (1974) jusqu’à Les Éperons d’Éden (2014). Des inédits complètent ce volume, ainsi que les poèmes publiés sous le nom de Jacques Aramburu.
Isabelle Lévesque (cf. "Que lire cet hiver?", in La Quinzaine sorti n°1204, 15 novembre 2018).
*
Les anthologies qui proposent un focus sur un poète à découvrir dans une contextualisation biographique et sociologique fonctionnent de la même manière. Les extraits d’œuvres sont placés dans le moment et le lieu de leur production. Cet éclairage n’est pour autant jamais envahissant. Le lecteur est ainsi libre d’apprécier les textes proposés sans que les éléments d’une biographie qui prendrait facilement le pas sur la portée artistique des textes ne viennent perturber la portée sémantique des extraits.
Il est tout à fait admirable de feuilleter le volume consacré à Alain Breton. Un tour d’horizon de son œuvre qui regroupe les plus beaux de ses poèmes nous permet d’apprécier la richesse de son œuvre, mais aussi la trame épaisse de son parcours, car il est aussi critique et éditeur. Il est également possible comme pour chaque auteur abordé de suivre l’évolution de ses productions, leur édification, de percevoir les changements et la logique qui sont à l’œuvre dans la genèse de la globalité.
Et nonobstant le fait qu’Alain Breton est aujourd’hui le directeur littéraire de la Librairie-Galerie Racine, il est aussi un poète extraordinaire qui offre au langage une amplitude servie par des images puissantes et inédites. Le choix de mise en œuvre est chronologique, et on découvre autant de poèmes en prose que de textes versifiés.
Tu gis en Provence
dans les palabres des fleurs
Rincé
par la lumière
Tu monnayes
Le poignard des anges.
Des vers brefs, vifs et qui n’en travaillent pas moins toute l’amplitude du signe. Les antithèses servent des métaphores inédites, et le lexique pourtant usuel déploie toutes ses potentialités. Une langue revivifiée, renouvelée, retrouvée en somme, parce que cette poésie nous offre de nous l’approprier à travers la libération d’une multiplicité d’acceptions. 462 pages dont on ne peut que se réjouir, et qu’il est bon d’avoir près de soi, pour s’immerger dans la magie des vers d’Alain Breton.
Carole MESROBIAN (cf. "Les anthologies à entête des Hommes sans Épaules" in recoursaupoeme.fr, 4 janvier 2019).
*
Il triture les mots, il les essore, les malaxe, les compacte jusqu’à la fibre intime. Infinie recherche dans un subconscient qui se rebelle mais qui finit par donner en juste offrande ce que la raison ne voulait avouer en pleine lumière. La poésie s’y terre : elle y devient humus, union de molécules langagières empreintes de rencontres, de ferments.
Alain Breton nous offre ici une anthologie sécrétée au long des années en une somme impressionnante. Plusieurs recueils, des textes révélés, agrémentés par une préface de Paul Farellier, une remarquable mise en mots de Christophe Dauphin, un hommage à la justesse de Paul Sanda. Lire en fin de volume sa bibliographie (y-compris celle parue sous le pseudonyme quelque peu rocambolesque de Jacques Aramburu) est chose intrigante, pour ne pas dire impressionnante, tant on sent que la poésie a été pour cet auteur, non pas une compagne dilettante ou un exercice de style, mais une véritable manière de vivre.
Poète, écrivain, éditeur, galeriste, peintre, amateur de musique, tout à la fois rigoureux et un peu bohème, discret mais pourfendeur de médiocrité, riche en paroles et en pensées dans la pénombre de son antre du quartier latin où palpitent des milliers de livres, manuscrits, toiles, articles et incessants projets artistiques ou littéraires, Alain Breton nous bouscule et nous déconcerte. Il n’est pas aisé de résumer ces 477 pages d’une œuvre poétique qui se décline tout à la fois en vers et en prose. On y ressent les racines des surréalistes jusqu’à ce concept contemporain d’émotivisme : l’émotion serait-elle finalement, au-delà de toute technique du langage, ce qu’il y a de plus natif (dans le sens rousseauiste du terme), de meilleur en nous ? La créativité ne pouvant se passer d’intuitions, de fusions impromptues, de frottement d’idées originales à la synapse des mots, à la faille de la matière verbale qui, elle-même, surprend leur créateur. On y ressent une perpétuelle quête d’un plus loin, d’un plus intime, dans le chaudron d’une expression écrite que les druides n’ont pu autrefois exprimer.
Trois facettes, au gré desquelles s’épanouit une trace finement ciselée et singulière, ont particulièrement retenu notre attention. La première est cet attachement viscéral, pour ne pas dire charnel à sa mère, dans Le long du fleuve Orénoque. L’auteur assiste à sa propre naissance, se tutoyant lui-même ou donnant voix aux lèvres de la parturiente, comme si ces lignes brûlantes étaient issues de l’aimée :
On ne cesse de vider le ventre
On donne l’assaut aux couleurs
Que l’on hisse les yeux !
Sans répit
pour baiser un peu ta tête violente.
Puis, prenant la parole :
Ô ravin-mère, initiale ligne de feu,
je cherche ma voix dans tes déluges,
je reste seul dans mon visage
pieds nus – sur le vacarme originel.
Indicible chronologie de l’être : au forceps, une traduction langagière de la gésine et du cri primal.
Par ailleurs, l’itinéraire d’Alain Breton est sans cesse ourlé d’humour. Non par calembours, mais par sens du cocasse, de la chose inversée, du retournement de la situation. Pour rassurer le fakir : en fait, c’est celui-ci qui nous rassure sur son tapis clouté par les choses insignifiantes de l’existence.
Lorsque je commence un dessin, que le jour faiblit et que je veux en finir, je lui fais subir des pressions, je viens à le menacer pour qu’il se termine tout seul.
*
Parfois l’enfance me rattrape, ses bateaux pirates, les cales à esclaves, l’ourlet des ponts, le mât qui laisse échapper un fanion, tout le bouquet des nuits et la grosse fée qui fait une scène.
*
Au fil du temps, les poches ont appris à lutter contre les invasions clandestines. Poches retroussées, détroussées, soumises à fouilles et interrogatoires, remplies par les courants des rivières souterraines.
Mise en perspective et coloration particulière à mi-chemin entre onirisme, originalité d’esprit et ironie. Comme l’écrit Henri Rode (cité par Christophe Dauphin dans sa Postface) : Alain Breton est épieur d’absurdie dans le quotidien déconcertant, tout de discrétion. Félin qui se garde d’être ébloui dans le jeu de miroirs érotiques.
Ce qui nous donne un marchepied vers la troisième facette (parmi tant d’autres possibles, cette note de lecture n’étant nullement une exégèse) que nous aimerions évoquer ici. Celle où le désir se fait lumière, en toute délicatesse :
Tout
ce que tu touches
fait l’amour.
Même
l’ampoule
où brûle un butin rose.
Ton ventre
arrange l’ombre
de la chambre.
(…)
Qui t’appelle
s’apaise.
Moi,
novice
devant la beauté
La difficulté d’une recension en poésie, c’est de s’arrêter devant les contingences de la page. Qu’il nous soit finalement permis de citer Paul Farellier devant « Lentement, Mademoiselle » d’Alain Breton : averses pyrotechniques où chaque image-fusée, à peine éclatée, est bousculée par la suivante (…) : la femme gouverne les éléments dont elle est la puissance salvatrice.
3Infimes prodiges3 d’une profonde et très humaine poésie.
Claude LUEZIOR (in revue Traversées, Belgique, 26 mars 2019).
*
Qu’y a-t-il de commun entre les œuvres de jeunesse où l’on découvre la poésie et celles de la maturité quand on maîtrise l’outil poétique, le vers ou la prose ? C’est que réunir en un seul volume l’œuvre de toute une vie est chose complexe. Et pourtant, Christophe Dauphin s’y emploie, s’agissant d’Alain Breton que les plus anciens parmi nos lecteurs connaissent pour avoir été l’un des animateurs de Poésie1… Reste alors à passer en revue les plaquettes constitutives de ce volume (de plus de 460 pages, si l’on ne compte pas la table)…
Les proses de Tout est en ordre, sûrement qui datent de 1979 font comme un fouillis, comme un désordre à l’image du monde et ce n’est pas le portrait de Ray Sugar Robinson qui viendra me démentir… Les poèmes (brefs) de la deuxième suite (parfois réduits à un vers) sont sertis d’allusions et disent parfaitement la sensualité de cette musique. La troisième suite est écrite en vers…
La deuxième plaquette qui s’appelle ça y est le monde ! (1990) commence par une suite intitulée Le long du fleuve Orénoque, dédiée à la mère du poète. C’est le récit d’un accouchement distancié, qui ne va pas sans émotion : « J’ai peur de n’avoir été, de n’être / qu’une preuve insoutenable qui saigne / définitivement » (p 50). La deuxième suite, La Terre encercle les oiseaux, commence par ces vers « Ma mère, tu le sais / je suis toujours la grenouille de sang entre tes cuisses » (p 51) : tout est dit dans ce distique. La troisième suite, Planètes, est sans doute la plus personnelle, car constellée de souvenirs intimes (comités, dédicaces, jazz, poètes…) ; mais je préfère les poèmes d’amour ou de tendresse à ceux écrits la gloire du sport : je sais bien que j’ai sans doute tort mais je suis ainsi !
La troisième plaquette est intitulée Juste la terre. Elle s’ouvre sur un poème intitulé « Montagnard » : pourquoi faut-il qu’il me rappelle les photographies de Henri Didelle ou les poèmes de maints marcheurs. Ça ne manque pas de nostalgie comme ces premiers stylos aux quatre couleurs (p 112). Alain Breton a l’art de la sentence mais cela ne va pas sans mystère : « même si quelques ruelles, de moins savantes, / embrasent encore, le matin // un chien, un coq, un lézard, / le temps qui compte ses boxes, ses visages » (p 114).
La quatrième plaquette est intitulée Bivouacs, elle date de 1992. Et une part d’un certain surréalisme est présente, en 2018, cela fait une cinquantaine d’année qu’un certain André Breton est mort…
Avec Maison-Buffle (1993), Alain Breton est à l’affût de ces infimes prodiges qui donnent son titre à ce volume de mille cauchemars ou de mille rêves. Son réalisme est à l’image de ces nuages qui ne sont que le rapprochement de deux réalités très éloignées …
Le sixième recueil intitulé Messe noire des vagues a été publié en 1999. Ce sont des histoires de pirates en vers ou en prose. La fantaisie y est présente : « De Zanzibar à Chandernagor […] / […] il faut déterrer / la botte de sept lieues / » (p 179). Histoires de pirates : Alain Breton fait preuve d’une forte maîtrise du vocabulaire de ces contes et histoires, des us et coutumes des boucaniers, des grands mythes…
Le septième recueil intitulé Une chambre avec légende (1999) est marqué par l’amour fou et l’émerveillement, accentués par la brièveté des poèmes qui confinent à des notes prises à la volée : « les tables sous les chaises rejoignent le / cimetière des éléphants » (p 205) font parfois penser à celui qu’écrivait un demi-siècle plus tôt (« Je te vertige, je te hanche ») Henri Pichette.
Dans le recueil suivant (Pour rassurer le fakir, 2000), sous-titré Carnets d’atelier, on peut deviner que ce fut écrit après la visite d’un atelier de peintre. Certes, le mot dessin, la lumière qui pare les corps et la recherche fondamentale sur les peintres le disputent à la présence des sportifs (qui est Attila Zopf ?). Mais très vite, il s’agit plutôt de textes d’ateliers, les sportifs ne sont là que pour le rappeler : le texte (poème) sur Evariste Galois (p 237) n’est là que pour le prouver… Mais la présence de portraits fait penser à l’atelier des peintres, et c’est le début de belles histoires au surréalisme marqué dont l’humour n’est pas absent. A moins qu’il ne s’agisse d’un atelier de textes (???) dans lequel Alain Breton expérimente des sujets différents ???
Dans Le Chasseur de Rivières (2004), Alain Breton a une vision très précise : « Je ne sais pas changer la litière / des orties » ( p 279) ou « ils te donneront / la prophétie des fanges » (p 282), ce qui ne va pas sans une certaine obscurité…
Brûlant sombre (2008) est une ode au jardin traversée par les morts (p 296) ou par le souvenir de Rimbaud (p 298). C’est écrit en dis(ti)ques sauf dans la troisième suite où le lecteur est confronté à la prose…
Des poèmes et des proses de 2011 (qui constituent la partie suivante de l’ouvrage), je relève ces lignes : « … La poésie m’a poussé à faire émerger les problèmes liés à mon identité, la prose m’a permis d’en rire ». Je ne sais pas si ces mots s’appliquent à l’ensemble de l’œuvre complète, mais ils révèlent un bel exemple de clairvoyance.
Les éperons d’Eden (qui datent de 2014) commencent par une prose qui est une ode au père, Jean Breton. Et ça continue par de brefs poèmes en vers qui, mis bout à bout, font comme un tombeau à la gloire de Jean Breton. C’est émouvant et un bel exemple d’amour filial : ainsi ce poème consacré au tueur de doryphores du jardin de Nibelle (p 362). Cela ne va pas sans quelque aspect obscur (mais c’est sans doute le propre de la poésie) comme dans ces poèmes qui ouvrent la deuxième suite (Une poignée de nuit) : « La mer délassée / sur les lèvres de Pénélope » (p 347). Même si l’on sait ce qu’est la mort tout en ignorant quel sens donner à ce qui est une absence éternelle…
Un livre qui valait bien la peine que s’est donnée Christophe Dauphin. Des caractéristiques de cet ouvrage, je veux signaler que le surréalisme n’est pas mort et le lyrisme contenu. Un livre nécessaire dû à Paul Farellier (qui en a signé la préface), à ce même Christophe Dauphin et à Paul Sanda.
Lucien WASSELIN (in recoursaupoeme.fr, 29 mars 2019).
*
Ce volume de près de 500 pages nous rappelle, s’il en est besoin, l’intense activité d’Alain Breton au service de la poésie. De nombreux poètes ont croisé sa route et lui doivent leurs premières publications. Son nom est associé à la célèbre revue Poésie 1, ainsi qu’à la Librairie-Galerie Racine et Les Hommes sans Épaules. La poésie qu’il défend est une poésie vivante, charnelle, accessible, aux antipodes d’un certain hermétisme.
Infimes Prodiges, présenté par Christophe Dauphin et préfacé par Paul Farellier, regroupe plusieurs recueils dont Tout est en ordre, sûrement (1979), Juste la terre (1991), Bivouacs (1992), le très émouvant Les Éperons d’Éden (2014) et, peut-être l’un de ses meilleurs livres, Maison-buffle (1993), publié chez Cheyne sous le pseudonyme de Jacques Aramburu : Elle a des climats, - ses sonnailles, - ses alvéoles, - ses fruits serrés dans le satin – et puis son bon vent d’étoiles – qui va et vient, - change de musique – et d’arbre. – Tous les quatre matins – la maison entre dans la couleur - Dans la maison – les bruits ne s’arrêtent jamais. – Ce sont des bruits intimes, - des bruits de confiance, - Chacun d’eux a la clé du monde, - un instant.
Jean-Christophe RIBEYRE (in revue Verso n°177, juin 2019).
|
|

|
|
Dans La Revue de Belles-Lettres :
Ces poèmes en prose, récemment révélés au public, constituent non un recueil mais un livre fortement unitaire, qui frappe tant par la hauteur de son inspiration que par la puissance et l’originalité de son écriture. Il y a comme un vrai bonheur à voir cette poésie – dégagée des modèles de l’actualité littéraire – reprendre en charge la langue exténuée que traînent bien des ruisseaux contemporains et la vivifier soudain, redonnant aux mots l’ampleur et le souffle perdus. Plus encore : la profondeur et l’élévation se tissent d’un humour sans mépris et l’équilibre s’établit, miraculeux, entre la gourmandise lexicale et le sensible du monde.
Nous allions décontenancés face aux bourgeons de la vigne, aux cerises dans les arbres, vertes comme des sauterelles. Même la pierre voulait agrandir la toge empire des vieux lichens. Le printemps est une marche trop petite pour la gloire, le cycle des soleils, une vieille au manteau trop étroit pour le culte.
Venez enfants druides, venez célébrer ce que les oreilles écoutent mais n’entendent pas ! Cueillez en paix ce que les paroles promettent de fraîcheur ! Redites comme la marguerite pigeonne au champ, le chevreuil à la fontaine de vos yeux et comme tous palpitent d’or sous la lune !
(Extrait de « Verdure »)
Le poète, on le voit, parvient à imposer à la force du verbe une confrontation assidue au réel. Ce réel, quel est-il pour lui ? À la question, cette note, nourrie d’une lecture attentive des poèmes, mais aussi d’entretiens avec leur auteur, tente une réponse qui ne soit pas trahison. Ce qui est réel, c’est l’existence d’un dehors, d’un extérieur donc, mais si proche en définitive, si disponible, tellement à portée des sens et, croirait-on, du sens, qu’il lance paradoxalement une invitation permanente à s’y tenir, à s’en faire un intérieur. Y coexistent mesure et démesure : ainsi une Méditerranée, dehors « infini et clos », à l’opposé d’un Océan, dehors « des vertiges et du vide », avec lequel le poète entretient une complicité toute bretonne.
Accordées à cette perspective, vie du dehors et vie intérieure ne vont cesser de s’interpénétrer. Dans le poème intitulé « Sillon », le paysage vu du train et la page d’écriture du voyageur ne cessent de se superposer, jusqu’à y découvrir leur impossible perméabilité – entendons tout à la fois l’impossible dissolution de l’un dans l’autre, comme l’impossible clôture entre les deux : « Folie que vouloir retenir les âmes sur des rails terrestres ! »
Cependant, le dehors, comme tout être vivant, résiste à la prise de possession. Les choses ne se laissent pas faire. Le poète nous initie à l’art de composer, au sens le plus tragique du mot : il faut délocaliser ses états, se fragiliser. Non pas tourisme avec garantie de rapatriement, mais exil sans retour, entraînant perte de repères et lente déréliction. Au bout, encore des marches à descendre, le déracinement final d’un soi, présent certes, mais dont rien ne peut plus assurer qu’il soit distinct du monde : « Aucun lien ne peut m’arracher aux forces du provisoire, à son absorption dans le tourbillon noir de la cendre. » On relève cette singulière et impressionnante figure : « Il monde ! Il pleut ! Parole impossible à prononcer… » d’où se dégage l’effroi d’une impossible extériorité au monde. Rien ne nous en distingue, nul endroit où se tenir et le tenir sous le joug d’une observation. Nous voici dans cet état que le poète appelle « néantitude ».
Parvenir à soi-même, faire cesser cet exil, se rendre extérieur au monde ? Seul le permettrait un saut dans l’absolu. Mais ce livre n’en sent pas le vouloir. Au contraire, c’est avec une manière de tendresse et un humour des plus attentifs que le monde et l’humain sont sillonnés : que ce soit sur le pavé des villes ou à travers les terroirs, un Ulysse, évidemment rusé, parcourt cette « néantitude ». Balayeurs, clochards, piétons sans visage, commerçants, ouvriers, couturières… tels sont les Lotophages, Cyclopes, Lestrygons ou Sirènes de notre appartenance au dehors, de notre résidence forcée en quelque sorte, et voici donc, non sans étonnement, que s’en découvre « l’usage » ! Il y a là, pour le regard et l’écoute, une faculté merveilleuse que le poète appelle « l’âme » dans le beau poème « Résistance à la négation », que nous citons intégralement :
Qui veille adossé aux parois du jour ? Qui considère la nuit avec espérance ? Qui forme les emplois inédits de ce que nous sommes et dont il fait soif ?
Qui fait silence et suit en arôme les contours d’une parole ? Qui garde une disponibilité suffisante pour s’immiscer dans le labyrinthe de nos gestes ?
L’arbre livre au soleil le battement des saisons. La pierre aux océans, la courbe et la langueur de vivre. Tous offrent des réponses et des questions aux réponses. Qui s’en approche et les écoute ?
Qui tourne et fouille notre obscurité ? Qui cherche un salut dans une langue oubliée, une promesse derrière l’entêtement ? Qui voudrait un rapport neuf avec ce qui ne meurt pas ?
L’âme, notre fierté, notre passe-droit. Unicité sans encoche, fraternité aux enroulés stellaires. En elle, les fragilités de la vie sauvage, la torpeur du cristal, la harpe éblouie de l’aurore, la fierté du sel, l’appétit de nos villes, le rire écume des océans.
En l’âme, le miracle du livre unique. Une langue nouvelle, avec une grammaire, des voyelles et un vocabulaire neufs, parfaitement éternels, parfaitement recevables par l’autre. En l’âme, l’homme debout, droit comme un soleil.
Pourtant, en dépit de ces moments de gloire, la vie intérieure est toute d’opposition et, à toute tentative de possession, dresse autant d’obstacles que le dehors lui-même. Ce cocon n’est pas prêt à se rendre, à se soumettre à cette absence de bord, à la perte de soi-même :
Chaque matin, je réapprends qu’un autre que moi existe. Il serait ni chose, ni bien comestible, mais un vide insondable au cœur, irréductible à l’intelligence.
Par le jeu des millénaires, quelques modes de coopération me furent enseignés, un petit pécule remis pour tout échange entrepris dans les règles de l’art.
Mais que sa parole soit prière ou bariolure, toujours je la reçois avec violence. L’autre figure une lutte avec un dieu impossible. D’homme, il ne porte que les cendres et sa mort annoncée.
(Extrait de « Éloge funèbre »)
La vie intérieure, aussi sauvage que le dehors, recèle une violence inouïe, une capacité à renier tout ce qui n’est pas elle-même. Ulysse encore en représente la figure emblématique : tellement marqué, brûlé dans ses intérieurs par le voyage au dehors que, rendu à lui-même en reposant pied sur Ithaque, il n’est plus capable de se gouverner, de demeurer auprès des siens, d’apprivoiser le quotidien. Justiciable des dieux seuls : autant dire de personne !
À rapprocher ces deux électrodes que sont le dehors, infini et clos, et la vie intérieure, il y a pour le poète, non seulement une forme d’aventure, de recherche d’inconnu, mais un choix de vie, qui relève d’une foi, d’une confiance en la présence/absence de l’Être-Dieu pour l’homme. Très significatif d’un engagement chrétien, ce verset de Saint Paul placé en épigraphe : « Lui, ne retint pas Dieu en lui. Au contraire, Il s’anéantit homme parmi les hommes. » Une allégeance « au monde invisible » est revendiquée. Même s’il ne semble qu’« injustifié, inutile, avec un amour qui sonne en nous comme une injure », Dieu étaye et promeut : « Dieu travaille à m’inventer dans la rude étoffe des êtres et des choses ».
Un grand voyage de la pensée où se révèlent puissance d’écriture et nouvelle maîtrise du poème en prose.
Paul FARELLIER, in La Revue de Belles-Lettres, n° 2-4 2009.
|
|

|
|
12 décembre 2013
Dans Rimbaud revue
"Auteur de quelques vingt-sept ouvrages de poésie, prose poétiques ou souvenirs publiés depuis un quart de siècle, Jacques Simonomis n’attendait qu’un commentateur pour que son œuvre connaisse vraiment le rayonnement auquel ses qualités humaines la destinaient. C’est maintenant chose faite par la grâce d’un Christophe Dauphin particulièrement bien inspiré, qui analyse, ausculte une par une et dans tous les domaines les qualités et l’évolution d’un langage haut en couleur, chargé de tendresse humaine et d’authentique révolte face au monde que nous connaissons. Simonomis le sensible nous apparaît plus accessible encore, à travers Sa vérité qui n’est pas celle de tous, son rythme de poète qui casse et brise les tabous, son humour, parfois grinçant, qui met au pilori et les hommes et leurs œuvres, sans oublier le fondateur et l’animateur depuis une bonne décennie du fameux Cri d’os, ouvert à toute œuvre de qualité… Complété par de larges extraits de l’œuvre de Simonomis, cet ouvrage est un tout qu’on ne peut négliger lorsqu’on se penche sur l’œuvre du fondateur du Cri d’os."
Jehan Despert (Rimbaud Revue n°27, 2002).
|
|
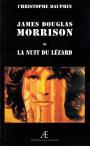
|
|
Critique
Pour les amoureux décadents des Doors, voici un essai de plus sur le parcours de vie de Jim Morrison. Et pourtant non… Ce qui fait la force exceptionnelle de ce livre de Christophe Dauphin, c’est d’avoir su mettre en lumière l’originalité de l’œuvre poétique de Jim et la complexité du personnage. C’est vrai, et Dauphin l’écrit fort justement, l’œuvre de Morrison « dépasse le cadre des clichés du pantalon moulant de cuir noir ou de la beuverie, pour atteindre et canaliser l’essence même de la vie : la poésie, par-delà le visage d’ange et la réputation sulfureuse ». Morrison et Rimbaud, dans l’éternité, doivent s’entendre.
Jean-Luc Maxence (Les Cahiers du Sens, 2002).
|
|

|
|
Lectures critiques :
Déesse facile par la rose et la ruse
Surgie fendue d’entre les songes
entre tes seins et moi tous les pilleurs d’épaves
C’est toi la femme qu’un nécromant sortit
de sa cornue
durant l’émeute des oiseaux
J’appréciai sur ma peau tes couchers de soleil
Je n’ai aimé que toi puis j’ai brûlé les draps
Chaque recueil de poèmes d’Alain Breton étonne et détonne sans effacer un sentiment intime de familiarité. L’explosion des mots, non sans sagesse, révèle des alliances insoupçonnées.
Donc j’ai fait civilisation
j’ai fait beauté au seul défaut de l’herbe
j’ai fait rêves pour enrayer la pourriture
j’ai fait splendeur et bassesse
j’ai fait soleil mystérieux de ma face
j’ai fait éternité de mon absence
mais je n’ai pas trahi
Tout peut être dit suggère Alain Breton. Encore faut-il connaître la symphonie des mots pour en faire une fête salvatrice, non qu’il y ait quoi que ce soit à sauver de personnel mais la beauté, la liberté, l’amour… des puissances sans doute éternelles en soi, indépendantes de ce qu’en font les êtres humains avec leur expression sans cesse contestée.
En libérant les mots et les sons du carcan des préjugés et conditionnements, c’est l’espace même de l’être qui se désencombre. De nouveaux mondes apparaissent. Ils sont internes, externes, ni l’un ni l’autre. Le défi ultime, celui qui nous réintègre à notre propre nature, appelle la restauration d’un rapport secret au son, au mot, à la langue pour abolir les temps ou jouer avec, suspendre les causalités trop linéaires, choisir les tourbillons qui en leur centre préservent un lieu exquis.
Pendant qu’allaient et venaient
les Bönpos du mont Kailash
j’ai laissé quelques transes
chez les poneys des steppes
négligé des saillies pour la part du Diable
Compagnon des corsaires
j’ai capturé des îles fraîches
pleines de nèfles et d’oiseaux
chanté sous des nuages splendides
près des cercles respirants d’Asger Jo
nagé aussi dans l’eau de Lyre
en piétinant les herbes récitées
et demandé l’hospitalité au lièvre qui court
sans jamais s’arrêter
Beaucoup de poèmes apparemment réussis ne franchissent pas avec succès les lèvres. Dits sur scène, ils tombent lourdement au sol sans atteindre et réveiller les esprits de ceux qui entendent. Lire les textes d’Alain Breton à haute voix, donner vie aux images, permet de pénétrer des états nouveaux où la distinction entre le rêve et la réalité s’estompe.
Poètes je suis venu voir vos boiteries les miennes
les broderies dans vos douleurs
Le saviez-vous
je vis poète je mange poète je lis poète
Jadis j’ai été décoré des ordres
du rire et du sanglot
aussi de la rivière fabuleuse
des cris de plaisir de l’hirondelle
Rémi Boyer (in lettreducrocodile.over-blog.net, février 2024).
*
J’ai cherché des passages, des périodes d’élection pour les citer dans mon texte, mettre en exergue les traits les plus percutants, les plus emblématiques et j’ai trouvé tout le livre. « Je ne rendrai pas le feu ». Il dit vrai, Alain Breton dit vrai, il ne l’a pas rendu ! Il l’a séduit, mûri, étayé, érotisé, soumis aux dents de l’étreinte, aux processions grimpantes et chutant de l’imaginaire et contraint à produire son ultime ou premier aveu : tout est le rêve. Cependant… C’est bien moi pourtant ce portrait des frayeurs.
L’ouvrage s’ouvre sur cette quête, à la fois affirmation et doute persistant de l’auteur sur son identité humaine et poétique. Il s’interroge sur l’instabilité du jour, des petits jours, de la connaissance et du lien amoureux. L’interrogation apporte-t-elle le bonheur, le malheur ? Le lien ténu du regard sur l’amour, auquel on reste suspendu – par la bouche, autrement dit par le baiser et le dire - comme une araignée à son fil, pendule du rien au rien, d’un sursaut, d’une esquisse au peut-être, au sans doute. Comme d’habitude tu ne dors pas / Les heures qui passent exhument la lumière / Écoute la pluie peut-être / quelques gouttes de sa gloire L’insomnie renvoie à une totale solitude.
L’insomnie sans fard ni fioriture, ni arrangement tonal, l’entêtante, la muette accompagnatrice engendre en lui une vierge et souple et durable et repentante mélancolie. Laquelle dépose sa morsure livide, péjorative, dans tout ce qu’elle sonde. Ainsi comme dans le poème de la page 16 : J’ai vu tous les oiseaux lassés par mes chansons / et mes amours abandonnées / puis mes bateaux qui ne partent jamais, que le lecteur le moins éclairé ne peut accueillir que par dénégation, car tout ce qui fait figure de liste d’échecs ici est la substance même, les sacs d’offrande, les sacs poétiques, les muscles, la chair d’or, les égards, les désirs hyperboliques du poète. Tout est là, en excès ! Un sacrifice sublime, initiatique de tous les temps ! Et comment ne pas mentionner comme deux thèmes, deux inspirations liées par transparence, cette phrase tirée de la correspondance de Kafka : « En tout, je n’ai pas fait mes preuves », dans les deux cas comme un acte de mortification, doux et dur, une posture d’inclination devant la révélation, l’ange jaloux et – en dépit des riens, en dépit de tout – annonciateur de l’œuvre créatrice ! Demeure l’enfant de l’insomnie, l’enfant qui sait, qui ressasse ce qu’il sait dans l’indomptable silence intérieur, le passé, sans date, désaffecté et figé. Mon Dieu - renvoyez-nous dans les tétons qui causent - dans la langue du chien - Faites que l’on fâche - faites que l’on morde mais que l’on aime - Donnez-nous les poèmes les plus drus - les vers les plus féroces - les éclats dont mourrait même le feu. Moment d’arrêt où les frayeurs, déjà évoquées, se précisent, se concentrent. Où l’une d’entre elles, peut-être celle qui liait le tout, va révéler son identité : l’indifférence. Absence à l’être, subie ou suscitée ?
Mais là, surtout, dans l’oraison qui s’élève au milieu des vertiges, les deux ne se confondent-elles pas en une ? En nous aussi quelque chose se ralentit, frôle une fin, telle ou telle autre pressentie, se fixe. On éprouve la puissance et l’humilité envoûtante des mots de sa prière. L’insomnie du poète n’était-elle pas un autre visage de l’indifférence ? Nonobstant tous ces contretemps, Alain, rapide, alerte, rebondit sans cesse, dribble pourrait-on dire (Alain est footballeur) devant tous les événements de l’existence réels ou moins réels. Qu’importe, la vie passe aussi par un jeu de jambes habilitées à gérer les passions, l’angoisse, l’adrénaline, le plaisir. J’ai rencontré John Coltrane et Nelson Mandela… J’ai croisé Didon l’effileuse infirmière trans-sexe… J’ai vécu dans un lit qui foisonne… J’ai prié Tatanka Iotake des Unkpapa… J’ai su éviter les tueurs à gages… S’animent, s’électrisent dans le champ textuel toujours en puissance d’émotion, d’inépuisables et orgiaques mutations.
Les rêves d’Alain Breton, sans égard pour leurs nuits blanches, s’assemblent, se fertilisent. Il y en aura pour toutes les obédiences et dramaturgies féminines, pour la lune en déshérence et pour la fin du monde ! Qui pourrait refuser sa part, laisser son butin entre les lignes, quand on joue, quand on ruse et que la mort elle-même est ludique ? Et s’il revêt toutes les panoplies, trophées de rêves et de pays lointains, s’il nous enivre de la prolifération des lieux, c’est parce que ivres nous serons plus enclins à frayer avec lui, maître et gardien invisible, insoumis, du questionnement. On le verra souvent, le poète use de dérision. Mais sa dérision est pleine de sentences et de raisons naturelles et couvre toute la distance entre le ciel et l’abîme. Elle connait et illustre les voyages, pose ses jalons sur l’histoire, la géographie, anticipe les lointains et se lie avec le prochain. Et l’amour est-il sauf de la raillerie ? Tient-il sa place au milieu des monstres et des travestis, des prouesses, des litiges de la magie, des transferts et mutations d’époques et de noms, dans la grande fête foraine de la Poésie ? Sauf ? De toute évidence : oui. Sauf, par-delà les apparences ? De toute évidence : non. Et pas seulement parce que l’amour est mortel, qu’il porte en naissant des germes de mort, et qu’il lui est imparti une certaine durée, un segment de vie, mais parce que l’indifférence des êtres pensants est toujours… reconductible. Je n’ai aimé que toi puis j’ai brûlé les draps Mais ne le cherchez pas où vous l’avez trouvé. Alain est doué d’étranges organes de locomotion qui le mènent d’éclipse en éclipse, de l’agonie à la vie, de prosodies, de fééries en dogmes cataleptiques et de la vie encore à des morts si douces, si nubiles. À ces dernières aussi, Alain Breton, indemne de chants secs et de superstition, prodigue des « je t’aime ». Peut-être que je ne conviendrai pas / à la Grande Calèche / C’est une chose la confiance de la mort / ses engouements soudains / pour les plus jeunes même.
Lueur des pas perdu, la deuxième partie du livre s’ouvre sur un manuel, un manifeste pratique de l’amour du monde réservé aux enfants des prophètes ou des dieux olympiens tant la minute de conciliation, de rapprochement sorcier avec la vérité est d’envergure et où, en quelques lignes, le remord, le scrupule, la matière peccable du sexe et des assauts d’universalité et d’intimité sont renversés. Tu me donneras le jour espiègle. J’ai du temps à perdre, tu m’apprendras à danser. Tu me persécuteras ; tu t’attendriras sur ma façon de tuer. Tout ce qui sera énoncé de plus essentiel désormais fait mystérieusement figure de dérive, use de paradoxes si savants, si supérieurs que le rire comme les larmes nous écorchent, dérangent la structure, l’harmonie et la peau du visage sans jamais rien remettre à sa place.
C‘est de ces visages décalés que nous le lisons. Ici, la décadence du sens, la blessure symptomatique des images illustre la révélation, c’est-à-dire l’instant d’élection du poète, sa désignation, sa proximité avec le verbe. Il n’y a pas de ballotage, de tremblement d’approximation, de foi perdue, indue, d’hésitations chiches ou malencontreuses : Alain Breton est le poète élu ! Son courage est double et triple, maitre et victime de soi et des événements, sa bravoure, sa bravade rieuse se retirent ou s’engouffrent dans la douleur et traversent tous les obstacles, tous les barrages du monde souffrant. « Lueur des pas perdus », des pas qui savent ce qui vit et ce qui meurt, qui redistribuent sans fin l’équilibre sur un fil de peur, sur un fil qui a peur et transmet cette peur comme offrande à celui qui le défie.
C’est cela l’héroïsme du poète, ce mystificateur / mystifié dans un corps de conquête, qui invente infatigablement des armes d’apprêt, d’appoint, dans le danger, l’incohérence, l’incertitude de la magnificence et du magnétisme de l’être. Ô halo de la grandeur - comme chez Phidias le Zeus d’Olympie - régnant sur la dynastie des hamsters anxieux - Ô temps désarticule donc ton rugueux atelier - ta mémoire voleuse d’oublis - Crée une nouvelle chevalerie des minutes - Protège nos égéries- dont la lumière s’allume en marchant - et les chiens des brumes - nos maraudeurs
Odile COHEN-ABBAS (in revue Les Hommes sans Epaules n°58, octobre 2024)
*
En choisissant comme prix 2024 le recueil d’Alain Breton, Je ne rendrai pas le feu, remercions l’Académie Mallarmé de mettre à l’honneur un pan méconnu de la poésie française : un courant qui n’est pas né de la dernière pluie, avec ses poètes « à hauteur d’homme » des années 70, tournés vers le quotidien, la simplicité, usant d’un humour en demi-teinte, et qui compta parmi ses membres des Jean Rousselot, Yves Martin, Claude de Burine et bien sûr, le père d’Alain, Jean Breton. L’apport d’Alain Breton à cette histoire déjà demi-centenaire est d’ajouter à l’humour la dérision, à la simplicité la fantaisie onirique, ainsi qu’une belle tranche de surréalisme et un fumet de mélancolie produit par l’émerveillement du regard.
Relisant ce recueil, j’ai également noté un trait propre à notre poète : le goût de la fraternité. En interpellant tant de poètes à travers leur mise en exergue, c’est tout une génération qui défile dans la lucarne des pages ! Une génération et un lieu : la Librairie-Galerie Racine de Paris. J’y reconnais Paul Farellier, Elodia Turki, Odile Cohen-Abbas, Guy Chambelland, Henri Heurtebise, Sébastien Colmagro, Yves Mazagre, Gabrielle Althen, Christophe Dauphin, Serge Brindeau et tant d’autres.
Parlons maintenant du recueil. Il s’agit d’un album de voyages où le poète nous partage ses expériences et ses rencontres au sein d’un immense présent (une plaine) qui rassemblent des pharaons, des poneys sauvages… et aussi la rue Monge « car je suis seul souvent / comme je descends la rue Monge / comme je parle longuement à la pluie ». Les voyages proviennent des lectures de l’enfance avec leurs Indiens et leurs aventures, ou des rêves apparus en tournant les pages d’un livre d’histoire, ou devant les portulans d’aventuriers perdus, ou encore (j’imagine) après la lecture distraite d’une presse scientifique.
De ces poèmes, il ressort un sentiment de paix espiègle, celle d’avoir chassé les vanités du monde pour privilégier ses paysages intérieurs où les rêves d’enfant trouvent grâce et place. Et vient alors cette conclusion riche d’une fraternelle sagesse : « Ami ne t’inquiète plus / Tout est élucidé / Tout s’excuse ». Cette promesse, de poète, il la tient d’un « Moi / issu de toutes les absences ». Mais concluons en revenant aux Indiens d’Alain Breton.
Voyez comment ils traversent les poèmes un fois « debout sur le cheval », un fois tapis en train d’écouter « le discours des bisons dans les hordes fleuries de myrtilles ». Si vous vous approchez de cette petite tribu, avec prudence cela s’entend, regardez celui qui se tient au milieu, le ni-costaud, ni-malingre, mais avec un sourire qu’on n’oublie pas malgré ses peintures de guerre. Ne trouvez-vous pas qu’il ressemble à…
Pierrick de CHERMONT (in revue Possible, octobre 2024).
*
ALAIN BRETON, POETE VOYANT, PRIX MALLARME 2024
Né en 1956 à Paris, Alain Breton, poète, éditeur, critique littéraire, a reçu le prix Mallarmé 2024, l’une des plus hautes distinctions en matière de poésie en France, le samedi 9 novembre 2024, à Brive, pour son livre de poèmes Je ne rendrai pas le feu, paru aux Éditions des Hommes sans Épaules.
Alain Breton est poète, critique littéraire et éditeur. Après avoir été éditeur à l’enseigne du Milieu du jour de 1989 à 1996, il codirige à Paris, depuis 1996, avec Elodia Turki, les éditions Librairie-Galerie Racine. Critique littéraire, Alain Breton est membre du comité de rédaction, depuis 1997, de la revue Les Hommes sans Épaules, qui est une revue littéraire et poétique française fondée en 1953 par Jean Breton, inspirée par le mouvement surréaliste et dadaïste, elle représente un pan important de la vie poétique et littéraire française, et met souvent en lumière des voix innovantes ou peu conventionnelles.
Poète et découvreur de poètes, Alain Breton est également l’un des animateurs et des poètes principaux de l’« émotivisme », courant poétique contemporain qui prolonge l’action de la « Poésie pour vivre », dont l’acte de naissance fut cosigné en 1964 par Jean Breton et Serge Brindeau. « Or la poésie devrait être avant tout accueil, méditation-lucidité, communication aimantée », a ainsi écrit Alain Breton dans l’Editorial de la revue numéro 1 (deuxième série) des Hommes sans Épaules paru 1991.
Dans son recueil Je ne rendrai pas le feu, le poète, nouveau Prométhée, affirme être l’Homme-Dieu-Monde, accueillant tous les autres poètes mais aussi le monde dans son entier et tous les règnes de la nature, comme toutes les époques et tous les temps dans son poème. L’habitation du monde, oikos, est écosophie prônée par un écrivain qui s’affirme dans le respect de toutes les formes de vie, le poème mettant en lumière sa force d’hospitalité et nous accueillant, comme le fait Edmond Jabès, dans son livre :
Comme l’oiseau
je ne me suis jamais éloigné des étoiles
pour espionner leurs coutumes
ni de la fleur dépeignée par l’abeille
buvant au goulot le soleil
ni du ruisseau assis au bord du ciel
de la Lune dans sa chapelle d’heures
ou de l’orage posé dans la maison d’hôtes
sur la table sacrée
et j’ai vécu près d’un nuage
Le monde, dans son ensemble est un répertoire de choses où tout renvoie à tout, éternellement, sans fin, comme l’oiseau n’oublie jamais que les choses font partie d’un tout. Il s’agit de sentir, le vertige, le tourbillon des choses cosmiques. La poésie est matière vivante. Elle consiste à rester aux écoutes, aux aguets de l’au-dehors et de l’au-dedans, c’est inépuisable et c’est une joie, comme de se trouver en vibration avec le monde. Vivre en poésie, c’est vivre dans le sacré du monde. Entrer en communion avec la vie. La parole d’Alain Breton est fraternelle, elle cherche à entrer en résonance avec l’autre, avec d’autres voix poétiques. Car nous sommes au monde et le monde est en nous à travers le temps immémorial, archétypal de la mémoire et du présent dans un éternel palimpseste. Le Phénix est le témoin d’une résurrection plurielle, la parole du poète étant capable de passion mais aussi de compassion comme le montre sa « larme brûlante » :
et si vous me voyez solitaire et confiant
c’est que j’ai pour ami le Phénix
dont la larme brûlante contient tous les noms
Tonalité rimbaldienne du « Bateau ivre », épopée, rapsodie évoquant les voyages en terre de poésie dans la filiation de Cendrars ou dans la revisitation des stèles de Segalen, Alain Breton se fait lecteur de tous les poètes du monde, visionnaire de tous les temps, de toutes les strates temporelles et de tous les paysages littéraires et cosmiques :
J’ai fait halte dans les poésies
de Ray d’Adonis de Ritsos
dit Tout doux à Arthur
et pleuré avec Rilke
L’essentiel de l’effort du poète ne consiste pas à produire des images, à transcrire des visions mais à empêcher que ces images ne se forment tout à fait. Par un mouvement très rapide, Alain Breton n’arrête le poème sur aucune vision fixe. Sa poésie est configuration de l’étonnement et de l’émerveillement.
Il est ce poète de l’éclat et de la rencontre. Voyant, voyageur, explorateur. Observateur d’un monde déconcertant, il en transcrit les aspects divers, tels qu’ils se présentent à lui, dans le désordre originel qu’aucune intervention de la raison n’aurait encore débrouillé. Comme le veut Rimbaud, « Il arrive à l’inconnu, et quand affolé, il finirait par perdre l’intelligence de ses visions, il les a vues ! ». L’univers évoqué, comme dans Les Illuminations rimbaldiennes, est animé d’une vie propre, permettant de donner voix aussi à un autre poète voyant, Daniel Biga :
Quel bonheur !
Je descendrai le Mississippi
pour rencontrer Tecumseh le Puma
comme avant
Daniel Biga
Succession d’images instantanées, « hallucinations simples » dont aucun souci descriptif n’entrave la liberté. Tohu-bohu des références mythiques historiques et géographiques contradictoires et juxtaposées où mythes, épopées, contes et fables, péplums voisinent tout comme l’Enéide, Dionysos, un gladiateur ou encore le quadrige de Ben Hur dans une sorte de fresque simultanéiste. Le je dépourvu de sa singularité d’individu, dissous en d’incessantes métamorphoses, perd cohérence et stabilité. Il tend à une forme d’impersonnalité :
Et je pensai
as-tu réinventé l’amour
et toi rêvé tant de fois
d’être un autre
« Car je est un autre », telle est la célèbre affirmation d’Arthur Rimbaud dans sa lettre à Paul Demeny datée du 15 mai 1871. Il existe, en effet, dans l’écriture d’Alain Breton, une puissance de déplacement. C’est une poésie faite monde où le poète se dépersonnalise, où plus personne ne dit je, où « le cuivre s’éveille clairon ». La poésie est multiplicité, démultiplication, don d’ubiquité :
Trop jeune durant la Préhistoire
un peu en retard à la bataille de Samothrace
enroué au cours de la conférence de Valladolid
amoureux durant le concile de Nicée
nu sur une plage pendant la campagne de Russie
et je me suis cassé un ongle avant Hiroshima
Moi
issu de toutes les absences
La fraternité en poésie, c’est ce mouvement qui consiste à se mettre à la place de l’autre.
Ce n’est pas que de moi l’aveu
il y a toujours eu trop de peau
trop de se chercher dans les autres
Le lieu de la parole ne rejoint plus forcément le lieu politique de l’autorité mais parfois le lieu poétique de l’échange et du partage. Le mystère du poète, c’est alors un regard. Dans un premier temps, se faire voyant, devenir visionnaire, c’est se faire aveugle pour trouver un autre regard, comme l’a compris Henri Michaux (1899-1984), s’aventurant dans l’inconnu :
« C’était pendant l’épaississement du grand écran. Je voyais ! se peut-il me disais-je, se peut-il ainsi qu’on se survole. C’était à l’arrivée entre centre et absence, à l’Euréka, dans le nid de bulles. »
Poésie d’Alain Breton dont l’unique ambition serait de « donner à voir ». Livre d’un voyant, ces poèmes seraient, somme toute, moins à lire qu’à voir, à recevoir. Le lecteur devrait pour accéder au poème se transformer en spectateur de cet ensemble de scènes qui relèvent d’une théâtralité constante, travail d’enluminures, kaléidoscopes, lanternes magiques.
Il s’agit de susciter, grâce aux pouvoirs d’un langage créateur, un monde neuf. Il s’agit d’accéder à une réalité dont nous séparent d’ordinaire les limitations de notre moi. Composé instable, toujours sur le point de se défaire, la poésie d’Alain Breton tend naturellement vers l’éclat, la fulguration. Elle doit sa fascination à cette étrangeté radicale détachée de toute rhétorique de la représentation. L’œuvre rompt avec une poésie lyrique ou pittoresque qui limitait son champ aux émotions humaines et aux spectacles arrangés par et pour l’homme ; elle invente les formes nouvelles qui doivent permettre d’accéder à une réalité que l’on découvre et que l’on crée dans le même mouvement et qui ouvre le chemin vers une nouveauté poétique :
Parmi les usagers
certains connaisseurs choisiront la bonne gare
celle qui n’existe pas
et les horaires pour l’absolu
La révolution de l’écriture est aussi provocation contre les normes, les chiens y mordant la boue :
Mon Dieu
renvoyez-nous dans les tétons qui causent
dans la langue du chien
Faites que l’on fâche
faites que l’on morde mais que l’on aime
Donnez-nous les poèmes les plus drus
les vers les plus féroces
les éclats dont mourrait même le feu
Le poète perd son individualité pour devenir chantre de l’universel, voix traversante d’un inconscient commun. Il s’exprime dans les lieux d’une communauté refondée :
soufflant dans une pipe d’opium
un jour tu connaîtras les adeptes du krill
la baleine le cachalot
par le baiser qui les unit
et peut-être pourras-tu plusieurs fois mourir
par un chas de la mer
sans jamais lasser le Donneur d’embruns
La poésie, permet de créer du lien entre intime et communauté, partage, dialogue, tension lyrique, entre-deux entre émotion intime et dimension universelle :
Ainsi je t’ai aimée à Tizi Ouzou
près de la gare de l’Est
en toute imprécision
J’ai aussi foulé le sol cheyenne
maigri par pemmican
pour apprendre la danse de mort aux vautours
et guerroyer sur les chevaux arqués
Le poète, par sa poésie, a ouvert l’événement d’exister, l’espace et le temps de la naissance, il a donné, une fois pour toutes, dans l’instant aigu, dans l’instant qui dure, tout ce qu’il a à donner. Poète indien, poète boxeur à la manière de Kafka, poète d’illuminations où se ressaisit toute totalité entre pierres immémoriales, lectures de l’enfance, contes, fables et épopée, écriture d’une universalité dans la précarité de l’humanité mêlée au monde :
Allez
apportez-moi des fleuves un dolmen
ma tortue Caroline et la Sorcière des mers […]
Terre je m’incline ciel je suis venu
Lumières lointaines souvenez-vous de nous
Et si je t’aime cela te multiplie
Béatrice BONHOMME (in /litteratureportesouvertes.wordpress.com, le 24 janvier 2025).
|
|

|
|
Lectures critiques :
« Tout est âme en toi quand je t’aime
par le tigre et la cornaline
Sur ta rivière décachetée
je suis le titulaire du philtre
Suspendu à l’Yggdrasil
tenu par le serment des mille respirations
quand par miracle
tu apparais
dans la chambre secrète
des lieux où je t’invente »
Ce poème d’Alain Breton rappelle tout ce que le mot asphodèle peut évoquer en nous : la mort, la liberté, la beauté, l’amour, la magie, le mystère… Mais, le recueil est parsemé d’inattendus, de détours, de sauts à l’aveugle, de cris de colère, et de gestes d’apaisement.
« Jadis nous surprit Orphée contrebandier de peaux et de tabac
Sa lyre réglait tout un empire
dont la règle fut le chant
et Eurydice celle qui n’applaudit pas
militante d’un club où l’on fait la vaisselle
à laquelle on ne confie pas le whisky
dans la cité maudite
ni l’or des Incas pour une brocante à la Jamaïque
ni les spectres qui jonglent avec les yeux des chats
cochers de l’irréel »
Alain Breton nous balade, nous conduit, nous perd et nous retrouve. Cache-cache des mots et splendeur du verbe qui, soudain, libère, parfois à contre-sens.
Odile Cohen-Abbas, dans sa postface, l’interpelle :
« Visions prospectives et apocalyptiques s’enchevêtrent que régénèrent toujours des indices ou fragments fictionnels du présent. Vous êtes si prodigue, Alain Breton, quand vous distribuez le vrai et le faux, le sordide et le beau, les songes des hommes qui prennent naissance dans les vieilles eaux, les antagonismes du désir, votre passion indissoluble de l’humour et de la tragédie ! »
Alain Breton épuise la langue pour en faire un creuset dans lequel la matière des mots peut assurer une résurrection, celle du poème, de l’éclair lumineux qui enchante par la lucidité. C’est terrible et jubilatoire.
« C’est toujours la même chose
sous les sphères
on remercie bien tard
le petit âne pour ses biscuits
et l’aigle qui a du lustre
Un peu prétentieux pourtant de ses serres
sait-il faire jouir au mieux sa compagne
en garde-t-il le goût dans ses rondes
quand il fait le malin dans le vent
ô grand-maître qui ne se pose que pour l’arbre
ou tuer »
La déambulation d’Alain Breton est une quête éperdue du passage étroit entre la mort et la vie, l’horreur et l’extase, entre le poème et le silence.
Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, avril 2022).
*
Quand on court contre le temps on a toujours du retard dans ses lectures, ses écritures, et tout le reste… Mais au moins poser un parcours. Rendez-vous avec des livres…
Donc lire… Alain Breton
Premier recueil de poèmes de lui que je lis. Mais j’avais déjà découvert plusieurs de ses textes dans diverses anthologies (du Nouvel Athanor, notamment) et avoir l’intention d’en lire plus.
Intriguée par le titre, Je serai l’assassin des asphodèles, éd. Les Hommes sans Épaules, 2022
Elles sont assez belles ces fleurs, fréquentes en bords méditerranéens, les asphodèles. Mais la mort, c'est elles qui la marquent. Au moins dans la culture antique (et parfois encore comme par une mémoire culturelle inconsciente), fleurs pour orner les tombes. Les tuer serait-ce tuer la mort ? En acceptant que la poésie soit (comme le dit Roberto Juarroz, cité en exergue principal) une forme de folie qui nous préserve du bon sens et des stupides idoles qui dévorent la vie des hommes. Et ainsi... qui nous permet de vivre et de mourir en tant que nous-mêmes. Le sujet de la mort est bien là. Celle qui nous guette, celle qui environne, celle que la société veut éloigner, celle qu'en fantasme on se souvient d'avoir vécue, habitant l'histoire en personnage du passé, celle de l'image des Érinyes / dans chaque gare... Celle que les humains infligent ainsi que firent nos ancêtres (mais...). Mais, car le monde est autre, cruel autrement. Cependant s'il y a présence du tragique des vies, il y a, en contrepoint, l'art des oiseaux. Métaphore de plus de sens.
Parcours rapide. Mais assez pour grappiller des fragments, y revenir, et noter qu’il aime citer (j’ai lu et relu les autres exergues…). Assez aussi pour avoir senti l’esprit, comme un voyage intérieur, s’interrogeant sur les émotions qui donnent épaisseur à tout ce que l’on vit, et, en arrière-profondeur de pensée, regardant comme de haut tous ces instants, ces bribes d’itinéraire, cherchant le sens, et la liberté intérieure qui se construit avec et contre le temps. Mais, comme le dit en exergue Marie-Claire Bancquart, éclairant le poème qui suit, p.135 (Nulle route que vers le dedans), le voyage est intérieur, pour se demander où avoir eu lieu (p.170), et se définir en poète visiteur du cri (p.178)
Citations…
Un jour je parlerai de choses et d’autres
car je n’ai pas promis
(Ces deux vers, p.11, suivent le titre Comment édifier un précipice, et l’exergue d’Alain Simon, dont je copie la dernière ligne, je viens pour seulement les philtres). On a le programme intime de l'écriture, sans obligation, mais avec un risque pris, ce précipice dressé dont on peut tomber, mais si la poésie s'autorise une forme de folie (Roberto Juarroz), elle a sa magie, ses philtres (Alain Simon). Mais les philtres, c'est Alain Breton qui les crée. Et ils ont leur efficacité, comme le démontre la postface d'Odile Cohen-Abbas, car elle voit aussi la face lumineuse qui vient de ces créations voyageuses, de ces rêves dont l'amour n'est pas absent.
Qui suis-je
même pas le mangeur de ciel
Plutôt de la lignée des Poissons
une simple arête qui clame la jetée
et donne écriture aux planètes
(p.53)
J’ai vieilli je ne dépends plus que de mes souvenirs
et de l’herbe si lente après la nuit
(p.93)
Et je ne savais pas
que ma vie irait toujours au poème
pour ne surtout rien comprendre
sauf la magie
(p.136)
Marie-Claude SAN JUAN (in tramesnomades.hautetfort.com, 2022).
*
Le jeu appartient à la poésie, un jeu qui peut être sérieux, ou pas ; qui peut se colorer de toutes les émotions ou au contraire tenir une seule note ; un jeu qui s’opposerait à la vie ou, au contraire, serait la vie même, rendue à son éclat royal, à ses féeries, à la drôlesse mystique des métamorphoses et du « fouillis », toujours libre et toujours en geôle.
Telle est la promesse jamais démentie de la poésie d’Alain Breton. Le voyage, la liberté donc, est le motif principal de ce triple recueil ; mais seulement ceux qu’on peut faire avec des poèmes-légendes, ceux qui retranscrivent notre vie complète en dix vers, mais qui débordent la seconde et l’espace. Il y a les spires d’un rêve « tenu par le serment de mille respiration », la femme du Nord, Betty Boop, le grotesque, les oiseaux, une magie médiévale ou amérindienne, mille et un noms de fleurs, le grand âge des arbres, tandis que « mes branches ne gardent rien du silence des oiseaux », la stupéfaction paisible devant la source « dont le souci est l’élégance » ; puis enfin toi, « cet errant irisé de hantise », jusqu’au moment ultime : « Et puis la mort s’est approchée / c’est-à-dire le couteau sans date », la mort qui est « la source moissonnée ».
Il y a du M. Plume dans les poèmes d’Alain, « Prince en Absurdie en Tartarie dans un boudoir », du cocasse espiègle, de « l’hypothétique enjoué », remarque très justement Odile Cohen-Abbas dans sa postface ; mais avec la lucidité de celui qui sait devoir sa mort à la ciguë des vanités de ce monde, et son paradis d’avoir gardé un œil vigilant sur les sources moqueuses du rire (« Mon Dieu m’a accordé le rire / pour triompher de moi »).
Enfin, et – pour ceux qui se baissent – il y a de la morale dans ces vers, celle forgée par un « optimisme tragique » à la Diogène qui « va parmi les rues mal éduquées » ; et aussi celle que l’on dit du bout des lèvres, la nuit, à son ami le plus cher : « Ô poètes n’empruntez pas ne pillez pas / – et voler quoi puisque tout est lumière ».
Pierrick de CHERMONT (in revue Les Hommes sans Epaules n°56, octobre 2023).
|
|
|