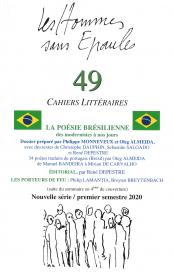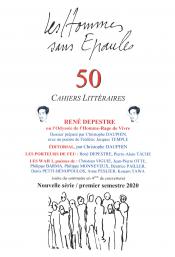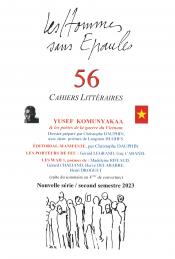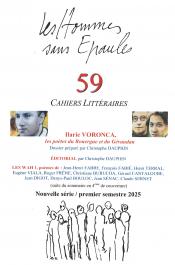Madeleine RIFFAUD

Poète, résistante, militante anticolonialiste, aide-soignante, journaliste d’investigation, correspondante de guerre ; Madeleine Riffaud est tout cela intensément. Elle est l’auteure d’une quinzaine de livres, poésie, récits et essais, qui témoignent de sa vie et de sa personnalité hors du commun. Elle est la dernière grande figure de la Résistance et assurément l’une des personnes les plus impressionnantes, extraordinaires, que l’on puisse rencontrer. Poète et femme d’action, elle est Porteuse de Feu ; un feu qui n’est pas qu’une image dans a vie comme dans son œuvre. Sa poésie, ses écrits, sont de combat. Silhouette menue, longue natte et visage farouchement déterminé, ainsi apparaît Madeleine Riffaud dans son appartement du Marais, à Paris, entre la Maison de Victor Hugo et le Musée Picasso.
Son âge ? Elle répond : « Je n’ai jamais fêté mes anniversaires, ce n’est pas maintenant que je vais commencer ! »Madeleine Riffaud est née le 23 août 1924 à Arvillers (Somme), de parents instituteurs, originaires du Limousin, montre tôt, dès l’âge de onze ans, des dispositions pour la littérature et donne son premier poème à l’âge de quinze ans. Elle est alors vouée à suivre le chemin de ses parents, devenir institutrice, mais l’Histoire ne va pas tarder à interférer. Alors que le jeune poète Claude Roy fait la connaissance de Madeleine, découvre sa poésie, dont il publie deux poèmes dans la revue L’Écho des Étudiants, Madeleine Riffaud entreprend des études de sage-femme (qu’elle devra interrompre en janvier 1944) et rejoint son fiancé au Front national des étudiants, affilié au PCF, sous le pseudonyme de Rainer, en hommage au poète Rainer Maria Rilke. Madeleine Riffaud devient membre de la direction du Front national des étudiants en médecine, avant, en 1944, d’adhérer au Parti communiste et de demander à rejoindre la lutte armée.
En juillet 1944, après l’exécution, le 21 février, de Manouchian et de ses 22 FTP-MOI, le massacre d’Oradour (où elle se rendait l’été avec ses parents), le 10 juin, Madeleine Riffaud prend la décision de passer à l’acte. Elle raconte : « Le 23 juillet, un dimanche... J’ai longé la Seine. Il faisait beau. Et puis arrivée sur pont de Solférino, vers la gare d’Orsay ; j’ai aperçu un gradé allemand. Je me suis dit : mon vieux, c’est ta fête aujourd’hui… J’ai attendu que cet Allemand veuille bien se retourner, parce que je ne voulais pas abattre, moi, un homme dans le dos. Je voulais qu’il me regarde ; qu’il ait le temps de sortir son arme et faire cela à la loyale, même si cela durait une seconde. Il a fini par se retourner, parce qu’il a senti une présence. Là, je lui ai donné deux balles dans la tempe, et voilà. Il est tombé immédiatement et il est mort sur le coup. Il n’a pas souffert du tout. Je savais comment tirer. »
Madeleine Riffaud est arrêtée quelques instants plus tard, par la Milice, qui la remet à la Gestapo. La détention et les interrogatoires, ponctuées d’actes de tortures, de Madeleine Riffaud, se poursuivent, notamment rue des Saussaies et à Fresnes, en prison, sans que Rainer ne craque. Le nerf de bœuf qui s’abat sur ses reins, n’y fait rien. Rainer répète inlassablement : « Je ne sais rien », observant les consignes données par le colonel Fabien en cas d’arrestation. Torturée par la Milice et la Gestapo, condamnée à mort, Rainer est le fantôme d’elle-même, couverte d’ecchymoses, la mâchoire déboitée, la lèvre fendue, le nez en sang, cassé. Madeleine est finalement libérée, contre toute attente, le 19 août, dans le cadre d’un échange de prisonniers.
Madeleine Riffaud reprend contact avec les FTP et s’apprête à prendre une part active, du 19 au 25 août 1944, à la Libération de Paris. Rainer alias Madeleine Riffaud est affectée comme lieutenant, le 19 août, à la compagnie Saint-Just, groupe de combattants de la libération de Paris établie par les Francs-tireurs et partisans, et prend part à deux épisodes importants de la semaine d’insurrection : la neutralisation d’un train allemand, dans le tunnel des Buttes-Chaumont, le 23 août, jour de ses vingt ans ; et l’attaque de la caserne de la place de la République, dont la garnison refuse d’accepter la reddition, ordonnée par von Choltitz, à la fin de la journée du 25 août.
Après la Libération, le colonel Fabien ne permet pas à Rainer de rejoindre ses camarades à l’armée, car elle est encore mineure. Le 31 août 1944, Madeleine Riffaud est démobilisée. Épuisée et traumatisée par les sévices dont elle a été victime, elle n’a ni métier, ni argent, ni perspectives. Des idées de suicides la hante et d’autant plus lorsqu’elle pense à ses camarades morts au combat ou assassinés, lorsque dans l’après-midi du 11 novembre 1944 ; Madeleine Riffaud retrouve par hasard le poète Claude Roy, désormais journaliste au quotidien Front national, qui lui présente le jour même, Louis Aragon, Tristan Tzara et Paul Éluard.
Madeleine se souvient de ce premier contact, notamment avec Éluard : « Il m’a regardée. Il a senti tout de suite que j’étais quelqu’un en danger de mort. Il était comme ça. C’est là où se voit sa bonté. Il m’a demandé : - Tu ne vas pas, toi, dis ? - Comment vis-tu ? Je suis tubar et je n’ai pas de métier. – Bon. Viens me voir demain, à dix heures. - Tu viendras, n’est-ce pas ? Et c’est comme ça que je m’en suis tirée. J’étais sauvée. Cet homme venait de signer ma levée d’écrou. S’il n’y avait pas eu Éluard pour me regarder ce jour-là, j’étais sans doute perdue. »
Touché par la détresse, mais avant tout par le courage et le talent de la jeune femme, Éluard va publier des poèmes de Madeleine dans L’Éternelle Revue, qu’il a fondée dans la clandestinité. Madeleine devient dès lors, une intime de Nusch et Paul Éluard, qui l’adoptent. Chez eux, Madeleine rencontre de nouveau Tristan Tzara, mais aussi Raymond Queneau, Vercors, et bien sûr Pablo Picasso, avec qui elle noue une forte amitié, indéfectible. C’est encore grâce à Paul Éluard que paraît le premier livre de poèmes de Madeleine Riffaud (orné de son portrait, dessiné par Pablo Picasso) et qu’il préface : Le Poing fermé, en 1945.
Éluard écrit : « En ces années de souffrance atroce et de luttes sans merci, Madeleine Riffaud s’est sentie forte de son extrême jeunesse, car c’est elle, ardente et pure, qui la liait aux combattants de la Résistance. Petite fille solidaire des hommes et des femmes qui s’affranchirent du mal, Madeleine Riffaud a combattu avec courage. Son courage se reflète dans ses poèmes, il les anime et son génie fait que c’est le courage de tous que nous entendons, la grandeur de tout un peuple qui chante ici, sa sensibilité et son intelligence, sa croyance au bien, au mieux. Cette poésie s’accorde, comme aucune autre en France, aux voix des millions d’hommes qui ne cessent de rêver qu’ils pourront un jour chanter leur fraternité… Madeleine Riffaud, rebelle et « terroriste », condamnée à mort à vingt ans, a compris que cette attention exclusive finira bien un jour par vider le mot ennemi de tout son sens. Et elle agit. »
Après Le Poing fermé, cinq autres livres de poèmes suivront, dont, Le Courage d’aimer (1949), Vienne le temps des pigeons blancs (1951), l’anthologie, Cheval rouge (1973), jusqu’à La Folie du jasmin (2001), qui regroupe les poèmes de Madeleine Riffaud dans la nuit coloniale. Pourquoi le combat anticolonial s’impose t’il à Madeleine Riffaud. Elle répond : « J’ai été torturée moi-même pendant l’Occupation de mon pays et je ne pouvais pas admettre que la France en fasse autant aux autres. »
Mais Madeleine répond aussi en poésie : J’ai aimé ma patrie au bruit sec des verrous. – Notre amour est pareil au parfum du jasmin – Qui fait le mur, la nuit, et chante comme un fou – Quand la garde casquée tourne autour des jardins. – Amour sans feu ni lieu aux pas lointains – De mille et mille chômeurs devenus combattants… - J’ai défoncé ma vie comme un cercueil.
Une question se pose de nouveau : que faire ? Paul Éluard la recommande à Louis Aragon, qui dirige quotidien communiste Ce Soir, où Madeleine Riffaud devient journaliste, avant de rejoindre La Vie ouvrière, l’hebdomadaire de la CGT. Entre des séjours en France et au Vietnam, Madeleine Riffaud se rend en Algérie. La première fois, pour La Vie ouvrière, en 1952.
Ses « articles algériens » dénoncent l’occupation du sol et des richesses par les colons français. Elle écrit, ne ménageant, comme à son habitude, ni la vérité ni son lecteur : « Que l’Algérie arrache son indépendance et les colonialistes ne pèseront pas lourd aux mains du peuple. » En 1958, Madeleine Riffaud est recrutée à L’Humanité. Correspondante de guerre, Madeleine est de retour en Algérie et dénonce la « sale guerre ».
Dans l’un de ses articles, peut-être les plus fameux (cf. « Rue des Saussaies » in L’Humanité, 1959), Madeleine Riffaud, dénonçant la torture pratiquée par l’armée française, écrit : « Il nous semble, en lisant, revivre notre propre drame. Ainsi on nous a traînés, jadis, par ces mêmes escaliers intérieurs, ainsi on nous a passés à l’électricité, noyés dans de l’eau répugnante. Ainsi, on a « joué au football » avec nos corps. Ainsi, on a eu envers nous des gestes, des paroles ignobles. Ainsi on nous a fait vivre dans l’ordure et le sang. Ainsi nous avons entendu les nôtres hurler, râler jusqu’à la mort, alors que nos bourreaux se versaient à boire. Ainsi, entre les séances dans les mains de « spécialistes », des infirmières nous ranimèrent afin de nous faire « durer ». Ainsi dans ce même immeuble. Mais nos tortionnaires, alors, parlaient allemand. Nous en sommes sortis, quelques-uns (dont je suis, par hasard), survivants. »
Les articles en rafales de Madeleine Riffaud, à cette époque, dénoncent encore et toujours la torture pratiquée à Paris comme à Alger, par les militaires et les harkis. C’est d’ailleurs à propos d’un article sur ces derniers, que Madeleine Riffaud est accusée, le 7 mars 1961 de « complicité de fausses nouvelles et de démoralisation de la nation. » Elle se bat tout autant contre les exécutions : « Assez ! Il ne faut plus tuer du tout ! Il faut stopper, immédiatement cette politique de la guillotine. » L’OAS a capitulé à Alger, mais pas à Oran. Madeleine s’y rend.
Le 29 juin 1962, avec un collègue journaliste, elle est la victime d’un attentat de l’OAS : un camion fonce droit dans leur véhicule, à la sortie d’Oran. Son genou gauche a été touché jusqu’à la rotule. Sa main droite a été écrasée. Son oreille interne et sa quatrième cervicale touchées. Son œil gauche a subi une rupture des vaisseaux. Qu’importe. Madeleine Riffaud n’en démord pas et revient à la charge avec de nouveaux articles, des poèmes et le Vitenam à l’horizon.
Rentrée au Sud-Vietnam par le Cambodge, en compagnie du journaliste australien Wilfred Burchett ; Madeleine Riffaud y est correspondante de guerre pendant huit semaines, parcourant, en décembre 1964 et janvier 1965, les régions qui échappent au contrôle des Étatsuniens et partage la vie des combattants du Vietcong. Madeleine Riffaud assiste à la bataille de Binh Gia, et réalise, avec Wilfrid Burchett, le film, Dans les maquis du Sud Vietnam, qui sera diffusé en France dans l’émission phare de la télévision, « Cinq colonnes à la une ».
La même année, Madeleine Riffaud écrit et publie un livre-choc, Dans les maquis Vietcong, qui connait un réel succès et est traduit en plusieurs langues. À la fin de l’année 1966, un périple de deux mille kilomètres lui inspire, Au Nord-Vietnam (écrit sous les bombes), qui paraît en 1967. Madeleine Riffaud écrit : « Ce que j’ai vu, au Vietnam de plus beau, de plus digne d’admiration, c’est le peuple lui-même, qui construit à partir de la terre brûlée une nouvelle vie, un nouvel État, et s’éveille au bonheur. Ce que j’ai vu de plus hideux, à travers les blessures qu’ils laissent derrière eux, c’est le colonialisme et la guerre. De plus précieux au cœur des survivants, c’est l’indépendance et la Paix, de plus respecté par le pouvoir populaire, la démocratie, de plus souhaité par tous, la réunification du pays et l’amitié entre les peuples. »
La signature des accords de Paris, prélude à la paix, interrompt l’activité de reporter de Madeleine Riffaud. Elle va découvrir un autre univers, dans le cadre d’une enquête d’investigation, d’un « reportage social », en s’infiltrant, en se faisant embaucher comme agent de service (« fille de salle »).
Madeleine Riffaud travaille ainsi plusieurs mois, en 1973, à l’hôpital Broussais de l’Assistance publique de Paris, puis dans l’établissement privé Saint-Joseph, en réanimation chirurgicale et en chirurgie cardio-vasculaire. La situation de l’hôpital public, déjà, en 1970, est alarmante : « Il faut être moderne et fonctionner, faute de personnel, en dépit du bon sens. »
Rien n’a évolué et tout a empiré de nos jours, en 2020, comme nous le savons. Madeleine, devenue Marthe, découvre et révèle le pire : besognes répugnantes, salaires dérisoires, manque de moyens et de personnel, souffrances physiques et morales. De cette expérience, elle tire un livre, Les Linges de la nuit, qui connait un retentissement considérable (vendu à un million d’exemplaires).
Au milieu des années 1970, Madeleine Riffaud s’éloigne discrètement du Parti communiste et refuse toujours de raconter son passé, jusqu’à ce que son ami résistant Raymond Aubrac, la « secoue », en 1994. Madeleine Riffaud va témoigner. À quatre-vingt-quinze ans, Madeleine n’a rien perdu de son franc-parler. Chez elle, pas de faux-semblant ; ni compromis. Les hommages n’y font rien. Pour Madeleine, il faut continuer à travailler, à lutter, à combattre pour la liberté et la justice.
Les jeunes, déclare Madeleine (dont l’engagement a toujours été suivi par l’action), « doivent recouvrer l’espoir, rien n’est écrit d’avance. Faites de la politique, tout est à réinventer. Redevenez des citoyens ! »
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
IL FAUT AIDER NOTRE AMIE LA GRANDE POÈTE-RÉSISTANTE MADELEINE RIFFAUD : UNE CAGNOTTE POUR Madeleine Riffaud dite Rainer, 29 novembre 2023
" Ne laissons pas les personnes âgées, héroïques (c'est son cas) ou pas, finir seules face a des escrocs."
Lien vers la cagnotte Leetchi Soutien à Madeleine Riffaud:
https://www.leetchi.com/fr/c/soutien-a-madeleine-riffaud-1336795
Madeleine Riffaud dite Rainer , 99 ans, est poète, auteur de 18 livres (essais, proses et poèmes), amie de Paul Eluard, Nazim Hikmet et Pablo Picasso (Somme), la dernière grande héroïne vivante de la Résistance française, arrêtée en 1944 (elle a 20 ans) après avoir abattu un soldat allemand et torturée pendant plusieurs semaines sans parler, elle échappe à la déportation et combat pour la Libération de Paris à la tête d’un détachement d’hommes. Madeleine est l’une des premières correspondantes de guerre françaises et l’une des premières militantes anticolonialistes (Vietnam et Algérie)… En 1975, Madeleine publie "Les Linges de la nuit", et dénonce la casse de l’hôpital public et la maltraitance, dont elle est, aujourd’hui, à 99 ans, à son tour la victime… Il faut aider Madeleine, à qui nous devons tant ! La maltraitance, au sein de l’hôpital public d’une république française devenue ultra-injuste et néolibérale, Madeleine a dû la subir au début du mois de septembre 2022, à l’âge de 98 ans : hospitalisée à l’Hôpital Lariboisière, notre poète-résistante est abandonnée sur un brancard sans manger pendant 24 heures. La réaction de notre combattante est une tribune, le 19 septembre 2022, « Ma lettre ouverte au directeur de l’APHP ». Mais le calvaire de Madeleine ne s’arrête pas là. Ni son combat pour la dignité humaine.
Mercredi 25 octobre 2023, l’information suivante est rendue publique, relayée dans mes les médias : « Madeleine Riffaud, 99 ans, figure de la Résistance de 99 ans, victime d’un abus de confiance, a été escroquée par son aide-soignante, qui est poursuivie et sera jugée au tribunal correctionnel de Paris, le 19 décembre 2023, pour abus de confiance aggravé en raison de la particulière vulnérabilité de la victime. Elle risque sept ans de prison et 750.000 euros d’amende, pour avoir détourné l’argent de Madeleine Riffaud. » Le 7 février 2022, une amie de Madeleine a déposé une plainte dont le parquet s’est saisi, accusant l’aide à domicile d’abus de confiance. Depuis près de douze ans, Madeleine dispose d’une aide à domicile « en raison notamment de sa cécité ». Après l’ouverture de l’enquête, le parquet épluche les relevés de comptes de Madeleine, qui paraissent incohérents par rapport à son mode de vie simple. Les enquêteurs découvrent « des dépenses hallucinantes » comprenant des frais de repas au restaurant, des dépenses chez le coiffeur, chez l’esthéticienne, dans des boutiques de vêtements, ainsi que des achats de croquettes pour chat ou encore d’une machine à eau gazeuse. Le préjudice est estimé à plus de 140.000 euros. Entre 2015 à 2021, l’aide à domicile n’a effectué aucun achat alimentaire, révèlent les enquêteurs.
Le cas de Madeleine, ce qu’elle dénonce d’ailleurs elle-même, soulève directement le problème de la maltraitance des personnes âgées, qui est un problème de santé publique important et avant tout d’humanité. Ce type de violence constitue une violation des droits humains et englobe les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales ; les abus matériels et financiers ; l’abandon ; le défaut de soins ; et l’atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de respect. L’Organisation Mondiale de la Santé rappelle en 2023 qu’environ une personne âgée de plus de 60 ans sur six a été victime d’une forme de maltraitance dans son environnement familier. Cette maltraitance est élevée dans les institutions telles que les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée, deux membres du personnel sur trois reconnaissant avoir commis un acte de maltraitance au cours de l’année écoulée. La maltraitance a augmenté pendant la pandémie de COVID-19 et s’amplifie, compte tenu du vieillissement rapide de la population dans de nombreux pays. La population mondiale de personnes âgées de plus de 60 ans devrait au moins doubler, passant de 900 millions en 2015 à quelque 2 milliards en 2050.
Le 22 novembre, devant l’urgence de la situation de Madeleine, le scénariste de BD Jean-David JD Morvan (co-auteur avec Dominique Bertail et Madeleine, des poignantes et magnifiques bandes-dessinées Madeleine, Résistante, L’Aire/Dupuis, 2021, 2023), publie sur sa page FB la lettre-tribune digne et explicite, "Les héros meurent seuls", de Madeleine :
« Loin de moi l’idée de me qualifier d’héroïne. Dans la résistance, comme en tant que reporter de guerre, je considère n'avoir fait que ce que je devais faire. Pour moi, ce sont mes camarades, les vrais héros. Mais on me qualifie souvent ainsi, ces derniers temps. Nombre de « gens de pouvoir » me font des honneurs sur les réseaux sociaux ou dans la presse... Et le jour où je fermerai les yeux, on me parera sans doute de toutes les vertus. Oui, mais aujourd’hui, qu’en est-il des actes ? Si j’écris cette lettre, c’est que la justice a médiatisé l’affaire d’abus de confiance qui me concerne. Beaucoup de gens me posent des questions, je vais donc y répondre collectivement.
Ceux qui me connaissent savent que mon leitmotiv est « Je ne suis pas une victime, je suis un résistant ». Alors certes, je vais résister, mais je dois bien m’avouer que pour la première fois, je suis une victime. La raison est hélas simple : Je suis devenue aveugle à la suite d’un attentat que j’ai subi à Oran en 1962 (je vois parfois des formes, pas plus). Ne pouvant plus lire mes relevés, j’avais confié la gestion de mes comptes à la directrice de l’entreprise de maintien à domicile qui s’occupait de moi depuis 2011. Je n’entre pas dans les détails de ce que la banque postale a laissé faire - sans jamais me prévenir et sans procuration valable - mais le préjudice retenu par la police après une longue enquête, est de plus de 140.000 euros. Je ne vous dis pas non plus la teneur de certains objets qui ont été achetés avec mon argent, vous rougiriez...
Le procès va avoir lieu le 19 décembre, c’est rapide et c’est bien sauf que... Je n’ai plus d’argent ! Il ne me reste que quelques mois de réserves pour payer les personnes qui s’occupent de moi quotidiennement, car suite à mon passage aux urgences de septembre 2022, je suis devenue plus dépendante. Je dois notamment faire appel à une personne qui reste auprès de moi chaque nuit. Ça coûte fort cher et figurez-vous que l’URSSAF a un fonctionnement pour le moins surprenant : une personne dépendante n’est exonérée de charges pour les auxiliaires qu’elle emploie que jusqu’à un certain nombre d’heures de travail. Une personne TRÈS dépendante n’y a plus droit et doit donc payer cher. Très cher. Sachez-le : Plus vous perdez votre autonomie, plus on vous taxe. Moi qui croyais que la « double peine » était proscrite en France... Bref, j’en suis arrivée à me demander si je ne devrais pas vendre mon appartement, dans lequel j’avais envisagé de faire une fondation. Cette triste affaire pourrait donc aussi voler une partie de la mémoire de la Résistance.
Tout ça pour dire que je n'ai plus non plus d’argent pour payer un avocat ! Drôle de monde dans lequel la présumée coupable a de quoi se payer un ténor du barreau, et la victime n’a même pas droit à un commis d’office car, paradoxe de l’administration, mes allocations de Résistante, de victime de guerre, de journaliste et d'invalidité mises bout à bout dépassent le plafond requis. Tout ça est tellement absurde que mon penchant pour l’auto-dérision pourrait me faire en rire... Sauf que ce qui n’est pas amusant - et c’est la raison pour laquelle j’ai porté plainte – c’est que si cela m’arrive à moi, c’est que ça arrive aussi à beaucoup d’autres personnes ! Et toutes n’ont pas ma voix ! J’ai la chance d’avoir des amis fidèles, qui sont toujours prêts à monter au créneau pour moi. Non pas pour me faire plaindre, mais pour continuer à mener le combat en faveur d’une société plus juste ! Ainsi, suite au scandale des ehpad, les autorités demandent de privilégier le maintien à domicile. C’était déjà mon choix, mais il faut aussi poser des garde-fous dans ce domaine, renforcer les contrôles, punir ceux qui abusent pour dissuader ceux qui seraient tentés de le faire. Demandez autour de vous, vous serez surpris du nombre de personnes qui disent « Ah oui, c'est arrivé à ma grand-mère », « à mon oncle », « à mon père », etc. Heureusement, l’Onacvg (Office national des combattants et des victimes de guerre) est à mes côtés, mais les aides exceptionnelles qu’ils parviennent à me faire verser aux prix de grands efforts sont avalées immédiatement par l’Ursaff. J’ai écrit à l’État Français via le site internet de l’Élysée, comme chaque citoyen peut le faire, mais aucune réponse encore après trois semaines. Je suis toujours l’actualité de près et je sais qu’ils ont beaucoup à faire... J’ai moi-même risqué ma vie pour tenter de rendre ce monde plus vivable, en premier lieu de 1942 à 1944, dans l’espoir de rétablir ce même État Français. Par cette tribune, j’ai encore l'espoir de faire passer ce message de société qui me semble vital : Ne laissez pas les personnes âgées, héroïques ou pas, finir seules face à des escrocs. Merci à tous ceux qui m’ont aidée, m’aident et voudront bien m’aider. » Il faut aider Madeleine, à qui nous devons tant !
Notre très chère Madeleine Riffaud est décédée mercredi 6 novembre 2024, à l'âge de 100 ans.
Christophe Dauphin
(Revue Les Hommes sans Épaules)
Œuvres de Madeleine Riffaud :
Poésie : Le poing fermé, préface de Paul Éluard, illustration de Pablo Picasso (éd. de l’Ancolie, 1944), Le Courage d’aimer (éd. Seghers, 1949), Vienne le temps des pigeons blancs (éd. Seghers, 1951), Si j’en crois le jasmin (éd. Coarze, 1958), Cheval rouge, anthologie 1939-1973, préface de Vladimir Pozner (Éditeur Français Réunis, 1973), La Folie du jasmin, Poèmes dans la nuit coloniale (éd. Tirésias, 2001).
Fictions : Bleuette, récit (éditions France d’Abord, coll. Jeunesse Héroïque, 1946. Rééd. éd. Tirésias, 2004), Les Baguettes de jade, roman (Éditeur Français Réunis, 1953), Un chat si extraordinaire, contes du Vietnam (La Farandole, 1980), Le Chasseur changé en crabe, conte du Vietnam (La Farandole-Messidor, 1981), La vie secrète du Père Noël (La Farandole-Messidor, 1982).
Essais : On s’est battu contre la mort (éditions France d’Abord, coll. Jeunesse Héroïque, 1945), Les Carnets de Charles Debarge, documents recueillis et commentés par Madeleine Riffaud, Éditions Sociales, 1951), De votre envoyée spéciale (Éditeur Français Réunis, 1965), Dans les maquis du vietcong (éd. Julliard, 1965. Rééd. Pockett), Au Nord-Vietnam, écrit sous les bombes (Julliard, 1967), Les Linges de la nuit (Julliard, 1974. Rééd. Pockett. Rééd. Michel Lafon, 2021), On l’appelait Rainer, 1939-1945 (Julliard, 1994).
BD : Bertail - Morvan - Riffaud, Madeleine Résistante, I. La Rose dégoupillée (Air Libre , 2021), Bertail - Morvan - Riffaud, Cahiers Madeleine Résistante, 3 volumes (Air Libre , 2021).
Films documentaires/Dvd: Philippe Rostan, Les trois guerres de Madeleine Riffaud (Jour 2 Fête / Filmover production, 2011), Jorge Amat, Les 7 vies de Madeleine Riffaud (Doriane Films, 2021).
À consulter : Isabelle Mons, Madeleine Riffaud, l’Esprit de Résistance (Payot, 2019).