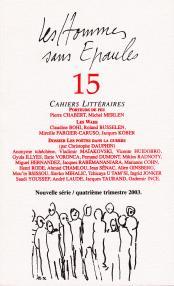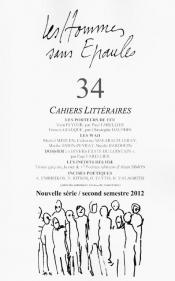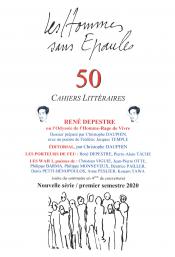Michel MERLEN

Michel Merlen (né en 1940) est un poète secret, discret et essentiel. Il publie peu et n’écrit que dans l’urgence, celle du jeune homme gris, entre dépression et solitude, névrose et plongée (d’où l’on ne revient pas indemne) dans le fatum humain. Merlen, c’est le quotidien immédiat, à vif ; le réel qui s’effrite ; la tendresse impossible, l’onirisme arraché au néant.
De Michel Merlen, je ne connais qu’un seul portrait photographique, qui a paru dans Poésie 1 n°19, « La Nouvelle poésie française », en 1971. Un beau portrait au demeurant, celui du « Jeune homme gris » (titre de l’un de ses recueils emblématiques). Le poète est de profil et fume une cigarette. Il a alors trente-et un ans et vient de donner, Les Fenêtres bleues (1969) et Fracture du soleil (1970), deux recueils notamment remarqués par le poète et éditeur Jean Breton, qui accueille Merlen dans sa célèbre revue.
La photo fait penser à un jeune dandy, mais brûlé, déjà. Car Michel Merlen est un être blessé, né de sa douleur : Aujourd’hui les galets au cœur – j’étincelle – quelle veine à mon poignet – bat – et – la rejoindra ? Les poèmes que publie Poésie 1, sont tirés des deux premiers recueils de Merlen, avec des inédits, que l’on retrouvera l’année suivante dans Les Rues de la Mer, que Jean Breton éditera également.
Le poème merlénien que nous connaissons, est déjà là : langage concis et épuré, ton personnel et exigeant, images dénuées de fioriture et sans trompe l’œil : je chante comme par MIRACLE – dans le NOIR qui brille – un long bras sur la face. Il ne ressemble à aucun autre, balle perdue au fond de quelque tiroir. Homme blessé, Merlen ! Poète de la faille, de la fracture, d’un quotidien sans illusion (ça suffit de marcher pour rien dans l’incendie du quotidien), sans aucun doute, mais ne faisons pas fausse route, même si la tentation est grande : rien à voir avec le mythe du « poète maudit » ou celui du « poète triste ». Merlen le dit lui-même : Je veux qu’on le sache – j’ai de l’admiration – pour tout ce qui est vivant, sans jamais rien caché de sa fêlure, qui ira malheureusement en grandissant : j’ai des balafres j’ai des plaies – Je sors des hôpitaux – pour me soigner – au vent cinglant des villes – à l’iode du sourire des filles – mais le métro mâche mes mots – les voitures m’évitent – je glisse sur les boulevards – comme une boule de billard.
Dans C’est nous, la mort…, Merlen écrit encore, relatant un internement et ses méthodes barbares : Ils ont fouillé ma valise. Inventaire. Pyjama. Tutoiement d’office. Je n’ai plus d’identité. Ils ont pris ma carte. Mon carnet d’adresses. Je n’ai plus d’amis. Couloir de morgue qui mène à la pharmacie. Piqûre de valium. Chambre lugubre comme un dimanche de novembre. Lit paillaisse. Eau de Javel. Plus de musique pour résister au temps. Pas de stylo pour écrire l’urgence. Rien. Personne. Sans profession. Sans domicile. Divorcé d’avec le monde. A force d’aller à l’hôpital on finit par y rester.
Après Les Rues de la Mer (1972), Merlen publie : La Peau des Etoiles (1974), Quittance du vivre (1979), Le Jeune homme gris (1980) et surtout, Abattoir du silence (1982), l’un des recueils phares de sa génération, que Jean Breton édite dans sa prestigieuse collection « Poésie pour vivre ». Cinq livres paraissent par la suite, dont Généalogie du hasard (1986) : il faut crier il faut sortir – toucher juste. Dans sa préface, Patrice Delbourg écrit : « Peser sur le langage, c’est chercher querelle à sa généalogie, c’est faire descendre la chair dans les choses. Le repos avant la souffrance, la grisaille avant la beauté, donnant donnant…. Michel Merlen épie, ausculte, fait craquer la solitude… Et soudain, contre le fourgon des mots gris qui stationnent, le foutre des couleurs. Oasis où il fait bon désespérer, où la vie cingle plus fort… Michel Merlen tient tête à ses névroses par des zooms d’instant brefs, d’émotions à gros grumeaux, à la limite du permis de vivre, quand le sang n’en peut plus. »
Merlen n’a bien sûr pas cessé d’écrire (est-ce seulement envisageable ?), mais les abîmes le dévorent : comme si – le permis de vivre – était refusé. Merlen lutte pour retrouver le souffle de l’enfance – les paroles de l’enthousiasme. Merlen n’accepte pas de mourir : je n’accepte pas que le sexe de la poésie – ne fleurisse plus dans la galaxie du vivre.
Cinq livres entre 1983 et 2011, c’est peu, diront certains. Ce n’est pas si mal, à mon avis, car à l’encontre de ceux (et ils sont légions) qui publient à tour de bras, Merlen oppose son vivre, son devoir de regard, avec exigence : ne laisse pas aller le monde – sans toi – privilégie l’excès – reste – éteins le malheur – et vois. Car c’est la poésie seule qui témoigne de l’Homme sur la terre, et c’est encore elle qui rend probable la supposition de sa vie illimitée dans le temps et dans l’espace, la mort n’étant que la réalisation dernière de la poétique inhérente au sang de l’Homme. Tel est le postulat. Michel Merlen a été présenté et publié dans la rubrique « Porteur de Feu », dans Les HSE n°15, 3ème série, en 2003.
Michel Merlen est décédé le 30 juin 2017 à Champigny-sur-Marne.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
À lire : Les Fenêtres bleues (Jeune Poésie, 1969), Fracture du soleil (La Grisière, 1970), Les Rues de la Mer (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1972), La Peau des Étoiles (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1974), Quittance du vivre (éd. Possibles, 1979), Le Jeune homme gris (Le Dé bleu, 1980), Abattoir du silence (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1982), Poèmes Arrachés (Le Pavé, 1982), Le Désir, dans la poche revolver (La Main à la pâte), Made in Tunisia (Polder, 1983), Généalogie du hasard (Le Dé bleu, 1986), Terrorismes (Polder, 1988), Borderline (Standard, 1991), La Mort, c’est nous…, avec Catherine Mafaraud-Leray, préface de Christophe Dauphin, (éditions Gros Texte, 2012).
Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen, La Mort, c’est nous… (2023)
En 2011, Catherine et Michel m’ont demandé d’écrire la préface du livre qu’ils venaient d’écrire à quatre mains et à deux voix, devant être (et il le fut) publié aux éditions Gros Textes d’Yves Artufel : Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen : La Mort, c’est nous… (Gros Textes, 2012). J’ai bien sûr accepté pour ces deux poètes connus, aimés et lus depuis longtemps. Ma préface s’intitule « La mort c’est nous et nous sommes bien en vie ! » Michel est mort le 30 juin 2017, à l’âge de 76 ans. Catherine, à 74 ans, six ans plus tard presque jour pour jour, le 16 juin 2023. La Mort, c’est nous…, leur livre à deux voix, mais comme d’une seule, brûlée et sans concession, prend aujourd’hui toute son ampleur, encore.
Michel, le jeune homme gris, est l’un de nos meilleurs poètes et aussi l’un des plus douloureux avec le grand Alain Morin. Son livre majeur est sans doute le poignant, dans la prestigieuse collection de Jean Breton « Poésie pour vivre », Abattoir du silence (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1982), alors que Catherine donnait Je suis laide aujourd’hui comme une cathédrale (Possibles, 1978). Voilà, c’est fait, à présent, la mort c’est eux, pas même avec un os d’arrogance entre les reins. Ils sont partis par la toute petite porte dégondée des poètes, celle de l’indifférence et du mépris, et même les dahlias, les crapauds et les chiens n’en ont rien eu à faire… à l’exception de quelques-uns…
Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen, La Mort, c’est nous… (2012)
Les publications de Catherine Mafaraud-Leray et de Michel Merlen sont rares. Ils n’ont jamais cherché à se montrer et encore moins à « faire carrière ». Mais est-ce bien cela la poésie : faire carrière ? Michel Merlen répond : vous ne parviendrez pas à assassiner le désir – législateurs anonymes de l’obèse et de la vacuité.
Discrets, ils le sont, même à l’heure d’Internet. Merlen se fît remarquer dans la revue Poésie 1 n°19, en 1971. Le poète a alors trente-et un ans et vient de donner Les Fenêtres bleues (1969) et Fracture du soleil (1970). Le poème merlénien que nous connaissons est déjà là : langage concis et épuré, ton personnel et exigeant, images dénuées de fioriture et sans trompe l’œil : je chante comme par MIRACLE – dans le NOIR qui brille – un long bras sur la face. Il ne ressemble à aucun autre, balle perdue au fond de quelque tiroir.
Homme blessé, Merlen ! Poète de la faille, de la fracture, d’un quotidien sans illusion (ça suffit de marcher pour rien dans l’incendie du quotidien), sans aucun doute, mais ne faisons pas fausse route, même si la tentation est grande : rien à voir avec le mythe du « poète maudit » ou celui du « poète triste ». Merlen le dit lui-même : Je veux qu’on le sache – j’ai de l’admiration – pour tout ce qui est vivant, sans jamais rien cacher de sa fêlure, qui ira malheureusement en grandissant : j’ai des balafres j’ai des plaies – Je sors des hôpitaux – pour me soigner – au vent cinglant des villes – à l’iode du sourire des filles – mais le métro mâche mes mots – les voitures m’évitent – je glisse sur les boulevards – comme une boule de billard.
Dans C’est nous, la mort…, Merlen écrit encore, relatant un internement et ses méthodes barbares : Ils ont fouillé ma valise. Inventaire. Pyjama. Tutoiement d’office. Je n’ai plus d’identité. Ils ont pris ma carte. Mon carnet d’adresses. Je n’ai plus d’amis. Couloir de morgue qui mène à la pharmacie. Piqûre de valium. Chambre lugubre comme un dimanche de novembre. Lit paillaisse. Eau de Javel. Plus de musique pour résister au temps. Pas de stylo pour écrire l’urgence. Rien. Personne. Sans profession. Sans domicile. Divorcé d’avec le monde. A force d’aller à l’hôpital on finit par y rester.
Merlen n’a jamais cessé d’écrire (est-ce seulement envisageable ?), mais les abîmes le dévorent : comme si – le permis de vivre – était refusé. Merlen lutte pour retrouver le souffle de l’enfance – les paroles de l’enthousiasme. Merlen n’accepte pas de mourir : je n’accepte pas que le sexe de la poésie – ne fleurisse plus dans la galaxie du vivre. Cinq livres entre 1983 et 2011, c’est peu, diront certains. Ce n’est pas si mal, à mon avis, car à l’encontre de ceux qui publient à tour de bras et confondent le folklore et le fatum humain, Merlen oppose son vivre, son devoir de regard, avec exigence : ne laisse pas aller le monde – sans toi – privilégie l’excès – reste – éteins le malheur – et vois.
Ces propos sont tout aussi valables pour Catherine Mafaraud-Leray, que l’on découvre, tout comme Merlen, dans Poésie 1, la revue de Jean Breton. Il s’agit du n°74, « Les Poètes et le Diable », en 1980. Celle qui se nomme Katrine Mafaraud est alors âgée de trente-trois ans. Elle a publié trois recueils, dont le détonnant : Je suis laide aujourd’hui comme une cathédrale (1978). Si j’écris que ce livre est détonnant, c’est qu’il fut reçu ainsi, tranchant radicalement par ses cris et sa violence, d’avec la production poétique de l’époque. Catherine Mafaraud-Leray publie, par la suite, dix livress et plaquettes, dont : Dites-le aux dahlias, aux crapauds et aux chiens (2005) et Un os d’arrogance entre les reins (2010).
Comme chez Merlen, mais dans un registre et une poétique qui lui sont propres, Mafaraud-Leray écrit, non sans humour noir ou ironie, l’urgence dans l’urgence, sous la crasse horrible et violente du jour qui monte : celle du corps, de l’amour, de la mort, des duos de mâchoires qui s’affrontent, des ombres qui se mordent, de la jouissance et des sexes qui s’avalent, la déchirure du désir, avec la liberté pour seul vice.
On comprend donc aisément ce qui a pu rapprocher Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen. Dès maintenant, il est manifeste, que C’est nous la mort… de Catherine Mafaraud-Leray et de Michel Merlen est vécu et ressenti vitalement : La mort viendra – Je sais – mais je vivrai d’abord… C’est nous la mort – joyeuse comme un faire-part, écrit Merlen. Mafaraud-Leray y ajoute sa violence et sa révolte : Le corps est un égout – Qui se vomit dedans – Les arbres mes complices – Dans un filet de cygnes – Me tendent leurs cous noirs – Et leur corde gelée.
La poésie de Mafaraud et de Merlen, et C’est nous la mort… le confirme, est une tension extrême de tout l’être hors de lui-même vers sa vérité, qui nous arrache enfin des cris qui peuvent bien s’exténuer et se ruiner, mais dont il reste toujours assez d’éclats dans l’air pour que nous nous entendions au moins une fois aimer et vivre, pour que nous entendions ces cris qui ne nous appartiennent plus dès qu’ils ont quitté nos lèvres, qui ne sont plus à personne parce qu’ils sont ceux de l’homme dans la solitude et dans l’amour.
Christophe Dauphin (in revue recoursaupoeme.fr, 10 juin 2012).
*
MICHEL MERLEN OU LA POESIE COMME QUITTANCE DU VIVRE
Dès que l'ennui tourne le dos, je rejoins quelques êtres et lieux de ma micromythologie, certains parcours tirent toutes les courtes pailles du rituel, les rues infatigables. Le regard picote les lumières et les rapines à venir.
Années 80. Presque chaque semaine, avant le rendez-vous au Pont de l'Epée, j'inspecte mes librairies. Chez Oterello, surréalisme, livres précieux, espèce protégée. Emiettant mille minuties, le propriétaire m'accorde le privilège de feuilleter l'édition originale de La sauterelle arthritique. Mine de masque au mur, André Breton, les yeux fermés, protège les bonds, les souffrances ironiques de la petite Gisèle. Au Partage des eaux Alex a sauvé de la noyade deux exemplaires de Poètes d'aujourd'hui : Roger Gilbert-Lecomte et Saint-Pol-Roux patientent au sous-sol. Se sont-ils compris ? Dans la vitrine de Tshann le reflet d'Yves Martin ricane à l'infini. Aucun doute, le petit jour a fait bouillir son vin. Quelques restos, quelques cafés plus loin, L'oeil écoute. Sous surveillance du cyclope claudelien, je maraude dans les oeuvres complètes de Marcel Aymé -cuir bleu- illustrées par Topor, lequel, tombé amoureux de la Vouivre, laisse l'inspiration se balader pieds nus dans la sinuosité des vipères.
Mais l'inspection la plus longue, celle qui exige la patience méticuleuse de démineur, m'attend rue du Cherche-Midi, à la librairie des éditions du même nom, qui abrite également les publications des éditions Saint-Germain-des-Prés. Dans les rayons, des milliers de recueils se blottissent comme des orphelins ; mais l'expérience instruit la méthode : je n'effectue mes prélèvements que dans la contexture des collections Poètes contemporains, Haut langage, Poésie pour vivre, Blanche. Les autres étiquettes constituent l'immense quantité négligeable des victimes de la flibuste. J'ai ainsi lié connaissance avec Alain Morin, hallucination errante ; Jocelyne Curtil au point de non-retour ; Daniel Biga, le volatile Mohican ; André Shmitz, dompteur d'éclairs rapaces ; tant d'autres...Cette fois, c'est La peau des étoiles qui attire mes doigts. Auteur : Michel Merlen. Je lis : "Les femmes sont des puits où je n'ose descendre / pourtant d'elles montent des enfants"... Ecriture autodéfense, vers atémis ; le titre ne ment pas: trouver les mots pour soulager l'épiderme à vif des lueurs trop lointaines.
Michel Merlen incarne par excellence le poète tel que l'envisageaient Jean Breton et Serge Brindeau, en 1964, dans Poésie pour vivre (Manifeste de l'homme ordinaire) : "La vie ordinaire devient trop enlaçante pour qu'on la néglige, c'est elle que nous inscrivons." Mais aussi : "Le langage à son tour irrigue le monde qui l'a fait naître, il exprime comme il peut le "réel", mais il le transforme, et cette métamorphose paraît plus vraie que l'expérience primitive... Que votre écriture soit aussi insolite et contradictoire que la magie ordinaire..." Il ne s'agit donc pas d'énoncer banalement la banalité ; pour ça, nul besoin de poètes. Il se trouve pourtant des escouades d'auteurs qui, semble-t-il, ne retiennent que la première phrase de l'extrait cité plus haut. Aussi une multitude de textes indigents, sous couvert de "lyrisme ordinaire", ont-ils été promus poèmes, quand bien même ils se satisfont de traînasser au ras - pas même des pâquerettes.
Le quotidien, l'ordinaire, certes, mais en perpétuel mouvement avec l'imaginaire, la colère, l'émerveillement, la violence, l'amour... et surtout, surtout : le style. Celui de Michel ne saisit la banalité, le "jour le jour", que pour en révéler le chant, "l'absence absolue de frontières", blues , souvent, du temps rauque, déréliction nomade qu'éclairent fugitivement la beauté féminine ("Je veux qu'on le sache / j'ai de l'admiration pour tout ce qui est vivant / pour le pain chaud de tes cuisses / les fraises de ton sexe..."), la mer en marées-marelles d'enfance, le génie de certains lieux: Hyères, la Tunisie, quelques dédales parisiens (" Je n'étais pas encore blessé à mort quand j'étais à Tunis, à Hyères, à Port Cros"). La blessure originelle : l'abandon. Fils de l'absence, mère "made in America", Michel sait que la plaie ne cicatrise pas, elle saigne ailleurs, et l'âme se heurte au front du père - qui aurait voulu écrire - ("ils n'ont pas voulu / ni te tuer ni que tu vives / ils ont fait l'amour mal / le hasard d'une naissance s'est levé.").
L'Algérie, la guerre, douleur, cette fois, de toute une génération (Venaille, Laude...) au cœur des trente - pas si "glorieuses" qu'on l'affirme. Désertion, prison des Baumettes, régiment disciplinaire. Michel, refusant de tuer, sortait avec son arme, mais sans cartouches. Déserteur de l'odieux, il le reste, il faut échapper aux constrictions du temps, respirer enfin à pleins regards, capter le hasard au lisse d'une épaule, les coïncidences fondantes, l'instant va-nu-pieds ; sûr, au bas du boulevard, s'ouvre le passage vers les rues de la mer. Poète marcheur, il ne débusque pas le pittoresque comme le piéton de Paris ; s'il y a connivence avec Fargue, c'est la haute solitude. Celle-ci ne s'élève pas sans risques ("je sors des hôpitaux / pour me soigner / au vent cinglant des villes...je ne sais pas pourquoi je marche"), l'identité menace dissolution, les particules de soi sont hautement instables, l'abattoir du silence attend froidement l'aboiement muet de qui l'homme en blouse blanche prend la main, sans lui dire bonjour. Michel ne camoufle pas, ne maquille pas les paupières tremblantes ; sa poésie, comme celle de Chambelland, n'hésite pas à dénuder le noyau, comme celle de Delbourg où xanax peut rimer sans remords avec Astyanax. Alors la violence s'impose, vitale. Mais peu de rapports avec les incantations somptueuses d'Artaud, l'humour désarticulé d'un Michaux désespérément jubilant. Michel, dans la tiédasserie qui en ces temps s'impose, s'accorde le luxe d'être une violence modeste.
"Il te faut créer pour te faire entendre". Le verbe entendre occupe tout son sens, l'auditif comme simple médium de comprendre, puis d'aimer, non d'amour mesquin et possessif, retranché, mais celui de faire corps avec tout ce qui palpite : les galets mouillés par le large attestent l'été des corps, les trottoirs pluvieux des villes reflètent l'urgence des rencontres, ça clignote le vertigineux, pendant que, plus tôt, plus tard, ou simultanément, "le beau temps tient / grâce au sourire des passantes." Le jeune homme - non sans anxieuse pudeur - déboutonne son gris, parce que les mots l'ont retrouvé. Alors, vite, écrire, le langage prouve la présence, comme les traces de lynx dans la neige.
Si j'étais sérieux, rationnel, exégète, j'établirais le corpus des poèmes de Merlen où, de toute évidence, l'altérité fusionne avec le mystère d'être soi, unique (sans propriété, contrairement à Stirner). Mais je ne suis pas très méthodique. Je me laisse aller à repérer une généalogie du hasard, et je ne vois -si je m'en tiens à la poésie contemporaine - qu'un seul cousin par alliance de Michel Merlen: Gérald Neveu, qui, tout simplement, espérait: " dans la nuit de la nuit / faire pousser une autre nuit / à grands coups de tête."
Jean-Michel ROBERT
*
Marine
Il y a urgence
plus rien ne bouge
jusqu'aux os qui se taisent
ce silence quel crime !
Il y a des ennemis de la poésie
partout
pourtant quand le long métro bleu
entre dans le port
sous les jeans
les cuisses s'ouvrent.
Sept mois
Sept mois sans douleur
sous anesthésie
sans prendre une femme
sous un ciel de lit.
Circuit de la solitude
double huit
à la chaîne
un maillon file
licenciement
Ma tête parking vide
la folie entre
sans crier gare
Chaque mot tu
avorte une image
à force d'atteindre le hasard
mon regard banalise les villes.
Extraits de Le jeune homme gris, le dé bleu, 1980.
Michel Merlen