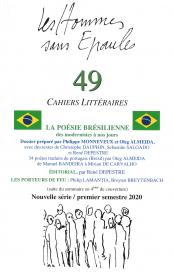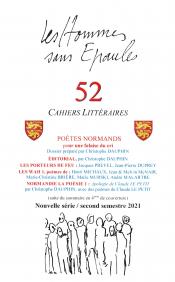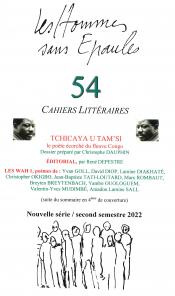Léopold Sédar SENGHOR

Léopold Sédar Senghor est né le 9 octobre 1906 à Joal, ville côtière située au sud de Dakar, Sénégal. Son père, Basile Diogoye Senghor, est un commerçant catholique. Originaire de Djilor, sa mère, que Senghor appelle dans Élégies « Nyilane la douce », appartient à l’ethnie sérère. Il obtient une demi-bourse de l’administration coloniale et quitte pour la première fois le Sénégal à l'âge de 22 ans. Senghor arrive à Paris en 1928. Cela marque le début de « seize années d’errance ». Senghor étudie en classes préparatoires littéraires au lycée Louis-le-Grand et également à la faculté des lettres de l'université de Paris.
À Louis-le-Grand, il côtoie Georges Pompidou, avec qui il se lie d'amitié. Il y rencontre également Aimé Césaire pour la toute première fois. Il obtient en 1931 une licence de lettres. Étudiant, il crée en compagnie du Martiniquais Aimé Césaire et du Guyanais Léon-Gontran Damas la revue L'Étudiant noir en 1934. C'est dans ces pages qu'il exprime pour la première fois sa conception de la négritude, notion introduite par Aimé Césaire, dans un texte intitulé « Négrerie ». Césaire la définit ainsi : « La négritude est la simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, de notre histoire et de notre culture ». Senghor affirme : « la négritude, c’est l’ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles qu’elles s’expriment dans la vie, les institutions et les œuvres des Noirs. Je dis que c’est là une réalité : un nœud de réalités ».
En 1935, il est reçu au concours d'agrégation de grammaire après une première tentative non couronnée de succès. Il est le premier Africain lauréat de ce concours. Pour s'y présenter il a dû faire une demande de citoyenneté5, il possédait auparavant le statut de sujet français. Il commence sa carrière de professeur de lettres classiques au lycée Descartes à Tours, puis est muté, en octobre 1938, au lycée Marcelin-Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés.
En 1939, Senghor est enrôlé comme fantassin de 2e classe dans le 31e régiment d'infanterie coloniale, composé d'Africains. Le 20 juin 1940, il est arrêté et fait prisonnier par les Allemands à La Charité-sur-Loire. Il est interné dans divers camps de prisonniers dont au Frontstalag 230 de Poitiers, réservé aux troupes coloniales. Il est libéré, pour cause de maladie. Au total, Senghor passera deux ans dans les camps de prisonniers.
Il reprend ses activités d'enseignant et participe à la résistance dans le cadre du Front national universitaire. Son premier livre de poèmes, Chants d’ombre, paraît aux Éditions du Seuil en 1945. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il reprend la chaire de linguistique à l’École nationale de la France d’outre-mer qu’il occupera jusqu'à l’indépendance du Sénégal en 1960.
Le chef de file des socialistes sénégalais, Lamine Guèye, lui propose d'être candidat à la députation. Senghor accepte et est élu député à l'Assemblée nationale française, représentant la circonscription du Sénégal et de la Mauritanie, où les colonies viennent d'obtenir le droit d'être représentées. Le 12 septembre 1946, Senghor se marie avec Ginette Éboué (1923-1992), attachée parlementaire au cabinet du ministre de la France d'Outre-mer et fille de Félix Éboué, ancien gouverneur général de l'Afrique-Équatoriale française (AEF) ; avec qui il a deux fils. Il fonde avec Mamadou Dia le Bloc démocratique sénégalais (1948), qui remporta les élections législatives de 1951. Réélu député en 1951 comme indépendant d'Outre-mer, il est secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement Edgar Faure du 1er mars 1955 au 1er février 1956, devient maire de Thiès au Sénégal en novembre 1956 puis ministre conseiller du gouvernement Michel Debré, du 23 juillet 1959 au 19 mai 196112. Il est aussi membre de la commission chargée d’élaborer la constitution de la Cinquième République, conseiller général du Sénégal, membre du Grand Conseil de l'Afrique occidentale française et membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Entre-temps, il a divorcé de sa première épouse en 1956 et s’est remarié l'année suivante, le 18 octobre 1957, avec la blonde, la Normande, Colette Hubert (1925-2019). Leur fils unique, Philippe-Maguilen (1958-1981), décédera dans un accident de la circulation, à Dakar.
Le 20 aout 1960, après l’éphémère expérience de la Fédération du Mali (constituée en janvier 1959 par le Sénégal, le Mali, le Bénin et le Burkina Faso), le Sénégal proclame son indépendance. Le poète et socialiste Senghor est élu président de la République le 5 septembre 1960 à l'unanimité de l'Assemblée fédérale. Il est également l'auteur de l'hymne national sénégalais, « le Lion rouge ». Il sera réélu à quatre reprises (en 1963, 1968, 1973, 1978), jusqu’en 1980, année où il se démet librement et volontairement de ses fonctions. Léopold Sédar Senghor, celui qui fut en 1935 le premier Africain reçu à Paris, à l’agrégation de grammaire, puis le député de la brousse au Parlement français en 1946, puis le poète-président père du Sénégal indépendant depuis 1960 ; le théoricien de la négritude et de la… normandité, se retire de la vie politique. Il a soixante-quatorze ans. Il laisse le pouvoir à Abdou Diouf et se consacrera désormais à la culture. Il deviendra docteur honoris causa de nombreuses universités.
Senghor soutient la fondation de la Francophonie. Il sera vice-président du Haut-Conseil de la Francophonie. En 1962, il est l'auteur de l'article fondateur « le français, langue de culture », dont est extraite la célèbre définition : « La Francophonie, c'est cet Humanisme intégral, qui se tisse autour de la terre ». Il théorise un idéal de francophonie universelle qui serait respectueuse des identités et imagine même une collaboration avec les autres langues latines. En 1969, il envoie des émissaires à la première conférence de Niamey avec ce message : « La création d’une communauté de langue française sera peut-être la première du genre dans l’histoire moderne. Elle exprime le besoin de notre époque où l’homme, menacé par le progrès scientifique dont il est l’auteur, veut construire un nouvel humanisme qui soit, en même temps, à sa propre mesure et à celle du cosmos. »
Ses activités culturelles, en parallèles de son oeuvre poétique, sont constantes : en 1966, se tient, à Dakar, le 1er Festival mondial des arts nègres. Après avoir été désigné Prince des poètes en 1978, il est élu à l'Académie française le 2 juin 1983. Il est le premier Africain à siéger à l'Académie. la même année, il publie Liberté 4, comportant des textes politiques regroupés sous le titre Socialisme et planification. En 1993, il publie Liberté 5, sous-titré Le dialogue des cultures. Le 18 mars 1995, à Verson, où il réside, on inaugure un espace culturel qui porte le nom de son nom.
Malade, Senghor passe les dernières années de son existence auprès de son épouse, à Verson, en Normandie, où il décède le 20 décembre 2001. Si l’Etat Français ignore à peu près sa disparition, la région Basse-Normandie célébrera tout au long de l'année 2006 le poète engagé et l'homme d'Etat, à l'occasion du centenaire de sa naissance, au travers des différentes manifestations organisées par les institutions régionales. Ses obsèques ont lieu le 29 décembre 2001 à Dakar.
En tant que poète, Senghor fut un précurseur avec le mouvement de la Négritude, participa aux débuts de la revue Présence Africaine, fit venir à Dakar, en 1966, le premier festival Mondial des arts nègres. Il laisse une œuvre poétique d’une grande richesse.
En tant qu’homme politique, son action fut plus mitigée. On lui reproche d’avoir réprimé les mouvements sociaux et estudiantins dans les années 60, et d’avoir laissé Mamadou Dia, son ex-premier ministre, devenu son adversaire politique, en détention pendant douze ans. Mais, Senghor fut bien plus démocrate que beaucoup de ses contemporains en Afrique : « Certains chefs d’État civils ont cédé à la facilité. Ils ont fait de la dictature ou se sont laissés aller à la corruption. Il y a eu des soulèvements populaires, et l’armée est intervenue, qui représente un puissant élément d’ordre et de stabilité dans un pays en développement. Tout cela est logique, et cela est confirmé du reste par le fait qu’il y a eu, pour parler des francophones, stabilité dans des États comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Pour le Sénégal, cela provient, essentiellement, de ce que nous avions plus de cadres que les autres États francophones et que nous étions déjà habitués à la démocratie. Il reste que les régimes militaires ne se sont montrés ni plus honnêtes, ni plus efficaces, ni, en définitive, plus stables que les régimes civils. D’où, peu à peu, le retour des pays concernés vers le régime civil. Pour me résumer, les causes de notre instabilité politique en Afrique tiennent essentiellement à notre tempérament de Fluctuants, mais surtout à notre manque de culture moderne et de démocratie. Quand il n’y a pas de démocratie, le seul recours, c’est le soulèvement populaire, qui aboutit au coup d’État militaire. À mesure donc du développement de l’enseignement dans nos pays et du progrès de la démocratie dans nos États, nous retrouverons progressivement une certaine stabilité. Il s’agit d’une maladie infantile."
Une autre cause d’instabilité, pour Senghor : "Les coups d’État en Afrique ont été favorisés par l’un ou l’autre bloc. Il est évident, par exemple, que les Occidentaux ont favorisé les coups d’Etat militaires contre des chefs d’État qui se situaient à gauche, sans même se réclamer du « marxisme-léninisme »… Il reste que nous sommes, nous Africains, les principaux responsables de cette situation. En réalité, nous avons des complexes d’infériorité et nous entrons docilement dans le jeu des super-puissances. Bien sûr, je comprends très bien que, dans certains cas, tel chef d’État africain favorise telle grande puissance ex-colonisatrice, ou même l’un des deux Super-Grands, ce qui lui permet de résoudre des problèmes culturels, économiques, sociaux, politiques. Mais, plus gravement, nous avons une attitude de suivisme parce que nous ne voulons pas penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes, qu’en particulier et une fois de plus, nous Africains de gauche ne voulons pas faire une relecture africaine de Marx et d’Engels, comme Lénine l’avait fait en russe, Gramsci en italien, Mao en chinois, sans parler du français Jaurès, dont on parle trop sans l’avoir assez lu… »
Léopold Sédar Senghor a quitté volontairement le pouvoir après vingt ans d’exercice, en semant les graines du socialisme sénégalais et de la démocratie dans son pays. Il a réinstauré le multipartisme en mai 1976 (limité à trois courants : socialiste, communiste et libéral, puis quatre, les trois précédents rejoints par le courant conservateur) : « Nous sommes un pays de développement, et il ne faut pas multiplier les partis. Il faut faire du solide. Si nous avons pu tenir, et avancer pas à pas malgré la sècheresse, c’est que nous avons été de vrais socialistes démocrates, que nous avons tenté la vraie et non les fausses révolutions. La révolution, ce sont les nationalisations sélectives, et la priorité donnée au secteur rural, à la démocratisation de l’enseignement, à la fermeture de l’éventail des salaires, à la cogestion des entreprises motrices. De la « cogestion », nous nous acheminons progressivement vers une « gestion communautaire », qui sera animée par l’esprit négro-africain, je dirai même africain tout court. »
Le socialisme sénégalais, nous dit Senghor en 1980 « en partie parce qu’il est francophone, fait une plus grande place à la théorie. C’est que j’ai lu, en Négro-Africain, bien sûr, les œuvres des fondateurs du socialisme, depuis les œuvres des fondateurs du socialisme, depuis les utopistes français jusqu’à Mao Tsé-toung, en m’arrêtant surtout sur Marx et Engels, mais aussi Lénine, sans oublier Jaurès ni Blum. Mon objectif est, en communion de recherches et de pensées avec mes camarades sénégalais, d’élaborer une nouvelle théorie du socialisme. Nouvelle parce qu’intégrant les réalités négro-africaines : sénégalaises… Je vais dire maintenant, comment je vois notre société à l’horizon de l’an 2001, suivant le modèle que nous avons élaboré. L’État fait le plan, organise la vie économique du pays et contrôle. Il y a des « établissements publics administratifs », où il ne s’agit pas de faire des bénéfices, des « établissements publics à caractère industriel et commercial » où l’on doit faire des bénéfices et en employer une partie au réinvestissement, en fin, des « sociétés nationales » ou « sociétés d’État », proches des dernières et dont le statut reste à définir exactement, sans parler des sociétés d’économie mixte. En dehors des établissements publics administratifs, la cogestion entre l’État, les cadres, les employés et les ouvriers me semble être la meilleure solution. Pour le reste, il y aura les petites et moyennes entreprises, au statut desquelles nous pensons actuellement et que nous voudrions voir gérées sous forme de coopératives. Nous encourageons actuellement ce dernier modèle. Dans chaque département, par exemple, il y a des « coopératives de commerçants », qui se mettent ensemble pour se garantir réciproquement dans leurs achats. Nous songeons à un socialisme démocratique et communautaire, où l’on se distribue les rôles, les fonctions et les bénéfices. Celui-ci serait fondé sur la coopération entre l’État et les différents groupes socio-professionnels, l’État ayant l’initiative, mais permettant aux entreprises de cogérer dans un cadre de coopération. Tout cela n’est pas encore très détaillé, ni définitif. C’est peu à peu, plan après plan et congrès après congrès, que nous allons, par un dialogue entre les militants comme entre la théorie et la pratique, réaliser ce modèle de société que voilà. »
L’œuvre poétique, le parcours politique et le rayonnement intellectuel de Senghor en font l’une des grandes figures africaines du XXe siècle.
Elégiaque-née, pure, sensuelle et musicale (de nombreux poèmes sont destinés à être accompagnés par des instruments traditionnels : khalam, flûte, balafong, rîti, tama, tam-tam, trompe, gorong, kôra), la poésie de Senghor possède un sens innée du rythme : « Le pouvoir de l’image analogique ne se libère que sous l’effet du rythme. Seul le rythme provoque le court-circuit poétique et transforme le cuivre en or, la parole en verbe ». La poésie senghorienne est humaniste : L’émotion est nègre comme la raison est hellène.
Son langage est un langage de haut vol, nimbé d’un halo de sève et de sang qui marque l’un des plus hauts pics de la création poétique contemporaine. Africain universel, Léopold Sédar Senghor ne cessera jamais, tant dans ses discours que dans ses poèmes, de prôner à la fois l’enracinement dans les traditions du monde noir, et l’ouverture aux autres civilisations. L’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, qu’il publie en 1948, représente sans doute, à cet égard, l’un des points culminants de l’aventure de la négritude. Une aventure commencée une vingtaine d’années plus tôt.
Colette Senghor disparait à son tour, lundi 18 novembre 2019, à l’âge de 93 ans, dans sa maison de Verson (Calvados), là même où Léopold est décédé lui-même le 20 décembre 2001. La maison du 150 rue du Général-Leclerc à Verson et son jardin, le Square de Tocqueville, à Paris; j'ai connu, oui, du vivant de Léopold et même avec Césaire, comment oublier...
Nous parlions de ce fameux concept, que je devais reprendre plus tard, en publiant : Riverains des Falaises, anthologie des poètes en Normandie du XIe siècle à nos jours (éditions clarisse, 2011) ; non pas la Négritude, mais… la Normandité. « Je dirai que la Normandité est, d’un mot, une symbiose entre les trois éléments majeurs, biologiques et culturels, qui composent la civilisation française : entre les apports pré-indo-européens, celtiques et germaniques. Mais je mets l’accent sur les apports des Nordiques. Pour me résumer, l’artiste normand, qu’il soit écrivain, peintre ou musicien, est un créateur intégral, avec l’accent mis sur la création elle-même. Comme le conseillait Flaubert, il faut « partir du réalisme pour aller jusqu'à la beauté ». C’est la démarche même de la poésie, dont le sens éthymologique, fondamental, est la création de la beauté », aimait dire et rappeler Senghor.
Il me souvient aussi que, poète tubab à Popenguine, j’ai vu, Léopold, ta falaise qui, non, n’était pas plus haute que les nôtres en Normandie ; tu t’en amusais, et les Dents de la mer, à Dakar... Comment oublier. Hommage à toi, hommage à Colette, la sentinelle-tendresse, mon pays-normand ; oui, cela lui va bien.
Léopold Sédar Snghor n'est ni grand, ni immense, c'est un Géant !
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
Œuvres de Léopold Sédar Senghor : Poésie complète (Cnrs éditions, 2007). Essais : Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française (PUF, 1948), Liberté 1, Négritude et humanisme (Le Seuil, 1964), Liberté 2, Nation et voie africaine du socialisme (Le Seuil, 1971), Liberté 3, Négritude et civilisation de l’Universel (Le Seuil, 1977), Liberté 4, Socialisme et planification (Le Seuil, 1983), Liberté 5, Le Dialogue des cultures (Le Seuil, 1992), La Poésie de l’action (Stock, 1980), Ce que je crois (Grasset, 1988).
Avec Senghor, on ne sait jamais quand aborder, où aborder pour le cerner et le saisir, lui dont on pourrait dire selon les mots de Driss Chraibi qu’il a partout « sous les assises du différent cherché le semblable ». La poésie de Léopold Sédar Senghor, du reste comme l’homme, aura marqué son siècle. Cette poésie servie par l’Histoire et nourrie par un rare génie a donné ses lettres de noblesse non seulement à un peuple, à une diaspora, mais encore, et par un piquant paradoxe, à la langue du peuple colonisateur. Qu’on ne s’y trompe pas comme le veut faire croire une certaine critique, la poésie de Senghor n’est pas tournée vers le passé, résolument « dépassée », sans aucune prise sur notre monde d’aujourd’hui !
La poésie de Senghor vit et « signifie » dans son fond comme dans sa forme. Si la rime est morte, l’alexandrin dévoyé, le ver libre éclate au grand jour, révolutionne les grilles littéraires, renouvelle la poésie dans ce qu’elle avait perdu de plus vrai, de plus spontané, de plus libre, de plus charnel, de plus fou : la PAROLE libérée de toutes normes, de toutes barrières. La poésie de Senghor aura permis au genre d faire peau neuve avant et avec le surréalisme et de lui donner un nouveau souffle et un nouvel élan. L’Afrique, du reste, n’a pour courant littéraire que son âme et ses rythmes ! Quand l’Europe parlait de « surréalisme », nous parlions déjà, des siècles auparavant, de « sous-réalisme ». Et dynamique heureuse : Senghor est contemporain ! Il pourrait figurer parmi la nouvelle génération de poètes sénégalais, avec une poésie « nouvelle » que lui, Senghor, a su aborder et apprivoiser avec cette saveur que seuls peuvent posséder les vins anciens. Ensuite, avec ces pairs du courant de la négritude dont il demeure le chef incontesté. Voilà le poète. Voilà une poésie née deux fois, pour servir et pour donner à naître. La jeune génération des poètes sénégalis se reconnaîtra sûrement dans Lettres d’hivernage, sans doute les poèmes sinon les plus beaux de Léopold Sédar Senghor, assurément les plus vrais et les plus touchants, parce que nous rapprochant davantage de sa vie intime, amoureuse et fraternelle. Ce poète est poète jusqu’à la moelle des os.
Bien sûr, et il faut le taire, on a souvent tiré à boulets rouges sur l’homme ou plutôt sur l’homme politique et le concept de « négritude » plus particulièrement parce que ce concept, disait-on, était élevé au rang d’une idéologie d’État. La négritude était ainsi confondue à un homme qui n’en était pourtant pas l’inventeur mais le tranquille et non moins passionné défenseur. « Et c’est peut-être parce que la négritude se trouvait installée sur une double voie intellectuelle et politique, comme l’a souligné l’essayiste Roger Dorsinville, que le socialisme sénégalais se trouvait être un socialisme de conciliation, un socialisme de persuasion par l’argument culturel ».
En d’autres termes, cela veut dire que « la négritude à partir de l’exercice du pouvoir avait, a eu la possibilité d’agir sur les convictions par le dialogue ». il s’agissait, dès lors, poursuit l’essayiste, s’appuyant sur la politique, « d’utiliser en arguments convaincants l’art nègre, la littérature orale, la pertinence de traditions, els offrant en valeurs complémentaires aux civilisations endurcies par l’exercice de la puissance ». Voilà ce qu’était et ce qu’est la négritude de Senghor, la négritude tout court. La contester ou contester l’homme, c’est toujours servir la culture, faire avancer la réflexion, enrichir la pensée, faire douter ou espérer de l’avenir de l’homme noir. De l’homme. Mais retrouvons le poète, celui-là qui fait peu douter et beaucoup espérer, celui-là qui a tant donné au monde. Et c’est à ce grand poète qu’on aurait voulu dire ces paroles empruntées à Gaston Roger : « Il me semble que vous êtes parvenu à la limite de la possibilité verbale, là où les mots si poétiques qu’ils soient, ne peuvent plus grand-chose pour la révélation des profondeurs, et doivent céder le pouvoir à la musique. Même Rimbaud a trouvé ce seuil, au-delà duquel il n’a pu opter que pour le silence ». Mais le silence pour Léopold Sédar Senghor, sera encore et toujours de la poésie.
Amadou Lamine SALL
(in revue Poésie 1 n°131, 1986, Poètes du Sénégal. Les Hommes sans Epaules éditions).
*
ÉLÉGIE DES ALIZÉS (Extrait)
(..)
Souffle sur moi, sagesse, quand grondent en moi les
cataractes des sangs anciens.
Je vivrai ouvert à la mer, mère nourricière de l’esprit.
Me nourrissent l’eau et le sel, la chair des fruits et le mil des
poissons.
La nuit venue, en attendant le déluge
Entre deux tornades sèches, soufflera, c’était lors à Djilor
Entre deux crises, le sourire de brise sur l’oreille de
l’Aïeule.
Non, sous tes yeux je serai, soufflera sur ma fièvre le
sourire de tes aïeuls alizés
Tes yeux vert et or comme ton pays, si frais au solstice de
juin.
Où es-tu donc, yeux de mes yeux, ma blonde, ma Normande, ma
conquérante ?
Chez ta mère à la douceur vermeille ? - j’ai prisé votre
charme ô femme ! sur le versant de l’âge –
Chez ta mère à la vigne vierge, avec le rouge-gorge
domestique, les merles et mésanges dans les
framboises ?
Ou chez la mère de ta mère au chef de neige sous les
Ancêtres poudrés de lys
Pour retourner au Royaume d’Enfance ?
Te voilà perdue à me retrouver au labyrinthe des
pervenches, sur la montagne merveilleuse des
primevères.
Ne prête pas l’oreille aux lycaons ! Ils hurlent sous la
lune, férocement forçant les daims du rêve.
Mais chante sur mon absence tes yeux de brise alizés, et que
l’Absente soit présence. »
Léopold Sédar SENGHOR
(in Élégies majeures, Le Seuil, 1979).
NON À LA CURÉE DES CHACALS ET DES HYÈNES SUR L’HÉRITAGE DE SENGHOR
« On connaît le plus fort de tous les animaux : c’est Gaïndé-le-lion, roi de la brousse. On connaît le plus vieux : c’est Mame-Gnèye-l’éléphant. On connaît aussi le plus malhonnête et le moins intelligent : c’est Bouki-l’hyène. »
Léopold Sédar Senghor (in La belle histoire de Leuk-le-lièvre, Hachette, 1953).
Vendredi 20 octobre 2023
Léopold Sédar Senghor a disparu le 20 décembre 2001, à l’âge de 95 ans, dans sa maison de Verson (Calvados, Normandie). L’œuvre poétique, le parcours politique et le rayonnement intellectuel de Senghor en font l’une des grandes figures du XXe siècle et de l’Afrique.
La poésie senghorienne est humaniste. Son langage est un langage de haut vol, nimbé d’un halo de sève et de sang qui marque l’un des plus hauts pics de la création poétique contemporaine. Africain universel, père de l’indépendance du Sénégal et de la francophonie, chantre de la Négritude, mouvement qu’il a cofondé dans les années 30 avec Aimé Césaire, premier africain agrégé en grammaire française et membre de l’Académie française, Léopold Sédar Senghor ne cesse, tant dans ses discours que dans ses poèmes, de prôner à la fois l’enracinement dans les traditions du monde noir, et l’ouverture aux autres civilisations.
Et c’est l’héritage de cet homme-là, immense, qui va, en partie, demain, à 14h, samedi 21 octobre 2023, être livré dans la salle des ventes de Caen, aux enchères. Pas moins de 205 objets, notamment des bijoux et des décorations vont être dispersés.
Pourquoi ? De succession en succession depuis la mort de Colette Senghor, le 18 novembre 2019, à l’âge de 93 ans, la dernière héritière en date de Léopold Sédar Senghor (qui n’a aucun lien de parenté avec le poète) aurait très bien pu décider de confier ce patrimoine, dont elle n’a visiblement que faire, à la république du Sénégal, pour qu’il rejoigne les collections du musée Senghor de Dakar. Elle n’en a rien fait, préférant spéculer et faire du fric sur la mémoire du grand homme. Le prestigieux collier de l’ordre du Nil est ainsi mis à prix entre 10.000 et 15.000 euros. C’est son droit. Le nôtre, de droit, c’est de trouver cela dégueulasse et immonde.
Cette vente n’a rien à voir avec l’État français et la ville de Verson, qui est propriétaire, selon la volonté de Colette Senghor, du parc, de la maison du couple Senghor, du mobilier et de 25 m3 d’archives écrites. Dans son testament, Colette demande « que cette maison du poète soit un lieu vivant accessible au public. » La « légataire » n’en est pas à son coup d’essai. Déjà, le samedi 23 janvier 2021, toujours dans cette salle des ventes de Caen, le tableau de Pierre Soulages qui était accroché de son vivant dans le bureau de Léopold Sédar Senghor, avait été mis en vente, pour un résultat de 1,5 million d’euros, en 10 minutes. Ce tableau je l’ai toujours vu accroché dans le bureau de Léopold, à Paris, puis à Verson. La légataire de l’œuvre ? Colette Senghor a légué le tableau et une partie du patrimoine à sa sœur, à sa mort. Cette dernière a disparu un an plus tard. Et l’héritage est allée à une amie de la sœur de Colette Senghor.
L’émotion est grande parmi les amis, dont je suis, de Léopold Sédar Senghor, et davantage encore au Sénégal, au sein du peuple, des poètes, au premier rang Amadou Lamine Sall, le chef de file de la poésie sénégalaise contemporaine, et le président de la République Macky Sall, qui a de suite saisi son ministre de la Culture et l’ambassadeur du Sénégal en France. Le Sénégal sera présent demain dans cette sordide salle des ventes pour éviter l’éparpillement et tenter de sauver ce qui pourra l’être de cet héritage senghorien. Cela lui coûtera cher. Mais ce n’est pas fini, puisqu’une nouvelle vente est déjà annoncée pour janvier 2024. Il s’agit cette fois, du dépouillage d’une partie de la bibliothèque du poète…
Samedi 21 octobre 2023
Une bonne nouvelle ! La vente aux enchères des biens de Léopold Sédar Senghor à Caen est suspendue. L’ambassadeur du Sénégal en France et le ministère des Affaires étrangères français ont présenté une demande de médiation de l’État sénégalais autour des lots issus de la succession de Colette et de Léopold Sédar Senghor. L’État sénégalais, pour préserver la mémoire et le patrimoine de son ex-président (1960 à 1980), souhaite acquérir la totalité du fonds Senghor, qui appartient à une particulière.
Dans son communiqué, le Sénégal indique : « Par devoir patriotique et pour préserver la mémoire et le patrimoine que constitue le président Senghor, le président de la République, Macky Sall, a demandé au ministre de la Culture et du Patrimoine historique, en relation avec l’ambassadeur du Sénégal à Paris, d’engager des discussions, par les voies appropriées, avec le commissaire-priseur, en vue de permettre l’acquisition, par l’État du Sénégal, des objets mis en vente ». « Ma vendeuse et moi-même comprenons parfaitement l’émoi suscité par cette vente auprès des Sénégalais et des Senghoristes, nous avons donc décidé de surseoir à la vente dans un objectif de dialogue », a déclaré la commissaire-priseur Solène Lainé.
Le ministre de la Culture du Sénégal Aliou Sow conclut : « Ces objets sont précieux, sur le plan symbolique, sur le plan historique, sur le plan de la valorisation et de la préservation des attributs de notre patrimoine historique. Pour le président Macky Sall, toute chose rattachable à l'histoire du Sénégal, à ses figures emblématiques, doit être préservée et mise à la disposition de ce même peuple. Pour que chacun puisse en jouir et l’explorer comme étant un élément important d’une tranche de notre histoire. Le président Senghor n’appartient pas à une famille, à des héritiers. Il appartient à la nation toute entière. »
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).