Yves GASC

PORTRAIT DU POÈTE EN COMÉDIEN, HOMMAGE A YVES GASC
par
Christophe DAUPHIN
Yves Gasc est décédé jeudi 22 novembre 2018, à l’âge de 88 ans. Le comédien était immense, tout comme le metteur en scène. Le poète était à l’assaut de son propre donjon, comme l’a écrit Jean Breton, avec une vibration de cristal que rend un cœur authentique, qui résonne dans tous ses poèmes. Yves était enfin et surtout un très grand ami. Son dernier enregistrement, son ultime participation aux Hommes sans Épaules, aura été le livre–CD (avec les voix d’Yves Gasc, de Janine Magnan et de Philippe Valmont), « Drôles de rires, Aphorismes, contes et fables, une anthologie de l’humour » de Alain Breton et Sébastien Colmagro. Retour sur l’itinéraire d’Yves Gasc.
La vocation de comédien se manifeste très tôt chez Yves Gasc (né le 21 mai 1930), encore proche de l’adolescence, lorsqu’il intègre le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, dans les classes de Jean Yonnel et Georges Le Roy. Il débute en 1950, changé en philosophe de L’Île de la raison de Marivaux, avec la compagnie l’Équipe. Trois ans plus tard, il adapte pour la scène, Le Cahier bleu, d’André Billy, puis en 57, gageure réussie, Mon Faust de Paul Valéry, qu’il joue avec Emmanuelle Riva, au théâtre Gramont. C’est ensuite, en 61, une autre tentative audacieuse : l’adaptation scénique des Vagues de Virginia Woolf, promesse à risque certes, mais enlevée du jeune Gasc. À l’âge de vingt-trois ans, Yves Gasc est engagé au Théâtre national populaire, en 1953, par Jean Vilar, qui le nomme par la suite responsable des soirées ou matinées poétiques et littéraires du Théâtre national de Chaillot, au Festival d’Avignon et en tournée. Plus tard, dans son premier livre de poèmes, L’Instable et l’instant (1974), Yves Gasc écrira le « Tombeau de Jean Vilar », pour lequel il nourrissait une forte amitié, admiration et reconnaissance : Homme tout droit comme une épée – Épée debout dans la terre – Beaucoup d’amour pas de prière – Un regard dur comme la pierre – Les yeux tournés vers le futur. Yves Gasc se frotte à nouveau à la mise en scène et collabore fréquemment avec Laurent Terzieff. Il reste dix ans au TNP et y interprète : Ruy Blas de Victor Hugo, mise en scène Jean Vilar, TNP Théâtre de Chaillot ; Lorenzaccio de Alfred de Musset, mise en scène de Gérard Philipe ; Macbeth de William Shakespeare, TNP Festival d’Avignon ; L’Étourdi de Molière, mise en scène de Daniel Sorano, TNP Théâtre Montansier ; Les Femmes savantes de Molière ; Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, mise en scène de Jean Vilar, TNP Festival d’Avignon ; L’Avare de Molière ; Le Malade imaginaire de Molière, mise en scène de Daniel Sorano, TNP Théâtre de Chaillot ; Henri IV de Luigi Pirandello, mise en scène de Jean Vilar, TNP Festival d’Avignon ; Meurtre dans la cathédrale de T. S. Eliot, mise en scène de Jean Vilar, TNP Festival d’Avignon ; Ubu roi d’Alfred Jarry, TNP Théâtre de Chaillot ; L’École des femmes de Molière, mise en scène de Georges Wilson, TNP Théâtre de Chaillot ; Œdipe d’André Gide, mise en scène de Jean Vilar, TNP, Festival de Bordeaux ; Les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset, mise en scène de Jean Vilar, TNP Festival d’Avignon ; La Mort de Danton de Georg Büchner, mise en scène de Jean Vilar, TNP Théâtre de Chaillot ; La Fête du cordonnier de Michel Vinaver d’après Thomas Dekker, mise en scène de Georges Wilson, TNP Théâtre de Chaillot ; Mère Courage de Bertolt Brecht, mise en scène de Jean Vilar, TNP Festival d’Avignon ; Les Précieuses ridicules de Molière, mise en scène d’Yves Gasc, TNP Théâtre de Chaillot ; Erik XIV d’August Strindberg, mise en scène de Jean Vilar, TNP Théâtre de Chaillot, Festival d'Avignon ; Polyeucte de Corneille, mise en scène de Jean-François Rémi, Théâtre de l'Alliance française ; L’École de dressage de Francis Beaumont et John Fletcher, mise en scène d’Yves Gasc, Théâtre Récamier ; Dieu, empereur et paysan de Julius Hay, mise en scène de Georges Wilson, TNP Festival d’Avignon…
En 1961, il fonde une jeune compagnie et obtient avec La place royale de Corneille, jamais jouée depuis sa création en 1636, le prix de la mise en scène au Concours du Jeune Théâtre et le prix du Masque et la Plume pour la meilleure reprise classique de l’année. Puis après une longue tournée autour du monde avec Tartuffe de Molière, qu’il réalise et dont il interprète le rôle-titre, il entame une collaboration de plusieurs années avec Laurent Terzieff et joue Zoo story d’Edward Albee, Les Amis d’Arnold Wesker, Richard II de Shakespeare, avec Laurent Terzieff à l’Atelier, Le roi Lear, avec Jean Marais au théâtre antique de Vaison-la-Romaine, etc. Yves Gasc fait partie de la Compagnie Renaud-Barrault entre 1973 et 1977, y joue entre autres, l’Explicateur dans Christophe Colomb et le Roi dans la dernière journée du Soulier de satin de Paul Claudel, mais aussi Colin Higgins (Harold et Maud), Villiers de l’Isle Adam, Restif de la Bretonne... Yves Gasc comédien, c’est, comme l’a écrit Henri Rode : l’art du mentir-vrai. Yves ne cesse d’obéir au besoin, à la fièvre d’être toujours soi à travers même les personnages les plus imprévus. Yves Gasc écrit lui-même : « Dans le comédien demeure toujours un homme à la recherche de son identité. Il espère la retrouver à chaque nouveau rôle et s’épuise dans cette poursuite comme un mystique en quête de l’absolu. »
En 1978, il est engagé par Pierre Dux à la Comédie-Française, dont il est nommé Sociétaire (il est le 470e sociétaire) quatre ans plus tard. Il travaille sous la direction de metteurs en scène aussi divers que J.-P. Roussilon, J.-Luc Boutté, J. Lassalle, J.-P. Vincent, G. Lavaudant, Jean-Louis Benoît, Roger Planchon... À la Comédie-Française, il anime ou interprète seul de nombreuses soirées littéraires et poétiques. il interprète le répertoire classique et contemporain, jouant entre autres dans : Mystère bouffe et fabulages de Dario Fo ; Oh les beaux jours de Samuel Beckett ; Dom Juan de Molière ; Les Trois Sœurs de Tchekhov ; La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux ; Médée d’Euripide ; Marie Tudor de Victor Hugo ; L’École des femmes de Molière ; La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux ; Le Balcon de Jean Genet ; Le Bourgeois gentilhomme de Molière ; Dialogues des carmélites de Georges Bernanos ; Un mari d’Italo Svevo ; Antigone de Sophocle ; Caligula d’Albert Camus ; Le Faiseur d’Honoré de Balzac ; Occupe-toi d’Amélie de Georges Feydeau ; Moi d’Eugène Labiche ; Cinna de Corneille ; Le Mariage de Witold Gombrowicz ; Opéra savon de Magnin… Il met en scène à la Comédie-Française : Le Montreur d’Andrée Chedid ; Paralchimie de Robert Pinget, Le jour où Mary Shelley rencontra Charlotte Brontë d’Eduardo Manet ; Le Triomphe de l’amour de Marivaux ; Le Pain de ménage et Le Plaisir de rompre de Jules Renard ; Turcaret d’Alain-René Lesage ; Le Châle de David Mamet ; Le Fauteuil à bascule et L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune de Jean-Claude Brisville... Il quitte la troupe en décembre 1997 et est nommé Sociétaire Honoraire en janvier 1998, ce qui lui permet de rejouer à la Comédie-Française quand on le lui demande, mais aussi dans le Théâtre privé. On le verra par la suite dans le rôle du Trissotin des Femmes savantes, mis en scène par Simon Eine, (1998), le bossu dans Amorphe d’Ottenburg, de Jean Claude Grumberg, mis en scène par Jean Michel Ribes (1999), l’Ivrogne excentrique et grotesque, lançant ses billevesées et invectives à travers la dictature dans Le Mariage, de Gombrowicz, mis en scène par Jacques Rosner (2001), Salle Richelieu, en mère abusive, aux sentiments bourgeois fabriqués, de Jacques ou la soumission d’Eugène Ionesco ; dans les rôles de Stépane, domestique de Kapilotadov, et Pépev, marchand, dans Le Mariage, de Nikolaï Gogol, en 2010. Dans le privé, Yves Gasc a joué entre autres, Lord Augustus dans L’Éventail de Lady Windermere, d’Oscar Wilde, adapté par Pierre Laville ; le Juge dans Dix petits nègres, mis en scène par Bernard Murat ; Oh les beaux jours, de Beckett (Willie), mis en scène par Frédéric Wiseman au Vieux colombier et le Juge dans Romance, de David Mamet, adaptée et mise en scène par Pierre Laville au théâtre Tristan Bernard ; en 2006/07, dans L’importance d’être constant, d’Oscar Wilde, mise en scène par Pierre Laville, au Théâtre Antoine ; en 2009, dans Philadelphia story, mise en scène par Pierre Laville, au Théâtre Antoine ; en 2013, avec Guillaume Gallienne, dans Oblomov, la pièce que Volodia Serre a tiré du roman d'Ivan Aleksandrovitch Gontcharov ; en 2014, dans La Visite de la vieille dame, pièce de Friedrich Dürrenmatt, mise en scène de Christophe Lidon.
Parallèlement, au cinéma, Yves Gasc a joué dans six films, dont : 1976 : Des journées entières dans les arbres (1976) de Marguerite Duras ; Beau-père (1980) de Bertrand Tavernier ou Tous les matins du monde (1991) d’Alain Corneau. Pour la télévision, Yves Gasc a joué dans près de trente téléfilms, dont : Maupassant ou le procès d’un valet de chambre (1972) de Jean Pierre Marchand ; La dernière carte ou la main de l’aube (1974) de Maurice Cravenne ; les poètes (1974) de Jean Pierre Prévost ; La Grande peur de 1789 (1974) de Michel Favart ; Le Front populaire (1976), de Claude Santelli ; L’Embrume (1979) de Josée Dayan ; Jacques le fataliste (1983) de Claude Santelli ou René Bousquet (2006) de Laurent Heynemann.
De la Comédie-Française au théâtre privé, Yves Gasc a continué à mener sa carrière avec passion ; une passion qu’il ne conçoit pas sans poésie et à propos de laquelle il donnera un précieux « bréviaire » : Comme dans un miroir, conseils au jeune comédien (1983) ; car Yves Gasc est un poète. Il n’y a aucune contradiction entre le comédien et le poète. L’un s’est toujours nourri de l’autre et vice versa. Une chose est certaine, c’est qu’il soit sur scène ou dans la solitude du poète, Gasc n’a jamais triché. L’art du comédien est unanimement reconnu. Celui du poète le mérite tout autant. C’est en parallèle de cette très prenante carrière d’homme de théâtre, qu’Yves Gasc élève discrètement mais sûrement, une œuvre poétique singulière. L’Instable et l’instant (1974) et Infimes débris (1980), sont les deux premiers jalons, au sein desquels le poète affirme la communion de la poésie et du lyrisme. D’emblée, l’inspiration ; Yves la puise au cœur même de la vie, de la poésie vécue, y compris charnellement, oniriquement : Je pense à ce corps ainsi qu’à une fête de l’âme – Sorti des remous de la mer comme un désir vivant. Suivra Donjon de soi-même (1985), premier recueil réellement abouti, dans lequel, à l’assaut de son propre donjon, si loin de lui-même, le poète rencontre la solitude et l’amour, comme le poète Jean Breton, qui est également son éditeur, l’écrit.
Il y a qu’Yves Gasc est lié à notre mouvance de la Poésie pour vivre depuis fort longtemps, étant l’ami de deux poètes importants du groupe des Hommes sans Épaules ; Henri Rode, tout d’abord, qui fut l’aîné de trois générations d’Hommes sans Épaules, et Patrice Cauda. C’est d’ailleurs par Henri, que j’ai rencontré Yves en 1993. Nous sommes devenus amis. J’admirais son immense talent de comédien, sa présence vraie sur scène et sa grande humilité aussi ; tout ce qu’il était également dans la vie comme dans son poème. Un ami fraternel, attentif et bienveillant. Nous nous écrivions, mais ce que je préférais, c’était bien sûr d’aller le voir jouer, Salle Richelieu, puis de le retrouver dans sa loge au Français, après le spectacle. La soirée finissait ensuite devant quelques bocks de bière dans des discussions à bâtons rompus. Parfois l’on pouvait croiser l’incomparable et extraordinaire et sympathique Jean-Pierre Marielle, la magnifique et fidèle Catherine Samie, le ténébreux et très secret Michael Lonsdale, Macha Méril la pétillante foudre de la vie, vodka en tête et bien d’autres comédiens. Yves Gasc, si discret sur lui-même et sur son travail[1], était considéré comme une sommité dans le milieu du théâtre, tant par les comédien(ne)s chevronné(e)s que par les débutants, les metteurs en scène, les auteurs, la critique, les régisseurs… Pour nous, Les Hommes sans Épaules, Yves était plus qu’un ami. Il était des nôtres, toujours présent et disponible pour participer à une lecture ou à un projet, qu’il soit ambitieux ou modeste par rapport à sa stature dont il ne jouait jamais. Des présences, mais aussi des absences liées à une tournée théâtrale, une répétition ou un moment de désespoir. Il vivait alors retranché en lui-même et retiré dans sa maison familiale dans le hameau de Château-Guillaume, rattaché à Lignac, dans l’Indre, à une cinquantaine de kilomètres de Châteauroux. Le hameau, ce qui n’était pas pour déplaire à Yves, tire son nom du constructeur de son imposant château, construit entre 1087 et 1112, Guillaume IX, le « duc Troubadour », chantre de l’amour courtois : Ferai chansonnette nouvelle - Avant qu'il vente, pleuve ou gèle - Madame m'éprouve, tente - De savoir combien je l'aime ; - Mais elle a beau chercher querelle, - Je ne renoncerai pas à son lien. Il y a aussi, que boulimique de travail et de projets, Yves Gasc était souvent en état de surmenage, voire d’épuisement (« La Comédie-Française est dévoreuse de temps et d’âme ! », in lettre du 1er mars 1996), comme en témoigne cet extrait, d’une lettre qu’il m’adressa en date du 28 août 2005 : « Je vous écris de la campagne où je prends quelques repos après deux années de travail intensif : j’ai joué 350 fois Les dix petits nègres d’Agatha Christie, neuf mois à Paris, six en tournée. Le spectacle, et le rôle, étaient si lourds, si épuisants à tenir que je me suis terré dans le silence, que la mort d’Henri n’a fait qu’appesantir. Je ne suis même pas allé au Maroc cette année, car je me sentais détaché de tout, incapable de porter, de communiquer avec personne. De plus – est-ce la fatigue, un léger état dépressif ? – Toute source poétique semble en moi tarie, comme si je n’avais plus rien à dire. Rien ne m’inspire, tout m’éloigne de tout. » Dans cette lettre, Yves fait allusion à la disparition de notre cher Henri Rode, le 19 avril 2004, à l’âge de quatre-vingts ans ; et aussi au Maroc, pays qui comptait beaucoup pour lui. Il s’y rendait tous les ans et avait acheté une maison à Asilah, ville située sur la côte atlantique du Maroc, à quarante kilomètres au sud de Tanger. Yves avait pu ainsi m’écrire, en date du 14 juillet 2000 : « Plus que deux représentations des Femmes savantes et je partirai pour Angers où nous allons recréer Cinna de Corneille, avant de m’envoler, avec les ailes les plus légères qui soient, pour mon cher Maroc. » Si Yves Gasc est « partout ailleurs » ; il n’est « jamais loin d’ici. »
Il y a que Yves, dans sa vie, comme dans son poème, ne s’habitue pas à cette machine debout, hésitante, parfois lâche, toute bourrée d’organes – O mes mots - Guérissez – Mes maux. Occasion de vanter les charmes de la mémoire secrète, presque toujours dans des décors de ville. Mais, poursuit Jean Breton, à propos de Donjon de soi-même[2], le poète évoque aussi la Nuit comme la seule patrie libre, celle du sommeil et des songes, et les nuits des « corps sans noms » où « caresser les fruits de fortune », ou l’être élu par le solitaire. Cela va jusqu’au rêve de fusion totale dans l’ultime étreinte. Ici, la quête d’amour se corse d’une aventure intérieure, d’une recherche de sa propre identité. Mais en même temps, le plaisir fait fête, agite et insulte le funèbre : désir d’être nu « devant la mort promise ». Jean Breton note qu’Yves Gasc reste « en arrière-fond une sorte de « classique » épuré. » Le poète, écrivain et critique Robert Sabatier écrit, quant à lui : « Si le poème est nouveau, la structure est d’un classicisme atténué, l’assonance apportant sa plus douce musique. Il s’agit d’interrogations, d’émotions à l’état brut et l’on devine l’homme dans chaque poème. C’est fortement ressenti et communiqué. » Plus tard, Robert Sabatier ajoutera : « À la rencontre de la solitude, de la nuit des songes, de son identité, interrogeant son devenir comme sa mémoire, Yves Gasc cherche dans sa propre prison des raisons de vivre malgré la peur du temps qui court et entraîne vers la mort. » À propos de cette notion de « classique », qui l’agaçait quel que peu, Yves put m’écrire, en date du 11 septembre 1966 : « Si à chaque nouveau recueil, je me sens comme un débutant, grâce à une lecture aussi fraternel que la vôtre, si intimement liées à mes fibres charnelles, quoique nous ne partagions pas sur ce plan les mêmes goûts, j’ai le courage de continuer à m’exprimer, à sortir de moi tout ce que le théâtre ne m’a pas permis et presque interdit de dire. J’apprécie particulièrement que vous me jugiez iconoclaste. C’est si vrai, alors même que l’étiquette de « classique » m’a été si souvent collée sur le visage (idem au théâtre). Bref, je vous remercie de tout cœur de m’avoir si bien compris et si bien lu. Lettres et articles ont été les rayons de soleil dont j’avais besoin en retrouvant Paris, le travail et l’angoisse du quotidien. » En fait, pour Yves Gasc, le « moderne » n’est pas lié à une mode langagière, mais à une qualité de secret qu’on laisse entrevoir. Cette vibration de cristal que rend un cœur authentique résonne ici : Et mes rêves figurent partout ma naissance – Et l’aube me dépose au rivage nouveau. L’écriture d’Yves Gasc est limpide, ses images soigneusement ciselées nous portent, en nous-mêmes, au cœur de l’être : Corps sans nom dans mes nuits de misère – Dans mes nuits de hasard vous brillez inconnus.
Après avoir donné, Donjon de soi-même, Yves Gasc éprouva le besoin de revenir à un genre qu’il affectionnait particulièrement, le haïku[3], en publiant, L’eaublier, 99 haïku. Eaublier est un mot inventé par le poète : aubier + eau + oubli, et comme un jeu parallèle au mot sablier : Goutte à goutte – Dans l’eaublier – Tombent les jours. Ici, nous dit Yves, chaque poème s’inscrit dans le déroulement des quatre saisons, à travers la nature, l’amour et la mort : Je t’aime debout – Arbre dépouillé – Reverdi de caresses. Ces haïku sont des impressions ou des aphorismes d’une écriture légère, mais non sans gravité (Quand on fait le tour – De la douleur on se retrouve – Au centre de soi-même), des pensées qui nous viennent dans la solitude, ou des visions saisies par la fenêtre de l’intime : L’œil et le cœur – Plus court chemin – D’un être à l’autre.
Le Jardin des désirs obscurs (1991) prolonge la réflexion créatrice de Gasc, mais en prose cette fois, avec une note prononcée d’humour et une surprenante ambiguïté, jamais gratuite. Nous retrouvons dans ces nouvelles les thèmes favoris de l’auteur : l’imprévisible, l’insolite, le désir, la vérité, l’enfance, l’amour, la mort, la solitude, l’individu sous toutes ses coutures. Avec ces nouvelles, comme l’écrit Henri Rode, c’est l’itinéraire de sa vie qu’Yves Gasc recompose, depuis les secrets de l’enfance jusqu’au jour inéluctable où nous devons franchir « la douane » du grand silence. Entre-temps, sa plume avisée, fine, parfois trempée d’humour frondeur, détectrice des mobiles humains les plus singuliers (« Le Village interdit », « Sister Dolorosa », « Le dernier jour de Pompeius »), nous conduit dans maintes situations – drame et cocasserie alternant – dont l’imprévisible tend au même but : nous révéler le désir profond sous les actes des personnages. L’humanité qui défile dans les récits d’Yves Gasc est le fruit de ses observations, de ses rencontres, de son insatiable curiosité. Le résultat ? Un recueil plein de la science des êtres, tout aussi intériorisé qu’ouvert sur les imprévus de la vie, ses pièges. En le lisant, poursuit Henri Rode, comme on se sent loin de ces livres d’acteurs, qui ne sont souvent qu’une fabrication plus ou moins bien faite. Le Jardin des désirs obscurs révèle en Gasc un auteur authentique, dont l’expérience de la scène a enrichi l’art personnel.
Fenêtre aveugle, suivi d’Esquisse d'un soleil (1996) qui marque le retour au poème, après la parution des nouvelles du Jardin des désirs obscurs, me paraît être le deuxième recueil important d’Yves Gasc. On ne peut en douter : le comédien réputé qu’est Yves Gasc se révèle aussi comme un poète de la vérité humaine dans toutes ses nuances : Ferai-je un rempart de ma solitude – En ferai-je un tombeau – J’ai peur de ma propre présence – comme d’un ennemi inconnu. Si la tentation est grande de qualifier son écriture de « classique », ne serait-ce que par son itinéraire et/ou sa forme, il suffit de le lire attentivement, de s’imbiber de son univers, pour s’apercevoir que cette étiquette tombe d’elle-même et peut-être changée en celle d’un poète iconoclaste, un poète de la liberté de vivre et d’aimer (Je ne suis le prêtre d’aucune religion – sinon celle qui me voue au voyage), comme il vous plait, dans les dédales du désir; un inlassable interrogateur du quotidien, mais vu de l’intérieur, fracturant la blessure fermée du nom de solitude. En cela, Yves Gasc est résolument moderne et sa poésie permet de sortir de soi, de s’exprimer en bravant les interdits : Qui parle encore de sagesse ? – Je n’ai plus peur d’être vivant, - J’offre mon ombre à la nuit claire. Elle est intimement liée aux fibres charnelles du poète, qui est également un poète de l’amour (Si je t’aime – pourrai-je supporter ma mort ?), tour à tour sentiment, sensuel et charnel, ou le tout dans le même laps de temps : Écartèle mon désir – Puis affute ton couteau – Tranche ma langue – Fais saigner nos cris – Tranche ma vie. Le feu monte et embrase tout, avant que ne vienne le moment de la haute solitude, de l’attente ou même de l’abandon : mon beau désespoir – Et le silence qui suit l’absence – le – silence ; autres thèmes et hantises omniprésents, obsédants, chez Yves Gasc : L’odeur de tes cheveux sur l’oreiller meurtri – Le poids de ton sommeil dans les draps qui respirent… - La porte qui se referme est une douleur – Ton sourire qui s’éteint est une douleur – Mais toi parti ma solitude est grande – Tu es le géant qui l’habite. Il en va ainsi de cette Fenêtre aveugle, et tout autant d’un recueil tel que Khalil[4] (Traduis-moi la musique de ton corps, fais-la chanter…), publié, non pas sous le manteau, mais sous le pseudonyme de Yûsef Ghazâl[5], car faisant allusion à ce qu’Yves Gasc appelait les « amours interdits » : parmi le monde assagi des vivants – dans le cercle assiégé des maudits. Voilà en quel terme, Henri Rode présente Yûsef Ghâzal et son Kahlîl : « D’Hâfez, les vers Yûsef Ghâzal ont la grâce et la résonnance à la fois brûlante et aérienne. Mais trop facile serait de le situer parmi les grands de la poésie musulmane. En appuyant sur la touche d’un amour idéalisé, conçu pour un jeune homme, Ghâzal n’oublie pas qu’il reste un contemporain. Sa passion le dépasse et en même temps le voue à une lucidité brûlée, toujours éminemment poétique. Ce recueil est un bréviaire e la révélation amoureuse, jusque dans le détail, un refuge où la grâce de l’amour vient illuminer l’auteur, mais aussi un avertisseur : autour de la passion installée, fluide magique inondant le poète, il y a le monde qu’on interroge, le sentiment du temps qui passe, de l’éphémère de ce qui nous est donné en regard de l’éternité. Ghâzal boit au filtre, tel un nouveau Tristan, mais il sait que les heures nous sont comptées, que les trahisons de la vie font armée contre tout ce qui nous surélève. N’importe. Cette vingtaine de poèmes, tous du ton le plus juste et surtout inspirés, nous prêtent à rêver. Nous devenions la passion de l’auteur, lui, et l’être qu’il désire. Et là, saluons la qualité de l’art de Yûsef Ghâzal : il nous fait croire que notre terre pleine de vindicte et de fureur est aussi celle de l’extase sublime. Aime et tu renaîtras. »
L’écrivain Claude Mauriac salue les poèmes d’amour d’Yves Gasc, « graves et beaux. » Le poète belge André Miguel évoque « un poète remarquable par son sens de la rigueur, du secret, par son étrange mémoire citadine et par sa fascination de la nuit. Partout chez Gasc vibre la force de l’amour, qui déborde, dépasse le doute et l’absurde du vivre pour rejoindre l’aurore du monde. » Il y a que l’amour règne dans le poème Gasc, de L’Instable et l’instant, 1974 (T’aimer pour ta liberté – Et t’aimer pour mon malheur) en passant par Khalil (1995), et ce, jusqu’à l’ultime Soleil de minuit (2010), livre qui donne la parole au vertige amoureux et « ses vagues unanimes » pour « ranimer la lumière » : Que les ténèbres envahissent mon regard – Que le sommeil pèse de tout son poids – sur mes paupières et m’ensevelisse – à jamais pour ne plus vivre à genoux sans amour. De Soleil de minuit, Yves Gasc nous dit : « Les poèmes m’ont été donnés naturellement, commençés durant l’été douloureux d’une séparation (qui, prolongée, devenait difficile à supporter), due au hasard, à ce qu’un homme nomme le destin, les contingences de la vie, en fait. Ces poèmes parlent d’un amour qu’on appelle « marginal », alors qu’il est involontaire, non un choix délibéré, le « seul cri de la vie » qu’il m’ait été donné de pousser. Heureusement, j’ai d’illustres devanciers : Les Sonnets de Shakespeare à un inconnu, ceux de Michel Ange à Tommaso Cavalieri. Je n’aurais pas l’audace de me comparer à eux, mais ils ont été de précieux guides, ne serai-ce que par leur explicite aveu. »
Poète de l’amour, Yves Gasc n’est en fait que cela. Le thème est omniprésent et résonne dans tous ses livres, sous la forme d’une rare sensualité, qui peut aussi bien devenir Éros torride, lumière brulante de vie et de douleur : je ne sens que le froid du couteau qui me blesse. Car, aimer, en dépit du message des « faux prophètes de la mort », est la seule merveille contre l’heure exténuée, la seule loi fondée sur le butin des étreintes, et une puissance apte à conjurer même la honte maternelle. Gasc ne triche pas, ne nous ménage pas, ne s’épargne ni ne cache rien. Son écriture y gagne en vérité comme en force, alors que la chair se multiplie – sous les doigts du rêveur – songeant au corps aimé. Définition de l’amour, inventaire de l’être sans masque, dans Fenêtre aveugle et ses autres livres, Gasc sait à la fois nous parler et nous impliquer de façon intime : Expulser l’âme de l’autre équivaut à se vomir soi-même ; tendre les bras vers ce corps puis l’attirer contre soi, oblige à nous mêler à lui, nous fondre douloureusement dans la beauté.
Avec Travaux d’approche (1999), qu’Yves me demanda de préfacer, le poète ne découvre pas la nature, bien présente dans son œuvre, souveraine, mais approfondit sa relation aux éléments, aux sens, à tous les sens. Le poète épouse le cosmos, guidé par l’évidence qu’il existe également en lui ; qu’il est tout son être profond. Si Rien n’arrêtera le ruisseau, c’est que L’eau coulant dans nos veines, nous entrons ainsi dans sa peau, alors que La mort est au pied du lit, là, parmi la feuillée. L’air que l’on respire est déjà celui qui se dissipe à l’horizon en fuite. Le feu est une rose d’incendie, le grand purificateur qui consume l’humain comme un brasier. Quant à la Terre, n’est-elle pas ce Bois de solitude bâti sur notre naufrage, déjà programmé et inéluctable ? Pas de méprise cependant. Si l’angoisse est là, et bien là, le recueil est plutôt serein. Yves Gasc constate la fatalité, mais en se lasse pas pour autant d’être au monde, de s’interroger, de s’émerveiller et de nous donner à voir, à ressentir ses inquiétudes comme ses émotions, dans un langage fluide, épuré comme un trait d’aile déchire la soie. Cela même si la fièvre du jour s’apaise et si le poète s’en remet au soupir solitaire de l’étoile. Le poète prend à bras-le-corps la solitude, s’exile loin du monde, pendant plusieurs mois, parmi les quatre éléments, dans une Nature presque vierge. Il se défini au centre de son projet : « Une apparence de vide qui cherche pas à pas son enveloppe. » Son écoute des choses (dont l’amour est toujours au cœur) aussi discrète que modeste et volontaire, débarrassée des carcans et des bluffs de la ville erre en liberté parmi la franchise des plantes, des saisons, interroge, nomme, retient les points d’adhésion, « l’entraide » réciproque, les connivences entre l’homme et le cosmos, entre l’enthousiasme et la méditation. Tout ce qu’il voit et réceptionne est témoignage de sa « présence ». Et que d’images neuves et fortes sur l’eau, la terre, le feu ! La poésie d’Yves Gasc sonne juste par ce que la poésie en ressort est aussi vraie que celui qui s’exprime en elle.
C’est cette voie que poursuit Yves Gasc, en publiant La lumière est dans le noir (2002), ce septième livre de poèmes qui se présente tel un triptyque, sorte de journal intime du poète, éternel voyage initiatique entre l’Occident vécu et l’Orient (le Maroc, si cher à Yves Gasc) comme rêvé, quoique concrètement habité. Dans la première partie, les « Poèmes de la terrasse » sont à la fois complainte de la solitude, quête de soi dans ce vide et attente de l’être privilégié. La terrasse de Paris où cette attente a lieu devient presque un personnage, un témoin sensible. Souvenirs de l’enfance, d’un vécu multiple, révolte contre le désir dominateur. Cette réflexion lyrique s’attarde aussi sur l’acte d’écriture. Nous sommes un « réseau d’offrandes ». Calmons notre inquiétude avant le retour de « ce visage et nul autre », dans le regard duquel « on prend le large ». Les « poèmes du patio », en deuxième partie, chantent la présence de l’aimé, le défi de l’amour unique, le silence positif. Voici de fortes images sur la solitude, malgré le souvenir, par moments encore, de « la fête barbare ». Décision mûrement réfléchie : « Ne pas recevoir, seulement donner ! Tel est l’amour. » Sur toute chose perdure cependant « l’ombre de la mort ». En troisième partie, Khalîl, reprend le recueil qui avait paru initialement sous un pseudonyme. Les poèmes de Khalîl, dont nous avons déjà parlé, sont écrits à partir du premier vers de poèmes choisis d’Abû-Nûwas, puis de Hafez Shirâzi. Sur le mode oriental revisité, le poète salue l’aimé mystérieux qui se confond avec l’image du Seigneur. Le chant d’éloges, tantôt charnel, tantôt épuré s’élève, évocation, supplique, partage d’infini. « Il n’y a qu’en toi que repose la paix ». Est-ce un crime que de trop aimer ? Ne faut-il pas craindre aussi « la nuit de l’âge » ? Le poète s’imagine mort, sa main apaisée dans celle de l’amour, car les rêves eux-mêmes, les plus forts, « pourrissent » un jour : Alors le brancard de la mort pourra passer – et m’emporter – Je sais que tu me tiendras la main – Tout sera dit tout sera bien.
On habite l’absurde par défaut, on déambule dans la stupéfaction d’être « ni né ni mort » dans une misère parfois somptueuse, a écrit Alain Breton, mais toujours terrible, où la solitude est virtuose, « où la voix même du temps s’étiole » Et puis on rencontre l’amour et tout passe à l’ivresse, le monde se transforme dans les ovations du cœur. C’est aussi de cela dont nous parle l’œuvre poétique d’Yves Gasc, qui fut sa vie, avec le théâtre ; une œuvre au sein de laquelle, le poète jette l’ancre de l’Éros et de la vie entre la blessure fermée de la solitude et le cri que lui arrache le réel. Yves Gasc ; la poésie est intimement liée à ses fibres charnelles. Les poèmes d’Yves Gasc s’échelonnent au fil de sa vie : ils sont toute une vie.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
Œuvres d’Yves Gasc : L’Instable et l’instant (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1974), Infimes débris (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1980), Comme dans un miroir, conseils au jeune comédien, essai, (Magnard, 1983), Donjon de soi-même (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1985), L’Eaublier (Le Méridien, 1990), Le Jardin des désirs obscurs, nouvelles, (Hérodotos-Le Milieu du Jour, 1991), Khalîl, sous le nom de Yûsef Ghâzal (Le Milieu du Jour, 1995), Fenêtre aveugle, suivi d’Esquisse d'un soleil (Collection Les Hommes sans Épaules, Le Milieu du Jour, 1996), Travaux d’approche, préface de Christophe Dauphin, (éd. Librairie-Galerie Racine, 1999), La Lumière est dans le noir (éd. Librairie-Galerie Racine, 2002), Un Château de nuages, Choix de poèmes, (éd. Librairie-Galerie Racine, 2009), Soleil de minuit, cinquante poèmes secrets (éd. Librairie-Galerie Racine, 2010).
YVES GASC SOURCIER DE LUI-MÊME
par
Henri RODE
1/ SONGE ET MENSONGE AVEC YVES GASC
Lors de sa mort en 1997, Robert Pinget[6] laissait comme un point d’interrogation, ou une part de mystère, tant sa carrière, en marge de toute l’actualité facile, se présentait discrète, à l’image de sa renommée d’auteur dramatique. En revanche, aucun doute ne se levait, quant au fait qu’il reconnût Yves Gasc, acteur aux cent-trente-cinq rôles, le M. Songe[7] idéal, soit l’un des principaux personnages, et le plus singulier à coup sûr de son œuvre. Dans une certaine mesure, l’adéquation parfaite, si rare, qu’on note entre la création d’un personnage et celui qui lui prête ses traits semble tenir de la magie. En portant à la scène Identité de Pinget, puis en montant et jouant, du même, Paralchimie, Yves Gasc avait choisi de camper Mortin, l’égocentrique et vétilleux ami de M. Songe. Pinget ignorait alors qu’aux cours de conversations révélatrices avec Gasc, dans sa maison de Touraine propice aux coups de sonde intimes, cette intuition fulgurante lui viendrait : le comédien qu’il appréciait certes et dont la carrière exemplaire était louée par lui se révélait, à sa surprise en imitant ses gestes, ses mimiques, son élocution supposée, une sorte de clone de son personnage-fétiche – ce Songe insaisissable dont il doutait qu’on puisse un jour lui prêter apparence et vie sur les planches. Or, Pinget sentait, voyait Gasc tout prêt à tenter la gageure, à matérialiser ce fantoche de papier né d’on ne sait quelle région ambiguë de son créateur. Gasc se mouvait, se matérialisait, rentrait dans la catégorie des automates de chair et d’os, tel que l’avait conçu Robert Pinget dans un de ces moments où la création d’un écrivain, devenu apprenti-sorcier, le dépasse par la portée de sa dérision, de son ridicule.
À coup sûr, Yves Gasc était rompu à toutes les métamorphoses grâce à la diversité des masques qu’il s’était prêté en allant du classique à l’avant-garde théâtrales. De plus, il poursuivait, parallèlement à son parcours d’acteur ; une carrière de scénographe, qu’il accompagnait de la publication de poèmes, d’adaptations diverses, de lectures en public d’auteurs souvent rares. Cette fois, l’admiration qu’il portait à Pinget l’aidait à mettre sur pied, pour le faire vivre en public, un Songe tiré de trois livres de l’auteur : Monsieur Songe (roman ; éd. de Minuit, 1982), Charrue (carnets ; éd. de Minuit, 1985), et Taches d’encre (carnets ; éd. de Minuit, 1997). Les passages choisis parmi les plus significatifs deviendraient sur les planches, Les Carnets de Monsieur Songe, une lecture-spectacle qui ne laisserait pas de surprendre les spectateurs, curieux du défi complexe qu’elle suggérait.
Avec Pinget, pas une minute de doute : nous sommes en plein dans le théâtre de l’absurde, malgré l’apparence logique, à l’abord, de la narration. Mais il s’agit là d’une absurdie qui, par sa prédilection pour on ne sait quel vide, peut devenir terrifiante. Cet absurde castrateur, Gasc est chargé de le véhiculer et si possible, sous nos yeux, de le concrétiser. En créant Songe, Pinget a-t-il voulu se donner un suppôt rejoignant les interrogations secrètes, enfouies jusque-là, de sa propre existence ? Nous l’ignorons. De vrai, il ne cherche pas à nous suggérer que Songe est son double, épinglé comme hors de lui, à qui il prêterait ses tics et contrôlerait avec sa plume. Non. Pinget évite de tomber sous la dépendance de son antihéros, alors que Samuel Beckett est sous la sienne quand il crée Godot, que Ionesco, Arrabal, Gombrowicz ou Jean Tardieu se projettent dans leur caricature, comme le fait Renard avec Aupic et Vernet et que Marcel Jouhandeau, en inventant M. Godeau, son satanique suppôt, entend se décharger à la fois d’un sur-moi et d’un sans-moi par une tentation rejoignant le maléfice. Rien de tel chez Pinget. Son dessein, si bien saisi par Yves Gasc, est la volonté entière de laisser Songe à une sorte d’identité caricaturale, à ses velléités, ses limbes, ses radotages qu’il croit fondés, à une sagesse fabriquée, ainsi, qui ne vaut pas pipette. Pinget tient sans cesse en respect, en demeure d’empiéter sur sa propre individualité, ce bonhomme qu’il préfère vouer à l’irrespirable, plutôt que se risquer à le rapprocher de lui. Il le choisit mensonge, selon une assonance avec son nom, plutôt que révélateur (une seule seconde) de son géniteur. Tu es Songe, mensonge, et le resteras. L’ambiguïté autoritaire de Pinget trouve, chez Gasc, un traducteur si fidèle que devant nous le personnage devient presque tangible, sans perdre son inanité. Oh ! Songe se connaît bien pourtant, avec ses actes manqués, et se juge. N’avoue-t-il pas qu’il ne pense à rien, sûr que tout coup de théâtre en ce monde n’est que dans les mots, jamais dans notre vie ? Ne se sent-il pas le jouet absolu de son incapacité à tout ? C’est ce que lui souffle l’ami-témoin Motin, avec son autorité suffisante, en surprenant Songe (qui se veut écrivain, autre échec total) devant son manuscrit vide : « Énumère donc ce qu’il n’y a pas dans ton crâne. » Oui, Songe a voulu écrire, se dire peut-être, mais dire quoi ? Sa bonne reconnaît chez lui le goût des mots, en lui reprochant son « désamour des gens ». Mais écrire s’avère aussi un porte-à-faux dans son trajet terrestre. Bah ! de cette impuissance, de cette « outrecuidance » renoncée, la sagesse biscornue de Songe prend le dessus. Après tout, « on ne peut rien contre soi », a-t-il conclu, pas même fataliste, face à son manque d’inspiration.
Qui est Songe, pris dans l’immensité bigarrée de la comédie-humaine ? À l’approche, un pré-septuagénaire en retraite (probablement de l’Administration ; ça se flaire) tiré à quatre épingles, mise à part une touche « artiste » dans la coupe du veston. Il vit, non sans un certain confort, dans une villa de la Côté dont on devine le jardin fleuriste, comme les semis, tirés au cordeau. Songe fait mine de jardiner assidument, craignant la froidure pour ses végétaux, en coupant ses occupations d’une horométrie rigoureuse par des contestations ne manquant pas de cocasserie avec sa bonne. C’est un homme (mérite-t-il ce nom ?) qui ne tient que par le conventionnel, suivi à la lettre et une routine élue. Pinget n’a-t-il pas eu peur, un jour, en démontant pour nous ce vieux rentier vidé de moelle. Consentant soudain à se pencher sur le destin de Songe, son géniteur nous apparaît atterré, impossible même de prêter quelque drame, survenu en circonstance atténuante, à la vie de Songe, dont même le passé semble exempt de passion amoureuse, de douleur humaine, du moindre élan salvateur. Aucune responsabilité non plus, chez lui, vis-à-vis d’autrui. Pour le justifier aux yeux de la création, sans doute faudrait-il trouver la pièce qui manque à la machine. Lorsqu’il s’imagine mort, c’est au vide, pense-t-on, que s’adresse le retraité : « Tu me laisses finir comme ça ? » Cette interrogation au rien, c’est miracle qu’elle nous touche, en nous poussant à bord du vide, grâce au verbe sans reproche de Pinget transmis avec acuité par Yves Gasc, cet expert en ironie rentrée.
Le public, à l’audition de ces Carnets de Monsieur Songe rit beaucoup lorsqu’il entend l’acteur imiter les burlesques commentaires s’élevant autour du faux décès de M. Songe. À Paris comme à Genève, les spectateurs se sont raccrochés à ce que la lecture-spectacle de Gasc contient d’humour, de jeux de scène riches de drôlerie, même si, là encore, la férocité clairvoyante du comédien n’épargne pas la marionnette qui est Songe. Son jeu a su s’établir sur deux portées : il montre entière la vacuité vertigineuse de Songe et nous permet de le juger humainement. On peut considérer que Robert Pinget, lui, commence et se continue à la fois lorsque son personnage salue les spectateurs. Il cesse de nous inquiéter en finissant de démonter son « monstre », nous laissant un message sans chiffre, une porte sans serrure, en suspens sur le chemin desséché de quelle découverte impossible ?, dont Gasc tente de raccorder, d’orchestrer, de remonter le fil. Pourtant la découverte doit bien se trouver là, au cœur du texte et du spectacle – à deux doigts de nous subjuguer par le truchement d’un interprète plus personnel et original qu’il n’a voulu qu’on le dise durant un demi-siècle de carrière. Yves Gasc colle au mensonge qu’est Songe, en complice d’un Pinget qu’il admire, avec la vérité de sa présence, de son sens des nuances sournoises et de sa voix, de son autorité enfin. Par-là, il nous rappelle comment il a su renouveler le Trissotin de Molière, durant près de deux cents représentations à la Comédie-Française, en faisant de ce bas-bleu l’incarnation même de la méchanceté, du parasitisme truquer et du mal tout court. En se déplaçant dans l’énigme Pinget, Gasc nous donne au moins une clé : celle du grand comédien qu’il est resté, par défi et besoin de vérité critique, à l’abri de tous les tapages de notre temps.
2/ YVES GASC, UN SOURCIER EN MIRAGES INTIMES
Dans sa poésie Yves Gasc, perpétuel sourcier de lui-même, sait, à merveille, opérer une osmose, on pourrait dire une synthèse, entre l’événement intime et la félicité qu’il peut tirer de la nature ambiante, reliée à lui par des fluides mystérieux. Si l’on peut le définir comme un romantique à part entière, mais lucide, définition qu’il assume souvent en véritable tunique de Nessus, il met en défi le monde de ne pas correspondre avec lui, dût-il prendre à parti la puissance qui l’accable avant de l’exalter à nouveau, en propriétaire d’on ne sait quelle foi secrète : De ma foi je fais mon enfer. Gasc, qui a pu se rêver hors souillure, ne cesse d’interroger, de humer son angoisse, de goûter sa liesse et d’approfondir jusqu’au vertige malheur et délices d’être là, bien vivant, apte à toujours supporter richesses et mauvais coups du destin : ce sont pour lui, avec son « amour du bien et du mal », des aguets et comme une disponibilité de chaque instant, à se pencher sur les strates et décombres encore vivaces de son moi. A le lire, on retient surtout une sourde, une innée exaltation, suivie d’un bien-être qui le confond lui-même, alors qu’il tient, par exemple, un œuf frais pondu dans sa paume : Quelqu’un nous tient-il ainsi dans sa main, avec cette douceur, au creux de l’univers ? D’indifférence chez Gasc ? Point. À ce constant régime d’étude de soi, ne risque-t-il pas de faire sourde oreille aux grandes mutations, aux cataclysmes de notre planète, au malheur d’autrui enfin ? Les endosser, croit-il, n’est pas son rôle, si, malgré tout, il les passe au crible de sa sensibilité, en échos intérieurs s’ajoutant au malaise d’exister.
De recueil en recueil, Yves Gasc poursuit une destruction/reconstruction de soi jusque dans l’infime débris. Ce qui semble plus qu’évident lorsqu’on lit son dernier recueil en date, La lumière est dans le noir. Brûlé à vif aux fontaines du désir, et au feu de ce qu’il appelle « les passions contraires », que lui reste-t-il tout à coup, pantelant de désillusions et lassé même, sans doute, de toute douleur fructueuse, alors qu’il se sent presque comme un mort dans sa barque noire ? Quand il part pour le Sud lointain, Paris n’étant plus à ses yeux qu’un enfer parodique, Gasc souffre au point de ne plus réfuter la part de néant promise à tous les hommes, mais en humaniste. Ce grand lecteur de Hâfiz, de Al-Qâdr, cet amoureux des poètes d’Extrême-Orient et des deux Afriques n’accepte pas en son tréfonds, s’il sent leur morsure, que les chiennes sauvages lui lacèrent le cerveau. Royaume suprême à sauvegarder. Il attend sourdement mais intensément, sur la terrasse de sa maison marocaine d’Asilah, où il ne dénombre pourtant qu’absences d’appel, d’embrassement du devenir, en dépit de ce lieu recueilli où stagne la creuse attente du rien qui l’y cloue. Soudain, frémissement jusque dans l’inespoir le poète sait, en persuasion fulgurante, qu’il ne restera pas cette île que le temps oublie. Mais quoi ? Ce voyageur rendu, moulu, humilié par toutes les défaites du vivre, ce solitaire à bout de toutes les imprudences, les impudences peut-être, peut-il croire encore à l’intervention, à l’approche d’une présence bénéfique ?
Oui, puisqu’une voix magicienne, souterraine et comme jaillie de l’impossible qui devient possible, chante à son oreille que le beau mensonge de vivre toujours se confond avec la réalité qui nous garrotte. L’autre est là, palpable, même si cet autre lui fait souffler : Je reste assis au bord du secret – de toi-même. Ne nous a-t-il pas dit qu’il n’y a pas de vraie mort si un jour la main aimée vient tenir la nôtre ? Alors Tout sera dit tout sera bien, termine le poète. Comment ne pas songer au « tout est bien » final gidien ? La partie « Khâlil » du recueil La lumière est dans le noir, conte ce renouveau ensemble emporté et lucide.
Il est évident qu’Yves Gasc, faisant ainsi la nique aux poètes du rien, croit à la permanence, à la vérité, à l’éternité de l’art. Ce qu’il n’a cessé de démontrer au cours de sa longue carrière théâtrale, commencée chez Jean Vilar, poursuivie chez Barrault et parachevée au Français où il joua 180 fois le Trissotin des Femmes Savantes, après avoir abordé Genet, Albee, David Mamet, Ionesco, Pinget, Beckett, Gombrowicz, etc., tout en mettant plusieurs auteurs connus en scène. Que de fois, arrivé dans quelque capitale étrangère, en faussant compagnie à ses compagnons de tournée, à New York, au Japon ou à Moscou, ce lecteur insatiable s’est dirigé, souvent d’instinct, vers quelque librairie inconnue, où il savait dénicher l’oiseau rare. Il retournait, enthousiasmé par ses trouvailles, son sac craquant de livres et de brochures, pour ajouter dans la « campagne » qu’il possède dans le Berry un Mishima ignoré, ou un Essenine, un conte de Bohême oublié de Rilke, ou un Séféris, un Cernuda. Dès ses plus jeunes années, Yves Gasc a fait son havre, son panthéon avec – en dehors des poètes français qu’il connaît à fond, surréalistes compris – Borges le grand favori, Lorca, Ungaretti, Cavafy, et tant d’autres. Cet amour du verbe poétique, il l’a prouvé par de nombreux récitals, dans le cadre des revues Poésie 1 et Les Hommes sans Épaules, à la Maison de la Poésie, à la Sorbonne, en dehors des matinées très courues de la Comédie française, ou encore sur France Culture. Il faut avoir entendu l’acteur-poète parler de ses prédilections et découvertes avec les Breton père et fils, ou Christophe Dauphin, vigilants témoins de la poésie de notre temps. Yves Gasc aurait pu être un de ces « amateurs » profonds, un de ces « honnêtes hommes », naturellement férus d’art, que vit fleurir la Renaissance.
Ses connaissances en roman n’étant pas moindres que sa culture en vers, on l’imagine, tandis qu’il parcourt l’univers avec les comédiens du T.N.P ou la troupe de Jean-Louis Barrault (plus tard ce seront les Sociétaires du Français) penché sur quelque bouquin révélateur dans un recoin de ces nouveaux chariots de Thespis que sont nos Boeing et T.G.V. Comment ne pas rêver ce jeu de scène ? Madeleine Renaud (ou Roger Mollien) s’inquiète à la ronde : « Mais où est donc passé le cher Yves ? » Barrault met un doigt sur ses lèvres, puis déclare : « Chut ! Vous le savez très bien. Yves Gasc se livre au vice impuni : IL LIT. »
Henri RODE
(Revue Les Hommes sans Epaules).
Inédits, juillet 2001.
POÈMES DE YVES GASC
PRÉFACE
Pour en finir une fois pour toutes avec soi-même, (mais n’est-ce pas impossible ?) rien de tel que de se mettre en prison. Toutes les peurs, toutes les sueurs nous assaillent. Des corps se dressent, détenus d’un moment, et meurent d’abandon ; des rêves asphyxiés reprennent souffle ; la passion nous encercle mieux que les murs. Tout le reste s’inscrit en graffiti plus ou moins conscients, tracés d’une main ENNEMIE.
À force de tourner autour de soi, on finit par se perdre. Restent les regards au dehors, qui se veulent fraternels, vers les autres, la vie qui décline si vite, comme le jour à son second versant.
La poésie est qu’un moyen de se perfectionner soi-même, en projetant vers l’avenir tout ce que le passé ne nous a pas permis d’appréhender.
Si la mort demeure inacceptable, c’est que tout désespoir n’est pas perdu et qu’en tout cas l’écriture, comme le rêve, est une seconde vie.
L’ÉTOILE
Chaque jour meurt en moi l’étoile
Qui reprend vie avec la nuit
Je traverse les jours les mois
Avec cette clarté blessée
Et personne ne la voit.
Elle porte les espérances
De la lumière incorruptible
Brûlante étoile au frais de l’ombre
O lourde lampe de mes rêves
Dans la demeure de la mort.
BEAU MARBRE
Statue coulée dans le désir sans forme
Que mes mains ont rendue vivante
J’ai parcouru tes horizons polis
Tes frontières de marbre veiné de sang noir
J’ai réveillé tes lèvres d’une faim dormante
Tes yeux ont battu devant les merveilles
Ma bouche a couru sut tes ruisseaux d’ombre
J’ai bu ta vie à la source délivrée
J’ai fait couler en toi la rivière profonde
Et me suis couché sur tes eaux
Nos mains se sont rejointes affluents de la nuit
Nous avons roulé loin vers la mer
Et tu t’es brisé dans mes bras
Mon marbre en morceaux de beauté.
*
Ton corps a trop de plages nues
Pour y laisser du sable sec
Le reflux des vagues lamente
Sur le rivage illuminé
Le soleil que j’y déposai
Le sel sur ma mangue assoiffée
Brûle mon désir de te boire
Tu allonges toutes tes dunes
Sous les caresses qui te brisent
Toute la nuit je chercherai
Dans ta toison d’ombre fleurie
La perle où jaillira l’aurore.
*
Je pense à ce corps ainsi qu’à une fête de l’âme
Sorti des remous de la mer comme un désir vivant
Sorti des vagues de l’amour comme une meurtrissure
Bain d’écume offrant au soleil son insolence
Offrant aux regards le pouvoir de la torture
Je pense à ce corps ainsi qu’à un emblème
Ruisselant des onguents de la lumière
Couvert des crachats de la lune
Superbe de se voir érigé en statue de silence
Enlacé par le lien des soupirs
Cloué au poteau du vertige
Les veines vidées du plomb subtil.
Quand le temps sera revenu
Je poserai les mains sur toi
Tu vivras ailleurs qu’aux rivages
Oubliés des minces mémoires
Et tu me donneras la force de ton sang.
LA MORT PROMISE
Quand je n’aurai plus rien à donner
Quand je serai pauvre de mes refus
de mes erreurs de l’oubli de la vie
Quand toutes mes peaux seront tombées
lambeaux de mes incertitudes
Je serai nu devant la mort promise
enfant de mes découvertes
héritier de mes silences
fils d’une autre éternité
Quand tout sera dit à jamais
Gardez-moi un coin de terre
Pour y déposer mon secret
Lourd comme le poids du monde.
Mon nom sera perdu mon nom
Telle une pièce de monnaie
Qui a traversé tous les siècles
Et qui ne vaut plus rien
Comme un caillou qui a roulé
Du haut des collines fières
Et rebondit au désert
Dans les champs du labour futur
La graine ne poussera plus
Plus de fleur à sentir de visage à aimer
De nom à prononcer Mon nom
Plus d’écho de nos voix dans les vallons du rire
Plus de nos ricochets sur l’eau morte du temps
Mes Pères j’ai trahi votre belle espérance
Je me retrouve seul ancre rouillée au port
Je serai le dernier d’une chaîne qui lie
Vos espoirs mon destin votre vie et ma mort.
*
Depuis longtemps plus rien n’existe
Je vis une vie enfouie
Enterrées sous le sable d’hiver
Sous les pelletées quotidiennes de l’amour
Du mensonge monotone
Où sont donc les éclats du rire en rut
Les berceuses de l’attente
Les plaisirs de l’improbable
Maintenant plus rien n’existe
À peine un instant de repos
Et il faut repartir
Vers quel mur en faillite
Ou quelle porte sur le vide.
Ouvrir les mains
Pour que renaissent les sources.
*
Quand tu rentres le soir seul
Après une journée lourde de paroles
D’actes plus ou moins avortés
Avec ta solitude en bandoulière
Les yeux vides de ne rien voir de plus près
que ton chemin solitaire
Pousse la porte et regarde la chambre déserte
(Aucune lampe ne brûle pour consumer ta soif
Pour te dire que la lumière existe
Pas de musique pour t’entendre
Ni de poème où lire ta vie
Pas de rose où la femme geint
De glaïeul où s’érige l’homme)
Tu es seul et tu parles quand même
À quelqu’un qui n’existe pas
qui ne répondra jamais
qui se tait sur ta lâcheté ta paresse
ton besoin d’être seul et d’attendre malgré tout
une réponse à des questions que tu n’as pas posées
Est-ce Dieu dis-moi est-ce Dieu qui parle
et pourtant n’existe pas
Est-ce une prière à la plus haute Solitude
qui soit
Tu as puni tes frères de ne pas te ressembler
de ne pas être toi-même une fois encore
Et mille fois encore d’être tes frères
Rien n’a été créé pour toi
Rien ne te renvoie plus au pouvoir
De dire : Solitude à quelqu’un qui aime
Et est aimé
Rien ne te lie à la chaîne des solitaires
Tout est brisé entre tous
Tout est séparation infinie éternelle
Tout est absence infinie éternelle
Ce qui grandit en ton corps diminué
C’est une mort fatale et solitaire.
VOIX FRATERNELLE
Je voudrais être une voix fraternelle
Que tout chante par cette voix
Mais les mots dévorent ma bouche
Le sang de la colère rougit sans moi
Les larmes gèlent sans moi
sur la joue de marbre des mères
Il se fait quelque chose quelque part
où je ne suis pas
Les arbres grandissent sans moi
gardien vigilant de la ville
La pluie fait ses confidences
mais je ne les entends pas
Tout coule flux perpétuel
et retourne à la source première
Et je reste sur la rive
à regarder dans l’eau qui dort
l’image de ma défaite
La terreur brûle sans moi
La mort a peut-être ma voix
mais logée dans une caverne
où personne n’entrera.
Poèmes extraits de Donjon de soi-même (1985). © Librairie-Galerie Racine.
APPORTE-MOI UNE PLUME ET DE L’ENCRE
Apporte-moi une plume et de l’encre
que j’écrive l’histoire de notre rencontre.
Elle sera brève, Ô Khalîl,
(je suis à genoux aux pieds de l’orage)
brève comme l’éclair et la foudre,
mais lente à couler comme l’huile labile
de la lampe, goutte à goutte,
car la lampe dans les ténèbres jamais
ne s’éteindra.
Elle éclaire un pan de muraille, une ruelle,
la nuit s’entrouvre et te laisse passer.
Quand le jour te ramène sur ses crètes
le flot de l’équinoxe te porte à moi.
Ô nuits égales aux jours,
Silence pareil au mouvement des mots,
Regard qui brûle le soleil lui-même,
Sourire qui se fait soleil…
Enlevez-moi cette plume et cette encre,
Je ne veux plus rien dire,
Car maintenant je suis seul à ma table
Les mains nues
TU AS JOUÉ AVEC MA VIE
Tu as joué avec ma vie
Mais personne ne perd ne gagne,
On ne gagne qu’avec la mort
En y perdant la vie.
Avec la mort on gagne l’oubli
De soi-même et souvent celui
Des autres. La mémoire
N’est pas fidèle Amie.
J’ai voulu changer ton destin,
Je ne sais si je parviendrai
À faire sourire les roses
Sur ton passage. À semer
Des bienfaits sous tes pas.
Tu as joué avec mon cœur
Mais tu n’as pas triché,
Les cartes sont bonnes et tu
Les distribues avec bonheur.
Au jeu de l’Ami, de l’honneur,
Continue à jouer encore,
Je ne saurai vraiment si tu m’aimes que
Quand je ne serai plus là pour l’apprendre.
QU’AI-JE À FAIRE D’UNE MAISON
Qu’ai-je à faire d’une maison
Si je n’habite le monde
Qu’ai-je à faire d’un toit
Si j’ai quitté le village
Étranger en moi-même
Exilé hors de tes murs
Qu’ai-je à faire de ces murs
Si je ne peux les abattre
Forcer la porte la serrure
Entre en toi secret violé
Si j’ai perdu la clé des mystères
Si le temple est profané
Si je vois se pencher les roses
Dans le vieux jardin défloré
Qu’ai-je à faire d’une chambre close
D’un lit ouvert d’un corps offert
Qu’ai-je à faire d’un ciel sans lumière
D’une mer qui s’est figée
Dans l’abandon de ses vagues
Dans l’oubli de ses marées
Qu’ai-je à faire de ce monde
Si je n’ai plus de maison
Sinon voyager dans ton rêve
Quand ton sommeil habite ma prison.
Poèmes extraits de Khalîl (1995). © éditions Librairie-Galerie Racine.
L’odeur de tes cheveux sur l’oreiller meurtri
Le poids de ton sommeil dans les draps qui respirent
Ta présence en éclats de beauté
Miroitant aux murs éblouis
La porte qui se referme est une douleur
Ton sourire qui s’éteint est une douleur
Mais toi parti ma solitude est grande
Tu es le géant qui l’habite.
*
Dire ton nom
comme un aveu fait à l’ombre
ne m’apaise pas
Crier ton nom à l’air à ceux qui
ne peuvent l’entendre
déchire ma raison
Écrire ton nom c’est le mien
qui s’efface
dans la mémoire d’un autre
Je peux seulement me chauffer à ton nom
ton nom est ma lumière
fruit de l’arbre du soleil.
*
Toujours l’attente
comme une scie
qui violente à coups répétés
le tronc abattu
comme une hache
qui fend la bûche
atteint le cœur du bois tendre
Et saigne la forêt tout entière
Et se lamente
dans l’abri de l’ombre
l’infirme lueur vacillante
Puis le temps refleurit
violette étoilée
*
Vois : la terre s’ouvre
Fouillée de nos flancs
Allège tes gestes Déploie
tes membres de marbre noir
Deviens bouche de brasier
fusant de ses feux farouches
Quand ne souffle
un vent de fournaise
Ravive les flammes enfouies
Et bâtis de tes bras
un château d’incendie
Écartèle mon désir
Puis affûte ton couteau
Tranche ma langue
Fais saigner nos cris
Tranche ma vie
*
La mort ne dure pas
c’est un bref instant
comme le plaisir
La volupté est longue longue
comme la vie
mais le plaisir est bref
Et je me retrouve dans
des bras innocents
coupable d’amour
Mais ma jouissance s’attriste
de n’être que cette courte lueur
cette flamme de bougie
qu’on souffle vite
Et la mort dans la nuit
est longue longue et je ne perçois plus
-lumière consumée – plus rien
rien que le corps enseveli de l’ombre.
Poèmes extraits de Fenêtre aveugle (1996). © éditions Librairie-Galerie Racine.
HAMAC
Île du bel été flottant sur l’eau des herbes
J’oublie en ton berceau les rumeurs du rivage
Ma vie est suspendue à ton balancement
Je sens couler vers moi les rivières de l’air
Je libère tous les oiseaux de ma poitrine
-Mes désirs envolés dans des vagues ailées-
Je remonte le cours des sources délivrées
L’ombre verte survit aux décombres du jour.
SEMENCES DE FEU
Soleil bougie
Lampe miroir
Tout te dénonce
À mon regard
*
Le corps dessiné de l’absence
Dans les draps inhabités
L’âtre éteint – cendres vivantes –
Tu renaîtras de l’attente
*
Jamais plus peut-être
Tes yeux clos
Sur le secret de ton âme
Abandonnée à mes mains
*
Tout est possible
Rien ne m’attache
À l’ombre de ta vie
Sur la mienne
*
J’ai rêvé que tu étais en vie
Ma mort seule
Te déliera de l’énigme
De n’être pas au monde
*
Dans tes bras
Je m’emplis de toi
J’expulse mon amour
Dans l’enclos de ton corps
*
Tête d’ange
Renversée
Le plaisir illumine
Tes yeux éteints
*
Être de l’instant
Tu cherches ton image
Dans les yeux de l’autre
Être de l’instinct
*
La nuit partout
Je te suis où tu vas
Tu es en marche
Dans mon rêve immobile
Poèmes extraits de Travaux d’approche (1999). © Librairie-Galerie Racine.
La ville me cerne mais de si loin
Murs étroits lavés de soleil
Où glissent des ombres stériles
Le sang ne circule plus
Dans les veines de l’arbre
Dimanches bêtes où se promène
La fatigue Enfants en laisse
Cœurs plombés par l’ennui
Broyés par la machine
De si près de si loin s’infiltre un bruit d’ailleurs
D’une mer aux vagues fortuites
Je suis une île que le temps oublie
*
Insupportable fatigue d’être soi
Ne plus se comprendre ne plus se surprendre
Je traverse le jour opaque où je me perds
Je demande à la vie ce qu’elle ne peut me donner
Et je refuse ce qu’elle m’offre : don désespéré
Objets précieux cachés sous le linceul de la lumière
Soudain la pluie tombe et je fuis la terrasse
Comme si cette eau ne pouvait baptiser
Un nouvel espoir une reconquête plus facile
De présents éparpillés vainement toutes les prières
Il y aura peut-être d’autres jours, quelques paroles
défrichées
Chaque chose est à sa place et je reste immobile
*
Silence creusé au cœur du patio
Puis posé comme une pierre qui regarde les choses
Sans les voir
Au moindre écho d’un signe qui me parle
Tout s’anime en moi
Même l’immobilité de mon cœur
Arrêté de battre soudain
Ce silence-là ne laisse pas de traces
Sur le mur absorbé
Dans la contemplation réciproque du ciel
Le remuement énorme de la mer
S‘entend au loin pourtant
Telle une autre parole confuse
Un Verbe sacré
Inconnu dans la langue des vivants
CHERGUI
Le vent qui me pousse
Vers toi
Toujours plus avant
Le vent qui violent m’étreint
Comme le front tes bras
Une aurore encore plus ardente
Se lève en moi
Quand se dresse le vent
Rempart contre le ciel d’écume
Je deviens torche vivante
Élément du désir vibrant
J’ai sur les lèvres
Le goût des étoiles sans lumière
Je bruis comme les arbres
Je bouillonne comme la mer
Je deviens le vent lui-même
Qui souffle le feu
Dans les veines de ta vie
Poèmes extraits de La Lumière est dans le noir (2002). © Librairie-Galerie Racine.
Une ombre se profile
derrière l’écran du soleil
Est-ce toi ou moi-même
ou l’Autre ?
Dans l’incandescence du jour
la nuit se repose et blêmit
Si je t’aime
pourrai-je supporter ma mort ?
Le monde se construit dans l’homme que l’on tue.
Christophe Dauphin
Vois le monde
expulse sa rage dans un souffle de mort
Nul oiseau ne répond à l’appel de la paix
les brebis ensanglantées ne paissent plus
Le berger clame au ciel sa prière amputée
aucun sursis pour les bourreaux
Écoute le fracas se dissout
par ma voix qui t’exauce
*
Ton bras dressé dessine
dans l’ombre une blancheur de songe
Oui je crois te voir mais je rêve
j’illumine d’or ton absence
De mots inventés je couvre ton corps
comme d’un linceul étoilé
Explorant plus bas que ton cœur
mes lèvres t’inspirent
*
Je me cache au creux de ton ombre
comme une œuvre en devenir
Tu es mon unique avenir
mon présent réconcilié
Ma preuve d’exister ma chance
d’être encore parmi les morts
Solitaire déshabité
un vivant qui respire
Ma planète n’est pas la vôtre.
Henri Rode
Ils restent là accroupis sur leurs déchets
les mangeurs de merde aurifère
Inconnus à eux-mêmes ignorants de tout
attendant le solstice de mort
qui les foudroiera dans leur gloire
Tandis que leurs âmes fripées
rejoindront le désert de l’île
rendant le souffle aux bergers de la mer
*
Les rêves du désir poussent dans
la lumière roses d’abîme
Ton corps n’est plus un souvenir mortel
mais la réelle offrande de la nuit
Je me souviens de tout du moindre éclat d’azur
et du pas doucereux de l’ombre qui s’avance
C’est dans la tombe ou dans le feu
que sera enfouie ou brûlée ma mémoire
Poèmes extraits de Soleil de minuit (2010). © éditions Librairie-Galerie Racine.
Yves GASC
[1] Notre ami Henri Rode a bien raison d’écrire : « Yves Gasc, tant par l’écriture que sur les planches, n’a pas fini de nous séduire, en dépit même de la qualité qu’il place au plus haut niveau : la discrétion. »
[2] Le titre provient d’un vers du poète anglais John Milton : La plus dure des prisons : le donjon de soi-même.
[3] Le haïku est un court poème, né au Japon à la fin du XVIIe siècle. En Occident, il s’écrit principalement sur trois lignes selon le rythme court / long / court : 5 / 7 / 5 syllabes dans sa forme classique.
[4] Le prénom Khalîl signifie en arabe « ami intime ».
[5] Le ghazal (parole amoureuse) est genre de poème, florissant en Perse au XIIIe siècle et XIVe siècle, composé de plusieurs distiques et chantant l'amour de l'être aimé. Le ghazal obéit à des règles de composition strictes : chaque distique est composé de deux vers d'égale longueur, le second vers se termine par un mot ou groupe de mot identique dans chaque distique (le refrain), mot que l'on retrouve par ailleurs à la fin du premier vers du ghazal. En général, le dernier distique doit contenir une allusion ou une invocation à l'auteur du poème.
[6] Robert Pinget par lui-même, en 1988 : « Né à Genève en 1919. Enfance magnifique en famille. Études classiques au collège, puis études de droit jusqu'au brevet d'avocat. Mobilisé en 39-45. Installé à Paris en 1946. Y travaille d’abord la peinture, puis reprend définitivement la littérature. Première publication d'Entre Fantoine et Agapa en 1951, suivie de nombreux romans, pièces de théâtre et de radio. Liste exhaustive page 4 du roman L’Ennemi, 1987, publié aux éditions de Minuit comme tous ses autres livres. A fait beaucoup de voyages, de conférences et de lectures dans les universités de quatre continents. En 1966, tout en gardant sa nationalité genevoise, a repris la nationalité française de son grand-père maternel et de son arrière-grand-père paternel. A bénéficié d'une place d’honneur au Festival d’Avignon 1987 et du Prix national des Lettres la même année. Travaille aujourd'hui de préférence en Touraine. »
[7] Robert Pinget est l’auteur d’une série de courts récits mettant en scène un certain monsieur Songe ; personnage créé en 1982 comme une sorte de faux double ; personnage récurrent de l’œuvre à l’origine d’un livre éponyme (1982), et donné depuis comme l’« auteur » de plusieurs petits volumes de carnets (le Harnais, Charrue, Du nerf). Celui-ci est retraité. Il habite une villa en bord de mer, « non loin d’Agapa, petite station balnéaire pleine de monde l’été et très ennuyeuse l’hiver ». Il est à la fois un poète, un sentimental, un méditatif et un impulsif. Il a tendance à s’assoupir devant son café ou ses factures. N’est jamais là où il se trouve. A toujours confondu parler et écrire. Pour Robert Pinget, le recueil des histoires de monsieur Songe est à prendre comme un « divertissement ». Le plus subtil, drôle et mélancolique qui soit. Monsieur Songe, occupé à un jardinage existentiel, se pose de fréquentes questions philosophiques, dans la catégorie du devisement de bistro, en nettement plus profond et avec une prédilection pour la matière littéraire. Car Monsieur Songe écrit, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque c'est l’auteur.
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
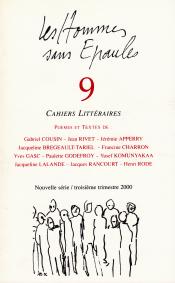
|

|
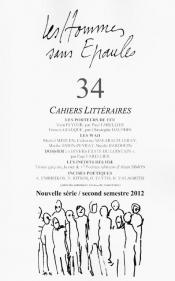
|
| Gabriel COUSIN, Jean RIVET n° 9 | Jean MALRIEU, André MARISSEL, Mahmoud DARWICH n° 12 | Dossier : DIVERS ÉTATS DU LOINTAIN n° 34 |
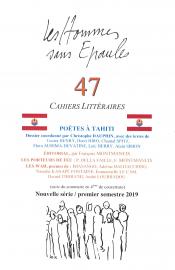
|
||
| Dossier : Poètes à TAHITI n° 47 | ||
Publié(e) dans le catalogue des Hommes sans épaules

|
||
| AUTOUR DE JEAN COCTEAU | ||
