Jean DIGOT

Jean-Louis Digot est né le 19 juin 1912, à Saint-Céré (Lot), avant de venir avec ses parents (son grand-père, Communard en 1871 se réfugia à Saint-Denis, où son père, agent commercial en produits alimentaires, naquit. Sa mère est originaire du Cantal) en Aveyron, en 1913, à Rodez, ville qu’il ne quittera plus en dehors d’un « séjour » forcé en Allemagne.
Jean Digot a tout d’un chef de file et il l’est devenu, malgré lui : celui des poètes du Rouergue. Poète, Jean Digot est également un animateur hors-pair de revues (L’Aube Artistique et Littéraire, Les Heures Rouergates, Cumul, Pages), un éditeur avisé (Les Feuillets de l’Îlot, Jeanne Saintier) et le fondateur/animateur des Rencontres internationales de poésie de Rodez (1951-1995). Bernard Noël écrit de son aîné : « La guerre et surtout la captivité en Allemagne assombrissent tout l’arrière-pays de Jean Digot d’une fumée de deuil et de tristesse qu’il lui faut san cesse traverser en lui-même. On voit le poème commencer dans cette ombre et la franchir en devenant l’instrument de sa propre clarté : la verticalité n’est pas qu’une apparence sur la page, c’est une volonté. Au passé triste et intériorisé comme un territoire mental s’oppose le pays chargé de temps qu’est le Causse avec son dolmen : pays solide et silencieux qui s’étend à perte de vue dans le lointain intérieur. Deux vers portent magnifiquement cette impression : le cri des pierres me révèle – l’aridité de ma mémoire. »
Contrairement à nombre de ses amis aveyronnais de condition plus modeste, Digot a fait des études. Denys-Paul Bouloc témoigne (in Sud n°59, 1985) : « Il bénéficiait, par rapport à moi, d’un double avantage : celui de l’âge et celui du savoir. Il avait fait des études supérieures : à la Faculté Catholique de Lille, pour commencer, puis à La Sorbonne… Alors que j’émergeais tout juste de mon obscure condition, lui avait vécu ailleurs, fréquenté les milieux littéraires de la capitale, mené une action non négligeable en faveur de la nouvelle poésie. Et surtout - élément dominant à mon sens – il avait à son actif deux plaquettes de vers. Bref, son expérience en imposait… On comprendra aisément ce que représentait Jean Digot, à mes yeux, si l’on se souvient que, dès 1931, à la tête d’une petite équipe dans laquelle figurait le cher Pierre Loubière, il avait fondé à Rodez, L’Aube Artistique et Littéraire, que par la suite, à Paris. Il avait lancé plusieurs revues : Les Heures Rouergates (1933), Cumul (1934), Pages et collabore à maintes publications. Réintégrant sa ville, il devait créer, en 1937, Les Feuillets de l’Îlot, collection anthologique de glorieuse mémoire. J’ajouterai qu’il m’associa, en 1939, au destin de celle-ci… Le 1er septembre 1939, Jean Digot est mobilisé. Au printemps 1940, il est fait prisonnier. Le jeune homme des années 30 s’efface à l’ombre des miradors. Toutefois, les barbelés derrière lesquels il se morfond n’étoufferont pas sa voix. Dans son stalag de Prusse Orientale, en dépit du froid, des privations, de la misère, il publie Baltique (1942), revue où il accueille les textes de nombreux poètes prisonniers. Et c’est de sa captivité qu’il tirera les accents les plus poignants de son œuvre poétique. L’histoire pourrait s’arrêter ici. Il n’en est rien. On sait que Jean Digot au terme de cinq années d’exil, refit surface en août 1945. Infatigable, il se remit à l’ouvrage. Sous sa houlette, les éditions Jeanne Saintier (1948), les collections Fronton et Chantiers du Temps, virent le jour. En 1955, Jean Subervie lui confia la responsabilité littéraire de sa revue Entretiens sur les Lettres et les Arts et, en 1956, la direction de la collection Visages de ce Temps. Co-fondateur des prix Antonin Artaud, Ilarie Voronca, en 1952, Claude Sernet (1969), il reste le farouche mainteneur de ces prix, l’artisan de leur continuité, de leur longévité, en même temps que le principal animateur des manifestations qui les entourent et qui sont universellement connues, depuis 1952, sous la dénomination de Journées de poésie de Rodez. »
Ces Journées n’avaient pas d’équivalent en France. Elles furent fondées en 1951 par l’association des poètes du Rouergue, emmenée par Jean Digot, afin de remettre les prix Artaud, Voronca et Sernet. D’un weekend, elles finirent par s’étendre sur une semaine, avec un salon du livre de poésie, des rencontres, des débats, des signatures, des expositions de peinture et même un festival de cinéma. Ces Journées internationales de poésie de Rodez, tout comme les Prix, survivent très péniblement à la mort de Jean Digot le 5 septembre 1995, et ne trouvent ni relève, ni talent désintéressé à la hauteur. Tout s’arrête en 2009, comme à bout de souffle, de sous et d’idées.
Autour de Digot, il y eut des poètes, des hommes, nous l’avons vu, mais aussi des femmes, dont les trois poètes-institutrices : Jeanne Foulquier (1891-1979 : Vivre pour la beauté ! Être insecte ou bien fleur), Myriam Georges (1906-1996 : Nous n’irons plus au bois ; nos lauriers sont coupés – et ne refleuriront que dans l’envol des flammes) et Christiane Burucoa (1909-1996) : Lorsque le jour est égal à la nuit. – Ils ont noué des comètes de laine – Aux pans de mon manteau de pierre), sans doute la plus importante. Enfin, Marie-Louise Vaissière (1910-1990 : Je te parle d’un haut-pays de sources vives) et Maryvonne Digot (1942-2021), la belle fille de Jean, poète et peintre pour qui, le paysage figé brûle ses papillons de verre à la solitude des corps. Poète de l’aube et du crépuscule à la fois, des villages couchés le long d'un fleuve triste, des cris et des chuchotements de l’enfance, à l’ombre d’un jardin qui buvait le parfum du jasmin.
Pour nombre d’entre elles, d’entre eux, la fracture, c’est la guerre et le camp de prisonnier durant toute la période de l’Occupation pour Jean Digot, qui a appartenu à une unité militaire qui a couvert, après la déroute, l’embarquement des troupes anglaises à Dunkerque, en 1940 : Il y a l’ombre et le silence – et l’oubli des vivants qui ne reviendront plus – et tout cela forme la danse – d’un monde infame où nous vivons reclus.
Que Dire, que faut-il dire aux hommes ? Cette question est à la base même de toute l’œuvre de Jean Digot. Sa réponse est : Abattons nos cartes ! Il a fait l’apprentissage de la solitude, de la misère, de la haine et de la douleur : Je veux parler comme on se bat – ne plus lier à mon destin – que l’angoisse d’un cri – J’ai d’une lutte à témoigner – d’une injustice à triompher – d’une misère à rendre compte… - Je vis sans cesse au cœur du monde – prêt à dompter chaque regard – en sa beauté de feu. Digot, c’est une haute idée de l’homme, de la poésie et du poète : « Un poème n’est pas une succession de mots ou d’images savamment inventée. Images et mots ne sont que matériaux au service d’un style. Visage d’une solitude inexorable, la solitude humaine, le poème se crée à partir d’impressions, sensations ou sentiments que traduit un langage… Quand un poème devient poème pour moi, c’est à partir d’une émotion que j’ai eu quelque part, à un moment. Cela peut être très ancien, cela peut être très récent, mais c’est une émotion. » Mais, comme il le dit lui-même : « N’est-il pas vain de le rappeler à un monde qui s’énorgueillit de la quasi générale médiocrité des idoles qu’il enfante au détriment des valeurs véritables ? »
Digot rejoint Artaud, qui écrit à Rodez le 20 septembre 1945 : « Je n’aime pas les poèmes ou les langages de surface et qui respirent d’heureux loisirs et des réussites de l’intellect, celui-ci s’appuyât-il sur l’anus mais sans y mettre de l’âme ou du cœur. » En 1970, Digot, pourfend l’intellectualisme d’arrière-garde, creux, stérile et déshumanisant des revues Tel Quel (1960-1982) ou TXT (1969-1993) et de leurs exégètes (Christian Prigent, Denis Roche, Philippe Sollers, Renaud Matignon, Michel Deguy, Marcelin Pleynet, Denis Roche, Jean-Pierre Faye, Jacqueline Risset…) et écrit dans son article Fin de ligne (in revue Verticales 12 n°4-5) : « Or, voici que tout paraît remis en question. Stimulés par l’attrait d’une rapide notoriété, nullement inquiets d’oublier l’essentiel de la démarche du poète, ce qui vraiment le caractérise, divers théoriciens essaient de nous ramener aux errements du passé, ces dix-septième et dix-huitième, siècles durant lesquels notre poésie accepte de se soumettre à la rigueur formelle… L’on sait que cela se produit, sous l’influence terroriste d’un dogmatisme paré des atours de la science, allons-nous assimiler la poésie au jeu d’une société restreinte et faussement cultivée ? (..) Et lorsqu’à propos de Michel Deguy un commentateur précise qu’il s’agit d’un poème « réflexif, critique, linguistique, philosophique », comment ne pas m’interroger ? Cet amalgame de disciplines, est-ce cela le visage de l’actuelle poésie ? Aujourd’hui chacun veut sa part de gloire et d’originalité bien avant de l’avoir méritée. Ainsi fleurissent exposés et manifestes d’écoles ; les œuvres pour les illustrer, n’apparaissant ensuite que tentatives d’adaptation aux principes énoncés. Dès lors est inversé le cycle création-critique et quelle caricature qu’une création amputée de sa force majeure : la liberté ! (..) Lié aux impératifs formels ou de pensée, le poète n’est plus qu’un fabricant d’images ou de symboles, un artisan du verbe privé de ses attaches profondes…Il flotte comme une odeur de néon ou de néant sur une large part de la littérature ou de la poésie de ces dernières années… Rhétoriqueurs, soyez fiers : vous avez raison. Raison de la conscience (je sais, ce mot vous déplaît). Résultat : il n’est plus d’air frais, respirable, dans cet univers de police apparente ou déguisée que vous êtes sur le point d’engendrer. Tous dans le même wagon, esclaves, robots, machines à tracer dans l’espace le même geste, le même signe sur la page blanche, que cherchons-nous ? Rhéteurs sans passion, sans espoirs, cessez de nous ennuyer avec vos ratiocinations, vos intransmissibles accouchements. Quelque part brûle un feu qui, lui n’engendre point le désert ou la cellule du captif. D’autres que vous s’efforcent d’en cerner le mystère. Afin d’y reprendre vie… Mais, nulle force ne pourra s’y opposer : il y aura toujours des poètes debout. Leur regard ne s’éteindra point. Même si la nuit règne, même si la masse des écrivains n’est guère plus qu’une masse de rampants livrés aux injonctions d’une société qui les nourrit et les glorifie… »
Digot ne transige pas et ne mâche ni ses mots, ni ses idées, ni ses valeurs, dès ses débuts dans les années 30. Relisons-le encore une fois, à l’âge de 23 ans (cf. Briser nos chaînes in Cumul n°7, 1935), le constant est implacable et prophétique, tant par ce qui arrive quatre ans plus tard, en 1939, que pour notre époque, au XXIe siècle : « Le problème de la misère est dans notre vie, aujourd’hui, comme un feu dans la ville. Il faudra se liguer pour l’abattre et toutes les bonnes volontés n’y suffiront pas. Il faudra l’effort de générations, encore, la lutte, certes, mais surtout la persévérance et la suite. Pourquoi ? Quand j’écris ces lignes, à nouveau depuis vingt ans (même pas le temps de vieillir un peu !) la guerre appartient au domaine des choses réelles. On se bat ; deux races blasphèment parce que les vœux de l’une allaient à l’encontre des vœux de l’autre et que, pour terminer une sérieuse discussion, il ne s’est pas trouvé de volontés parallèles, parallèles vers le bien, évidemment. Pourtant, le problème du siècle, le problème essentiel de la misère humaine n’est pas là, dans les évènements ; il est dans les consciences : l’individu, partout, a tué la personne, comme la société, naguère, détruisait les valeurs individuelles, jusqu’à leur possibilité d’affirmation. À l’intérieur de l’être, l’égoïsme a pris des proportions démesurées. On peut devenir égoïste : le romantisme n’était pas un mal. Mais de cette acceptation tacite du bonheur à leur volonté persistante de jouir, de profiter et d’abuser, il y a la marge du moral (ou de l’amoral) à l’immoral. On ne franchit pas ce gué facile sans se mentir à tue-tête. Les mots prennent trop d’importance : on refuse de s’en rendre compte… et l’on avance toujours, attiré, gagné. Cette banale acceptation est le nœud du problème. Ce sera faute de l’avoir énoncée assez tôt que notre civilisation périra. Les maux dont nous souffrons maintenant, en effet, sont des maux d’estomac et de ventre ; avant, toutefois, ils furent des maux de l’intelligence et de la sensibilité ; chacun s’en gaussait, alors ; maintenant, quel que soit son titre à la misère, chacun en pâtit, en souffre horriblement (combien en meurent ?...) Les routes sont barrées… où aller ?... La jeunesse réclame une issue. On lui offre une embuscade. »
Jean Digot est décédé à Rodez, le 5 septembre 1995.
Œuvres de Jean Digot : Prélude poétique (L’Aube artistique et littéraire, 1932), Équateur de l’amour (Feuillets de l’Îlot, 1937), Plus beau que terre (Méridiens et Parallèles, 1948), Franchir le pas (La Tour de Feu, 1949), Poètes du Rouergue, essai (Jeanne Saintier, 1949), Le feu et l’ombre, frontispice de Pierre Soulages (Seghers, 1952), Don Juan Désert (Chantier du Temps, 1953), Les jours sont seuls (Rougerie, 1954), Légende (Cahiers de Rochefort, 1958), La ville sainte (Celf, 1960), Le lieu et la formule (Subervie, 1962), Le pays intérieur, couverture de Pierre Soulages (Seghers, 1967), Paroles au-delà (La Presse à poèmes, 1969), Solitude glanée (Rougerie, 1973), Poésie en Rouergue (Rougerie, 1977), Vérité du silence (Rougerie, 1979), Airs de pluie (Verticales 12, 1980), Que dire, que faut-il dire aux hommes ?, anthologie (éditions du Rouergue, 1991), Trois du Rouergue, essai (Brémond, 1995).
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
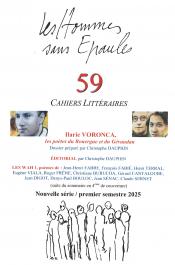
|
||
| Dossier : Ilarie VORONCA, les poètes du Rouergue et du Gévaudan n° 59 | ||
