Catherine MAFARAUD-LERAY

Catherine Mafaraud-Leray (née en 1948) fut « découverte » dans Poésie 1, la revue de Jean Breton. Il s’agit du n°74, « Les Poètes et le Diable », en 1980. Celle qui se nomme Katrine Mafaraud est alors âgée de trente-trois ans. Elle a publié trois recueils : Blaue Johanna (1976), La Forêt Infernale (1978) et surtout, le détonnant : Je suis laide aujourd’hui comme une cathédrale (1978) : Dans cet écho qui part de l’œil vision - Et atteint l’œil digestif du sexe - Dans ce chaos de pensées-foutre - Et de sensations pyramidales - Dans ce blockhaus de peaux d’écailles - Et de phalanges aux doigts - Dans cette demeure troglodytique - Et résolument souterraine - Où le corps est désavoué - Par ses propres visions - Dans ce trou veineux armé de couleurs - Je me dissous irrémédiablement.
Son portrait photographique (in revue Poésie 1) ne nous montre pas, évidemment, le monstre de laideur revendiqué. La photo évoque la gravité et la douleur du personnage : une « florentine » noyée dans le fleuve noir de son regard, autant dire son sang. La présentation qui précède ses poèmes dans la revue, nous dit : "Son corps intouchable (introuvable), au désespoir de se voir si laide, d’être le diable ou le monstre."
Mafaraud est un poète à bout de mots, à bout de cendres, Vampire d’une douceur qu’elle ne supporte ni ne calme. Par cette transmutation, saisie, par tous ses nerfs entrechoquée, elle souffre avec sexe-signal, à toute vitesse. En colère d’être. » Si j’écris que, Je suis laide aujourd’hui comme une cathédrale, est détonnant, c’est qu’il fut reçu ainsi, tranchant radicalement par ses cris et sa violence, d’avec la production poétique de l’époque.
Catherine Mafaraud-Leray publie, par la suite, dix livres et plaquettes, dont : Dites-le aux dahlias, aux crapauds et aux chiens (2005) et Un os d’arrogance entre les reins (2010). Les titres sont souvent forts et provocants (citons encore : Nous avons tué plein de pianos, Locus Mafaraldis, Elle qui volait des villes, Une heure dans le passe-aiguille). Mais la provocation n’est pas le but recherché. La poésie sort ainsi, telle la lave du volcan. Il s’agit d’une véritable éruption du langage, un langage cru, des images-chocs, pour dire un quotidien, qui est une histoire de fantômes personnels, dont le poète est l’usufruitière et la malchance.
Comme chez son ami Michel Merlen, mais dans un registre et une poétique qui lui sont propres, Mafaraud-Leray, dans une situation de survie, écrit, non sans humour noir ou ironie, l’urgence dans l’urgence, sous la crasse horrible et violente du jour qui monte : celle du corps, de l’amour, de la mort, des duos de mâchoires qui s’affrontent, des ombres qui se mordent, de la jouissance et des sexes qui s’avalent, la déchirure du désir, avec la liberté pour seul vice.
Chez Mafaraud-Leray, il n’y a aucun interdit, aucune censure, et certainement pas au niveau du langage, comme chez Thérèse Plantier : une vulve est appelée une vulve, on bande, il y a du foutre, des cris qui hurlent ce qui existe : De ce que - éternellement vous refusez - Pourquoi la peau le sexe –Feraient-ils toujours flamber vos bûchers ? De la révolte, face à un monde déshumanisé : Et dans ce monde sans flammes – Qu’allez-vous torturer ? Un poète rare, tout comme le sont ses publications, en revues pour le principal.
Catherine Mafaraud-Leray est l’une des voix les plus personnelles de sa génération. Un cri sans concession.
Catherine est décédé le 16 juin 2023, à l'âge de 74 ans.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
A lire : Blaue Johanna (Millas-Martin, 1976), La Forêt Infernale (Le Crayon Noir, 1978), Je suis laide aujourd’hui comme une cathédrale (Possibles, 1978), Nous avons tué plein de pianos (Polder, 1982), La fin des mollahs de pierre (Le Débleu, 1985), Le Poil (Beth Olam, 1989), À l’arrière de vos villes (Polder, 1989), Locus Mafaraldis (Travers, 1990), Femmes fatales sur papier rouge (éditions Exhibitions, 1997), Elle qui volait des villes (Décharge, 2001), Ombres de dos en plein soleil (A.-L. Benoît, 2002), Une heure dans le passe-aiguille (A.-L. Benoît, 2003), Dites-le aux dahlias, aux crapauds et aux chiens (Le Dé bleu, 2005), Un os d’arrogance entre les reins (Gros Texte, 2010), La Mort, c’est nous…, avec Michel Merlen, préface de Christophe Dauphin, (Gros Texte, 2012).
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen, La Mort, c’est nous… (2023)
En 2011, Catherine et Michel m’ont demandé d’écrire la préface du livre qu’ils venaient d’écrire à quatre mains et à deux voix, devant être (et il le fut) publié aux éditions Gros Textes d’Yves Artufel : Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen : La Mort, c’est nous… (Gros Textes, 2012). J’ai bien sûr accepté pour ces deux poètes connus, aimés et lus depuis longtemps. Ma préface s’intitule « La mort c’est nous et nous sommes bien en vie ! » Michel est mort le 30 juin 2017, à l’âge de 76 ans. Catherine, à 74 ans, six ans plus tard presque jour pour jour, le 16 juin 2023. La Mort, c’est nous…, leur livre à deux voix, mais comme d’une seule, brûlée et sans concession, prend aujourd’hui toute son ampleur, encore.
Michel, le jeune homme gris, est l’un de nos meilleurs poètes et aussi l’un des plus douloureux avec le grand Alain Morin. Son livre majeur est sans doute le poignant, dans la prestigieuse collection de Jean Breton « Poésie pour vivre », Abattoir du silence (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1982), alors que Catherine donnait Je suis laide aujourd’hui comme une cathédrale (Possibles, 1978). Voilà, c’est fait, à présent, la mort c’est eux, pas même avec un os d’arrogance entre les reins. Ils sont partis par la toute petite porte dégondée des poètes, celle de l’indifférence et du mépris, et même les dahlias, les crapauds et les chiens n’en ont rien eu à faire… à l’exception de quelques-uns…
Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen, La Mort, c’est nous… (2012)
Les publications de Catherine Mafaraud-Leray et de Michel Merlen sont rares. Ils n’ont jamais cherché à se montrer et encore moins à « faire carrière ». Mais est-ce bien cela la poésie : faire carrière ? Michel Merlen répond : vous ne parviendrez pas à assassiner le désir – législateurs anonymes de l’obèse et de la vacuité.
Discrets, ils le sont, même à l’heure d’Internet. Merlen se fît remarquer dans la revue Poésie 1 n°19, en 1971. Le poète a alors trente-et un ans et vient de donner Les Fenêtres bleues (1969) et Fracture du soleil (1970). Le poème merlénien que nous connaissons est déjà là : langage concis et épuré, ton personnel et exigeant, images dénuées de fioriture et sans trompe l’œil : je chante comme par MIRACLE – dans le NOIR qui brille – un long bras sur la face. Il ne ressemble à aucun autre, balle perdue au fond de quelque tiroir.
Homme blessé, Merlen ! Poète de la faille, de la fracture, d’un quotidien sans illusion (ça suffit de marcher pour rien dans l’incendie du quotidien), sans aucun doute, mais ne faisons pas fausse route, même si la tentation est grande : rien à voir avec le mythe du « poète maudit » ou celui du « poète triste ». Merlen le dit lui-même : Je veux qu’on le sache – j’ai de l’admiration – pour tout ce qui est vivant, sans jamais rien cacher de sa fêlure, qui ira malheureusement en grandissant : j’ai des balafres j’ai des plaies – Je sors des hôpitaux – pour me soigner – au vent cinglant des villes – à l’iode du sourire des filles – mais le métro mâche mes mots – les voitures m’évitent – je glisse sur les boulevards – comme une boule de billard.
Dans C’est nous, la mort…, Merlen écrit encore, relatant un internement et ses méthodes barbares : Ils ont fouillé ma valise. Inventaire. Pyjama. Tutoiement d’office. Je n’ai plus d’identité. Ils ont pris ma carte. Mon carnet d’adresses. Je n’ai plus d’amis. Couloir de morgue qui mène à la pharmacie. Piqûre de valium. Chambre lugubre comme un dimanche de novembre. Lit paillaisse. Eau de Javel. Plus de musique pour résister au temps. Pas de stylo pour écrire l’urgence. Rien. Personne. Sans profession. Sans domicile. Divorcé d’avec le monde. A force d’aller à l’hôpital on finit par y rester.
Merlen n’a jamais cessé d’écrire (est-ce seulement envisageable ?), mais les abîmes le dévorent : comme si – le permis de vivre – était refusé. Merlen lutte pour retrouver le souffle de l’enfance – les paroles de l’enthousiasme. Merlen n’accepte pas de mourir : je n’accepte pas que le sexe de la poésie – ne fleurisse plus dans la galaxie du vivre. Cinq livres entre 1983 et 2011, c’est peu, diront certains. Ce n’est pas si mal, à mon avis, car à l’encontre de ceux qui publient à tour de bras et confondent le folklore et le fatum humain, Merlen oppose son vivre, son devoir de regard, avec exigence : ne laisse pas aller le monde – sans toi – privilégie l’excès – reste – éteins le malheur – et vois.
Ces propos sont tout aussi valables pour Catherine Mafaraud-Leray, que l’on découvre, tout comme Merlen, dans Poésie 1, la revue de Jean Breton. Il s’agit du n°74, « Les Poètes et le Diable », en 1980. Celle qui se nomme Katrine Mafaraud est alors âgée de trente-trois ans. Elle a publié trois recueils, dont le détonnant : Je suis laide aujourd’hui comme une cathédrale (1978). Si j’écris que ce livre est détonnant, c’est qu’il fut reçu ainsi, tranchant radicalement par ses cris et sa violence, d’avec la production poétique de l’époque. Catherine Mafaraud-Leray publie, par la suite, dix livress et plaquettes, dont : Dites-le aux dahlias, aux crapauds et aux chiens (2005) et Un os d’arrogance entre les reins (2010).
Comme chez Merlen, mais dans un registre et une poétique qui lui sont propres, Mafaraud-Leray écrit, non sans humour noir ou ironie, l’urgence dans l’urgence, sous la crasse horrible et violente du jour qui monte : celle du corps, de l’amour, de la mort, des duos de mâchoires qui s’affrontent, des ombres qui se mordent, de la jouissance et des sexes qui s’avalent, la déchirure du désir, avec la liberté pour seul vice.
On comprend donc aisément ce qui a pu rapprocher Catherine Mafaraud-Leray et Michel Merlen. Dès maintenant, il est manifeste, que C’est nous la mort… de Catherine Mafaraud-Leray et de Michel Merlen est vécu et ressenti vitalement : La mort viendra – Je sais – mais je vivrai d’abord… C’est nous la mort – joyeuse comme un faire-part, écrit Merlen. Mafaraud-Leray y ajoute sa violence et sa révolte : Le corps est un égout – Qui se vomit dedans – Les arbres mes complices – Dans un filet de cygnes – Me tendent leurs cous noirs – Et leur corde gelée.
La poésie de Mafaraud et de Merlen, et C’est nous la mort… le confirme, est une tension extrême de tout l’être hors de lui-même vers sa vérité, qui nous arrache enfin des cris qui peuvent bien s’exténuer et se ruiner, mais dont il reste toujours assez d’éclats dans l’air pour que nous nous entendions au moins une fois aimer et vivre, pour que nous entendions ces cris qui ne nous appartiennent plus dès qu’ils ont quitté nos lèvres, qui ne sont plus à personne parce qu’ils sont ceux de l’homme dans la solitude et dans l’amour.
Christophe Dauphin (in revue recoursaupoeme.fr, 10 juin 2012).
DANS UN CHAMP DE COTON BLEU
Mourir au bord d'un banc
Des oiseaux
Plein les oreilles
Crever au drap du lit
Intouchable
Sur un paillasson de rêve
En finir aux gencives d'un fossé
Dans la boue
Quand crépite la lumière
Clamecer sans drapeau
Hirsute
Derrière une stupide colonne militaire
Claboter
Du plus haut de la Tour de Dubaï
Eclaboussée d'aube en soleil
Faire son trou avec un gang de mésanges et de
portraits
Dans un champ de coton bleu
Où deux jeunes cerfs s'embrassent lentement.
Catherine Mafaraud-Leray
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
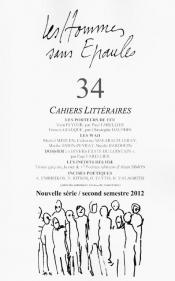
|
||
| Dossier : DIVERS ÉTATS DU LOINTAIN n° 34 | ||
